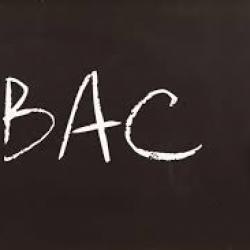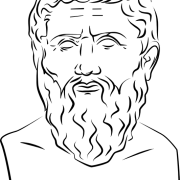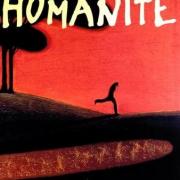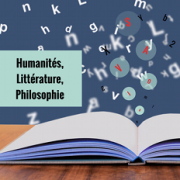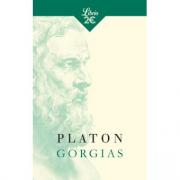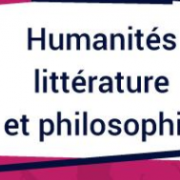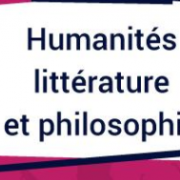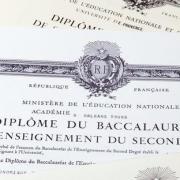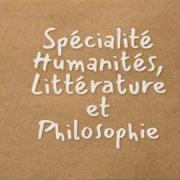Corrigé des sujets de spécialité HLP bac 2025 sur sujetscorrigesbac.fr
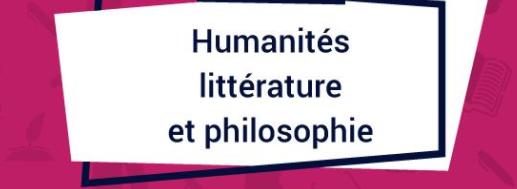
Métropole 2025
Epreuve : Bac Général
Matière : Humanités, littérature et philosophie
Classe : Terminale
Centre : Métropole
Date : 2025
Coefficient 16
Le jour de l’épreuve, vous devrez répondre à deux questions d'interprétation littéraire ou d'interprétation philosophique sur un texte et rédiger un essai littéraire ou philosophique pour un total de 20 points, chacune des deux questions valant 10 points. Deux sujets sont proposés, "la recherche de soi" et "l'humanité en question".
Dans la première question, vous devrez procéder à un développement organisé de la thématique du texte. Dans l'essai, vous devez répondre à une problématique, votre réponse doit être détaillée et organisée.
Sujets HLP bac 2025 jour 1
Lecture du sujet PDF
![]() Spe humanites litterature philo 2025 metropole 1 sujet officiel 1 (587.84 Ko)
Spe humanites litterature philo 2025 metropole 1 sujet officiel 1 (587.84 Ko)
Sujet :
HLP du mardi 17 juin 2025
- Première partie : interprétation philosophique
- Pourquoi, d’après ce texte, faut-il « exercer l’âme des enfants » à la pitié ?
- Deuxième partie : essai littéraire
- La littérature a-t-elle pour vocation d’éduquer à la sensibilité ?
Corrigé bac 2025 jour 1
- Première partie : interprétation philosophique
- Pourquoi, d’après ce texte, faut-il « exercer l’âme des enfants » à la pitié ?
Dans cet extrait des Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791), Condorcet, philosophe des Lumières et homme politique engagé, défend une conception profondément humaniste de l’éducation. Dans le contexte révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, où l’école devient un enjeu démocratique, il affirme que l’instruction ne doit pas seulement former l’intelligence, mais aussi les sentiments moraux fondamentaux, au premier rang desquels figure la pitié. Cette dernière est décrite comme un ressort essentiel de la sensibilité naturelle, sur laquelle repose toute éthique véritable.
Nous chercherons donc à comprendre pourquoi, selon Condorcet, il est essentiel d’exercer l’âme des enfants à la pitié. Nous verrons que la pitié est présentée comme une disposition naturelle mais fragile, qu’il faut cultiver pour préserver la morale, et qu’elle constitue un enjeu politique majeur pour toute société aspirant à la liberté.
I. La pitié : un sentiment naturel et universel, premier socle de la morale
Dès les premières lignes, Condorcet affirme que certains sentiments fondamentaux, comme la pitié, la reconnaissance ou l’amitié, doivent être cultivés dès le plus jeune âge. Ces émotions morales, explique-t-il, sont naturellement présentes dans l’être humain : « ces sentiments sont de tous les âges ». Cela signifie que l’enfant possède en lui un germe de sensibilité morale, que l’éducation doit non pas créer, mais développer, éclairer et fortifier.
En particulier, la pitié est définie comme une réaction irréfléchie et presque organique face à la souffrance d’autrui : « produite en nous par la vue ou le souvenir des souffrances d’un autre être sensible ». Ce mécanisme spontané repose sur notre capacité à nous identifier à l’autre, à ressentir indirectement sa douleur. La pitié pour les animaux est donc, selon Condorcet, de même nature que celle que nous éprouvons envers les humains.
La pitié constitue ainsi un point de départ éthique : elle est le premier moteur de l’action morale, antérieur même à la réflexion ou au raisonnement. Elle permet à l’enfant de sortir de l’égoïsme naturel, de se tourner vers autrui, et de reconnaître que la souffrance est un mal, même lorsqu’elle ne le touche pas directement. L’éducation doit donc cultiver cette disposition, l’amener à s’exprimer, se stabiliser et guider le comportement.
II. Les dangers de l’oubli ou du déni de la pitié dans l’éducation
Condorcet met en garde contre un système éducatif qui ignorerait ce rôle fondamental de la pitié. Il insiste sur les effets destructeurs d’une éducation qui habituerait l’enfant à assister à la souffrance, notamment celle des animaux, sans réaction morale. Un tel entraînement produirait l’effet inverse de l’éducation souhaitée : « on détruit en lui […] le germe de la sensibilité naturelle ».
L’auteur critique ici toute forme de brutalisation précoce : voir souffrir avec indifférence, ou pire, avec plaisir, revient à désensibiliser l’enfant, à émousser son sens moral. La morale devient alors une construction artificielle, une stratégie intéressée, réduite à un calcul ou une obéissance sans âme : « elle n’est plus qu’un calcul d’intérêt, une froide combinaison de la raison ».
Condorcet emploie une métaphore végétale pour décrire la sensibilité morale : « une plante faible encore, qu’un instant peut flétrir et dessécher pour jamais ». Cela montre à quel point la sensibilité est fragile et réversible : une fois détruite, elle ne peut pas facilement être reconstruite. L’éducation morale est donc un travail de préservation délicat, et une erreur dans les premières années peut avoir des conséquences irréparables.
III. Un enjeu politique : former des citoyens libres et sensibles
Enfin, Condorcet élargit sa réflexion à une dimension politique, en lien avec ses idéaux républicains et progressistes. Il observe que, chez l’homme « occupé de travaux grossiers », c’est-à-dire dans les classes laborieuses, la sensibilité peut s’émousser en raison d’un quotidien rude, centré sur la survie et les besoins immédiats. Cela ramène l’individu à des « sentiments personnels », et rend l’habitude de la dureté plus probable.
Il écrit : « cette disposition à la férocité […] est le plus grand ennemi des vertus et de la liberté du peuple ». La perte de la pitié ne met donc pas seulement en danger l’éthique individuelle, mais aussi les fondements d’une société démocratique. Une population insensible, privée de sa capacité d’empathie, devient plus vulnérable à la violence, à la répression, et plus encline à accepter la tyrannie.
Condorcet conclut en affirmant que cette insensibilité donne aux oppresseurs un prétexte pour instaurer des lois injustes, sous couvert de « rationalité ». La pitié devient donc un rempart contre l’injustice, et sa culture une condition de la liberté politique.
Pour Condorcet, il est indispensable d’exercer l’âme des enfants à la pitié car ce sentiment, profondément enraciné dans la nature humaine, constitue le fondement de la morale, des vertus sociales et de la liberté politique. Il doit être cultivé avec soin dès l’enfance, car son extinction expose l’individu au repli égoïste, à la violence et au despotisme. Ce texte propose ainsi une réflexion d’une actualité frappante : dans un monde où l’éducation est souvent réduite à des compétences techniques, Condorcet rappelle avec force que former des esprits libres suppose d’abord de former des cœurs sensibles.
- Deuxième partie : essai littéraire
- La littérature a-t-elle pour vocation d’éduquer à la sensibilité ?
La littérature est une des plus anciennes formes d’expression humaine, un lieu où se croisent les émotions, les idées, les conflits et les rêves. Face à la brutalité du monde, certains défendent l’idée que la littérature a pour fonction essentielle de cultiver notre humanité, en développant notre capacité à ressentir, à éprouver de l’empathie et à reconnaître les émotions des autres. Autrement dit, la littérature aurait pour vocation d’éduquer à la sensibilité, non seulement au sens de l’émotion, mais aussi au sens moral du terme.
Mais cette idée n’est pas universellement partagée : certains écrivains ont défendu une littérature plus intellectuelle, esthétique ou engagée, sans nécessairement faire de la sensibilité le cœur de leur projet. On peut donc se demander : la littérature a-t-elle pour mission d’éduquer notre sensibilité, ou bien cela ne relève-t-il que d’une fonction parmi d’autres, voire d’un effet secondaire ?
Nous verrons d’abord que la littérature a historiquement pour vocation d’éveiller et d’affiner la sensibilité morale et affective, avant d’envisager que cette fonction peut aussi être relativisée ou contestée, puis de montrer que la véritable force de la littérature tient peut-être à sa capacité de maintenir un lien fécond entre sensibilité, pensée et liberté.
I. La littérature, école de l’émotion et de la compassion
Depuis ses origines, la littérature s’adresse à l’âme autant qu’à l’esprit. L’un de ses objectifs majeurs est d’éveiller la sensibilité, c’est-à-dire de faire éprouver des émotions, mais aussi de former le cœur à des sentiments élevés. Dans l’Antiquité déjà, Aristote soulignait dans sa Poétique que la tragédie permettait, par la peur et la pitié, d’opérer une catharsis, une purification des passions. En éprouvant la souffrance des personnages, le spectateur devenait plus humain, plus lucide face à la douleur des autres.
La littérature sentimentale du XVIIIe siècle illustre parfaitement cette vocation. Dans La Nouvelle Héloïse de Rousseau, les lettres de Julie et de Saint-Preux bouleversent le lecteur par leur intensité émotionnelle. L’objectif de Rousseau n’est pas seulement de raconter une histoire d’amour, mais bien de faire vibrer la sensibilité morale du lecteur, de lui faire ressentir la noblesse du sacrifice, l’injustice du monde, la beauté des élans sincères.
Dans le même esprit, Condorcet, dans le texte étudié en première partie (Cinq mémoires sur l’instruction publique), insiste sur la nécessité d’exercer l’âme des enfants à la pitié, en particulier par l’éducation. Or la littérature est sans doute un des meilleurs outils pour atteindre ce but : en confrontant le lecteur à des situations humaines complexes, elle lui apprend à se mettre à la place d’autrui, à ressentir, à compatir. La pitié, comme le dit Condorcet, est une disposition naturelle, mais fragile. La littérature peut en être le terreau et le tuteur.
Ainsi, de Victor Hugo avec Les Misérables — qui fait pleurer sur les misères de Jean Valjean ou de Cosette — à Primo Levi qui témoigne de l’inhumanité des camps dans Si c’est un homme, la littérature a bel et bien joué un rôle fondamental d’éducation à la sensibilité morale.
II. Une fonction qui ne saurait être exclusive ni imposée à toute forme littéraire
Cependant, il serait réducteur de penser que toute littérature a ou doit avoir cette vocation. Certains écrivains ont revendiqué une conception plus formelle, plus esthétique ou plus critique de la littérature, qui ne se donne pas pour but principal de faire ressentir, mais plutôt de faire penser, de questionner, voire de déranger.
C’est le cas de Flaubert, pour qui l’écrivain ne doit ni juger ni instruire, mais décrire objectivement, dans une quête de perfection formelle. Dans Madame Bovary, il peint avec précision les illusions romantiques et la médiocrité bourgeoise sans chercher à susciter la compassion : Emma meurt dans l’indifférence, et le style l’emporte sur l’émotion. Il ne s’agit pas de former le cœur, mais de créer une œuvre d’art impersonnelle, comme un scientifique construit une hypothèse.
De même, certaines œuvres satiriques ou provocantes, comme celles de Céline ou d’Artaud, choquent volontairement le lecteur, le mettent à distance. La sensibilité y est mise à l’épreuve, voire désacralisée, pour que la littérature reste un lieu de liberté radicale. Même les écrivains engagés comme Sartre n’appellent pas nécessairement à la compassion, mais à la révolte ou à l’action.
Enfin, dans le monde contemporain, où l’ironie, le cynisme et l’absurde sont souvent privilégiés, la littérature peut aussi refuser toute vocation édifiante, considérant que l’art ne doit pas se soumettre à des missions éducatives ou morales. Il y a là une revendication de l’autonomie de la littérature, qui n’est ni école, ni catéchisme, ni leçon de morale.
III. Une éducation à la sensibilité qui inclut aussi la pensée et la lucidité
Mais peut-on vraiment séparer la sensibilité de la pensée ? Même dans les œuvres où l’émotion semble absente, il y a toujours une forme d’engagement humain, une expérience sensible de la complexité du réel. La littérature n’est pas simplement un outil de moralisation, mais un espace où se forment des manières de percevoir, de ressentir, de comprendre.
Prenons l’exemple de Camus dans L’Étranger : l’écriture sèche, distante, presque mécanique, de Meursault, peut sembler insensible. Mais c’est justement cette absence d’émotion qui trouble et interroge : elle nous pousse à réfléchir sur ce qu’est un homme sensible, sur ce que signifie « éprouver » dans une société où tout semble déshumanisé. La littérature n’éduque pas toujours en rassurant ; elle éduque aussi par le doute.
De même, les récits de guerre ou les témoignages de la Shoah, comme ceux de Robert Antelme ou Imre Kertész, ne cherchent pas à attendrir, mais à confronter le lecteur à l’horreur nue, parfois au prix d’une insensibilité apparente. Pourtant, cette confrontation produit une réflexion éthique profonde, un apprentissage de la lucidité, qui est une autre forme de sensibilité.
Enfin, la littérature contemporaine explore souvent les limites de l’émotion, la difficulté de ressentir dans un monde saturé d’images et de discours. Elle peut ainsi former une sensibilité critique, capable de discerner, de résister à la manipulation émotionnelle, de penser l’émotion elle-même.
La littérature a-t-elle pour vocation d’éduquer à la sensibilité ? Oui, dans la mesure où elle éveille en nous l’attention à l’autre, la compassion, la mémoire des souffrances humaines. Mais cette vocation n’est ni exclusive, ni absolue : toute œuvre n’a pas pour but de faire pleurer ou d’émouvoir. Certaines œuvres nous éduquent autrement, par la lucidité, l’ironie, la confrontation, ou même le silence. En définitive, la littérature nous forme à une sensibilité riche, critique et libre, où émotion et pensée se répondent, et où l’humanité peut se dire dans toutes ses nuances.
Vous pouvez aussi consulter les sujets HLP bac 2024 jour 1
- Lecture des sujets en PDF
 Sujets hlp metropole 2024 jour 1 (578.13 Ko)
Sujets hlp metropole 2024 jour 1 (578.13 Ko)- Corrigé officiel
 Spe humanites litterature philo 2024 metropole 1 corrige officiel (119.84 Ko)
Spe humanites litterature philo 2024 metropole 1 corrige officiel (119.84 Ko)
Sujet :
HLP du mercredi 19 juin 2024
- Louis Aragon, Le Roman inachevé (1956)
- Première partie : interprétation littéraire
- Quelles violences ce poème dit-il ?
- Deuxième partie : essai philosophique
- Peut-on perdre son humanité ?
Sujets HLP bac 2025 jour 2
Lecture des sujets en PDF
Sujet :
HLP du mercredi 18 juin 2025
- Je ne sais quelles gens
- Wislawa Szymborska, Vue avec grain de sable, 1996, traduit du polonais par Piotr Kaminski.
- Première partie : interprétation littéraire
- Que dit ce poème des victimes de la guerre ?
- Deuxième partie : essai philosophique
- Peut-on conserver son humanité dans des circonstances qui risquent de nous en dépouiller ?
Corrigé bac 2025 jour 2
- Première partie : interprétation littéraire
- Que dit ce poème des victimes de la guerre ?
« Une mort, c’est une tragédie. Un million de morts, c’est une statistique », disait Staline. Face à la massification de la souffrance en temps de guerre, comment l’art peut-il rendre à chacun un visage ? La poésie, plus que tout autre langage, tente l’impossible : dire les vies qui s’effacent.
Wislawa Szymborska, poétesse polonaise et prix Nobel de littérature, livre dans ce poème une méditation sur les victimes anonymes de la guerre. À travers une langue marquée par l’indétermination et la fragilité, elle donne corps – et presque voix – à ces exilés effacés de l’Histoire.
Comment Szymborska parvient‑elle à dire l’indicible : l’effacement des victimes de la guerre, tout en restituant la charge éthique de leur détresse ?
Annonce du plan
I. L’effacement identitaire : une écriture de l’indéfini
II. Le corps‑à‑corps avec la violence : inscrire la guerre dans le détail sensoriel
III. De l’invisibilité au devoir d’hospitalité : une interpellation du lecteur
I. L’effacement identitaire : une écriture de l’indéfini
1. La prolifération de la formule « je ne sais quel… »
Huit occurrences (v. 1‑4 ; 8 ; 10 ; 12 ; 21 ; 24‑25) forment une litanie ; l’indéfini devient procédé structural. Ainsi, le poème refuse de nommer : « gens », « pays », « tout ». Les victimes s’enfoncent dans l’anonymat.
2. Syntaxe suspendue et blancs sémantiques
L’absence fréquente de verbe conjugué (« Je ne sais quelles gens fuyant… ») gèle l’action dans une durée étale, accentuant la dépersonnalisation. Les enjambements multiplient les vides visuels qui figurent la perte.
3. Effacement des repères spatio‑temporels
Aucun toponyme, aucun repère chronologique ; seuls « le soleil » et « certains nuages » subsistent, réduisant l’univers à un décor générique. La guerre, ainsi dé‑localisée, devient universelle : toute guerre et n’importe quand.
Bilan partiel
L’indéfini n’est pas ignorance mais stratégie : il épouse le point de vue d’une humanité reléguée au hors‑champ de l’Histoire.
II. Le corps‑à‑corps avec la violence : inscrire la guerre dans le détail sensoriel
1. Les reliques du quotidien détruit
Szymborska déroule l’inventaire des petites choses qui faisaient « une vie » : « poules », « chiens », « miroirs ». Ce réalisme miniature rend la perte plus aiguë ; les victimes emportent la mémoire des banalités abandonnées.
2. Oxymore et pesanteur du vide
« Plus ils sont vides et plus ils pèsent lourd » (v. 8) : la formule condense l’expérience paradoxale du réfugié – soulagé de tout, mais écrasé par l’absence. L’oxymore matérialise la détresse psychique.
3. La violence affleurante
Visuelle : la « rivière bizarrement toute rose » (v. 13) – ambiguïté entre reflet crépusculaire et sang dilué.
Sonore : « tirs » réitérés (v. 14) et rotation lancinante de l’« avion » (v. 15) ; la guerre grésille en arrière‑plan, jamais spectaculaire, toujours menaçante.
Bilan partiel
En s’attachant au détail sensoriel, la poète restitue la dimension charnelle de la guerre : c’est le corps des victimes qui encaisse la destruction.
III. De l’invisibilité au devoir d’hospitalité : une interpellation du lecteur
1. Le désir de disparition
Le triple souhait d’« invisibilité », de « grisaillerie caillou », d’« absence » (v. 16‑18) dit l’extrême vulnérabilité : survivre, c’est cesser d’être cible. Le langage frôle l’oxymore de « devenir pierre » pour préserver l’humanité.
2. Futur incertain et modalisations du doute
La série de questions (v. 20‑24) crée un vide théâtral : personne ne répond. Les modalisateurs (« sans doute », « peut‑être ») soulignent l’indécision de ceux qui pourraient porter secours.
3. L’ébauche d’une éthique de l’accueil
Le conditionnel final (« il voudra bien, peut‑être, ne pas être leur ennemi », v. 24‑25) implore un « quelqu’un » indéterminé : lecteur, citoyen, communauté politique. La poésie se fait appel, non à la pitié, mais à la responsabilité.
Bilan partiel
Le texte ne se contente pas de représenter des victimes ; il désigne le vide moral autour d’elles et fait de cette béance la pierre angulaire d’une réflexion philosophique sur l’hospitalité (Levinas, Derrida).
En refusant de nommer, Szymborska produit un poème‑miroir : il reflète toutes les colonnes d’exilés, de l’Antiquité à l’Ukraine, et fait entendre la parole manquante des victimes. L’éphémère d’un « quignon de pain » ou la tragédie d’un « enfant mort » suffisent à rappeler que la guerre ne détruit pas seulement des vies : elle efface jusqu’au droit d’avoir un nom.
Ouverture
On peut prolonger cette lecture en confrontant Szymborska au chapitre XXIV de La Guerre et la Paix de Tolstoï : là encore, la masse anonyme des fuyards questionne le regard du narrateur et la posture morale du lecteur.
Autre ouverture possible :
Ce poème entre en résonance avec l’œuvre du philosophe Emmanuel Levinas, pour qui le visage de l’autre engage immédiatement une responsabilité. Ce n’est qu’en reconnaissant l’Autre comme vulnérable que l’on devient humain – une leçon essentielle à l’heure où les guerres continuent de faire taire ceux qui ne peuvent fuir qu’avec des mots effacés.
- Deuxième partie : essai philosophique
- Peut-on conserver son humanité dans des circonstances qui risquent de nous en dépouiller ?
Face à la brutalité de l’histoire, certains êtres semblent s’être maintenus debout dans l’horreur, tandis que d’autres ont sombré. Les témoignages des camps de concentration, des conflits armés, des génocides, révèlent une question à la fois éthique, existentielle et philosophique : que reste-t-il de l’homme quand les circonstances le plongent dans l’inhumain ?
Définition des termes
« Conserver son humanité » peut s’entendre à plusieurs niveaux : dignité morale, sens de la justice, altérité, langage, pensée — tout ce qui, traditionnellement, distingue l’humain de la bête ou de la machine. Les « circonstances qui risquent de nous en dépouiller » renvoient à des situations extrêmes : guerre, torture, misère, privation de liberté ou de repères. Ces contextes tendent à déshumaniser, c’est-à-dire à faire perdre à l’individu ce qui fait son être humain.
Problématique
L’homme peut-il rester pleinement humain lorsque tout, autour de lui, conspire à l’abaissement, à la violence, à la survie nue ? La faculté de rester humain est-elle une essence, une résistance intérieure, ou une illusion vite dissoute par la souffrance ?
Annonce du plan
Nous verrons que certaines circonstances extrêmes tendent à priver l’homme de ce qui fait sa condition humaine (I), mais que des ressources intérieures et relationnelles peuvent pourtant permettre de préserver une forme d’humanité (II), avant de nous demander si l’humanité ne réside pas dans la capacité même à se poser cette question, à rester vulnérable et responsable, malgré tout (III).
I. L’expérience extrême peut dépouiller l’homme de son humanité
1. La guerre, la survie, l’oubli des valeurs
Dans des situations de guerre ou de terreur, la priorité devient souvent la survie. Primo Levi, dans Si c’est un homme, montre que la faim, la peur, la promiscuité constante conduisent parfois à des comportements de trahison, de mutisme ou de brutalité. L’humain y est réduit à sa condition biologique : il dort, mange, obéit — il vit sans exister pleinement.
2. L’effondrement des repères moraux
Les circonstances extrêmes provoquent l’effondrement de la loi morale, au profit de la loi du plus fort ou de la loi du silence. Dans Les Bienveillantes de Littell, le narrateur montre comment des hommes peuvent participer à l’horreur sans remords, en se déshumanisant eux-mêmes. L’habitude du mal, disait Arendt, rend l’inhumain presque banal.
3. Une aliénation du langage et de la pensée
Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem montre que la déshumanisation passe aussi par la perte du langage réfléchi : ne plus penser par soi-même, ne plus nommer le mal comme tel, c’est déjà sortir de l’humanité. Ainsi, dans certaines circonstances, c’est toute la structure intérieure de l’homme – morale, intellectuelle, affective – qui peut vaciller.
Pourtant, il existe de nombreux exemples d’individus qui, même dans l’horreur, ont conservé leur capacité d’agir moralement, de penser, d’aimer. L’humanité peut-elle ainsi résister à l’inhumain ?
II. Résister à la déshumanisation : des ressources morales, affectives et culturelles
1. La solidarité comme force de résistance
Des récits de guerre ou de camps de concentration témoignent du fait que la solidarité, même minimale, permet de maintenir une forme d’humanité. Donner une couverture, partager un morceau de pain, parler : autant de gestes qui empêchent le repli total sur la survie animale. Viktor Frankl, dans Découvrir un sens à sa vie, montre que ceux qui trouvaient un sens (même fragile) à leur expérience avaient plus de chances de survivre psychiquement.
2. La culture comme rempart à la barbarie
Lire, réciter un poème, se souvenir d’une œuvre d’art, maintenir le lien avec une langue intérieure : tous ces actes sont des résistances symboliques. Des prisonniers politiques ont tenu grâce à la récitation intérieure de Racine, des chants, ou des souvenirs d’enfance. La culture, en tant que mémoire de l’humain, offre un refuge contre l’anéantissement.
3. La fidélité à une exigence intérieure
Conserver son humanité, c’est aussi rester fidèle à ce que Kant appelait la « loi morale en nous ». Même dans l’effondrement, certains refusent de devenir bourreaux ou complices, au nom d’une exigence éthique fondamentale. Le héros tragique, chez Camus (L’Homme révolté), est celui qui dit « non » : non à l’injustice, non à la cruauté, même au prix de sa vie.
Mais cette résistance ne suppose-t-elle pas une conception renouvelée de l’humanité ? Peut-être n’est-ce pas l’absence de souffrance qui fait l’homme, mais sa capacité à demeurer vulnérable, à ne pas céder à l’inhumanité autour de lui.
III. L’humanité comme capacité à rester responsable et vulnérable
1. L’humanité est peut-être ce qui ne se laisse pas entièrement détruire
L’humanité, au sens le plus profond, n’est pas une donnée naturelle, mais une tâche morale. Elle se manifeste quand l’homme refuse de se laisser entièrement transformer par le mal. La philosophe Cynthia Fleury parle d’« éthique de la dignité » : même dépouillé, un être humain peut encore dire « je suis là », et regarder l’autre comme un semblable.
2. La vulnérabilité comme condition de l’humain
Loin d’être une faiblesse, la vulnérabilité est ce qui fonde l’humanité. Emmanuel Levinas rappelle que c’est dans le visage de l’autre, dans sa nudité, que l’homme prend conscience de sa propre humanité : c’est parce que je peux être blessé que je peux comprendre la blessure de l’autre. Même au plus bas, le regard échangé peut préserver ce lien fragile.
3. Se poser la question, c’est déjà résister
Enfin, la simple capacité de s’interroger sur l’humanité, comme le fait ce sujet, est déjà un acte d’humanité. Celui qui doute, qui s’inquiète de perdre son humanité, la conserve encore. Le poème de Szymborska, dans sa pudeur et son tremblement, est lui-même un acte de résistance poétique à l’oubli et à la déshumanisation.
Les circonstances extrêmes peuvent détruire les corps, les repères et les liens. Mais elles ne suffisent pas toujours à faire taire l’humain : une parole, une main tendue, une pensée libre peuvent suffire à préserver une dignité, une altérité, un reste de lumière. L’humanité n’est pas un fait acquis, mais un choix sans cesse renouvelé.
Alors que les conflits contemporains déplacent des millions d’hommes et de femmes, la question posée par ce sujet ne relève pas seulement de la philosophie, mais de la politique : saurons-nous reconnaître, en l’autre déraciné ou abîmé, notre propre humanité en partage ?
Vous pouvez aussi consulter les sujets HLP bac 2024 jour 2
- Télécharger le sujet PDF
 Sujet hlp victor hugo ruy blas jour 2 bac 2024 (569.68 Ko)
Sujet hlp victor hugo ruy blas jour 2 bac 2024 (569.68 Ko)- Corrigé officiel
 Spe humanites litterature philo 2024 metropole 2 corrige officiel (120.51 Ko)
Spe humanites litterature philo 2024 metropole 2 corrige officiel (120.51 Ko)
- Sujet :
- Victor Hugo, Ruy Blas (1838), Acte III, Scène troisième, v.1184-1228.
- Première partie : interprétation littéraire
- Comment se manifeste le sentiment amoureux dans cette scène de théâtre ?
- Deuxième partie : essai philosophique
- Que gagne l’amour à être déclaré ?
Centres étrangers Amérique du nord
Epreuve : Spécialité - Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)
Niveau d'études : Terminale
Année : 2025
Jour 1 : mercredi 21 mai
Jour 2 : jeudi 22 mai
Session : Normale
Centre d'examen : centres étrangers. Amérique du nord
Sujets HLP bac 2025 jour 1
Lecture des sujets en PDF
Corrigé officiel
- Consultez le corrigé bac
Sujet :
HLP du mercredi 21 mai 2025
Extrait de Claire Marin, Rupture(s), 2019.
Quand le sujet est convoqué, capté, ravi par le plus fort que lui – la passion, la souffrance –, quand il est ainsi dépossédé et redéfini par une force supérieure à la sienne – l'amour, la douleur, le chagrin –, il ne peut plus se contenter d'être simplement celui qu'il a été jusqu'alors.
Interprétation philosophique :
Comment ce texte aborde-t-il la métamorphose du sujet pour lui-même et pour les autres ?
Essai littéraire :
La littérature et les arts peuvent-ils saisir le moi sans le figer ?
Corrigé bac 2025 jour 1
- Première partie : Interprétation philosophique
- Comment ce texte aborde-t-il la métamorphose du sujet pour lui-même et pour les autres ?
Dans Rupture(s), Claire Marin s’interroge sur ce que devient le sujet lorsqu’il est bouleversé par un événement plus fort que lui – un de ces moments de crise où il ne peut plus “tenir son rôle”. À travers un style sensible et rigoureux, elle aborde la métamorphose existentielle comme un processus aussi violent qu’inévitable, à la fois pour soi et pour les autres. Le texte met en évidence la rupture entre l’identité que l’on croyait sienne et celle que les circonstances imposent soudainement, dans un basculement qui interroge la permanence du moi.
Nous verrons comment cette métamorphose est vécue par le sujet lui-même, dans une perte et une recréation de soi, puis comment elle affecte le regard et la compréhension qu’autrui porte sur lui.
Claire Marin décrit d’abord une transformation radicale qui survient lorsque le sujet est saisi par une force plus grande que lui : amour, douleur, maladie, grossesse, etc. Ce sont des expériences limites qui échappent à la volonté et qui arrachent le sujet à son ancienne identité. « Il ne peut plus se contenter d’être simplement celui qu’il a été jusqu’alors » : c’est donc une crise de l’identité, où le moi ancien devient intenable. Cette métamorphose est violente, car elle est subie et déstabilisante. Le sujet devient un étranger pour lui-même, traversé par la question : “Puis-je vraiment réussir à le laisser s’éloigner de lui-même ?”
Ce passage révèle une tension entre attachement à soi et nécessité du changement. Le sujet cherche à retenir le passé, à conserver ses engagements, sa mémoire, ses émotions. Mais cette tentative est vouée à l’échec : ce n’est plus possible d’“habiter” l’ancien soi. Le texte affirme alors que la métamorphose est une condition de survie : “Il lui faut devenir quelqu’un d’autre pour sauver sa peau.”
La transformation du sujet ne concerne pas que lui-même : elle perturbe aussi son entourage. Claire Marin insiste sur la “violence de la métamorphose pour les proches”. Le sujet qui change devient étranger aux yeux de ceux qui l’aimaient ou croyaient le connaître. Le texte liste des situations poignantes : un adolescent qui se convertit, une femme qui quitte son mari, un frère qui s’engage politiquement… autant de figures de rupture qui brisent les repères affectifs. L’autre devient méconnaissable.
La référence à Kafka (Gregor devenu cafard dans La Métamorphose) renforce cette image : la transformation du sujet est si radicale qu’elle provoque un effondrement du lien, une incapacité d’autrui à le reconnaître. Ce bouleversement révèle une illusion partagée : croire que l’autre nous appartient, qu’il est stable, transparent. Or, dit Marin, l’être aimé “ne m’appartient pas” ; il peut toujours devenir autre, être “une inquiétante étrangeté”.
Ce texte de Claire Marin présente la métamorphose non comme un choix libre, mais comme une nécessité vitale, née d’un événement qui dépasse le sujet. Elle montre que cette transformation provoque une rupture intérieure mais aussi une crise relationnelle. Le moi se défait, se reconstruit, mais dans l’angoisse et l’incompréhension. L’identité humaine apparaît ainsi comme fragile, instable, toujours susceptible de basculer, pour soi comme pour les autres.
- Essai littéraire :
- La littérature et les arts peuvent-ils saisir le moi sans le figer ?
La littérature et les arts ont toujours cherché à représenter le moi : ses émotions, ses évolutions, ses contradictions. Pourtant, représenter le moi suppose souvent de le fixer dans une forme, un récit, une image. Dès lors, une tension apparaît : comment saisir ce qui est mobile, vivant, mouvant, sans en trahir la complexité ? La question revient à se demander si la littérature et les arts peuvent capter la singularité du moi sans le réduire à un cliché ou à une identité figée.
Nous verrons d’abord que la représentation artistique semble impliquer un certain figement du moi, avant de montrer que certaines formes artistiques permettent au contraire de rendre compte de sa fluidité.
Toute œuvre impose une certaine structuration : un cadre, un style, un point de vue. Que ce soit dans un roman, un autoportrait, une biographie ou une pièce de théâtre, le moi y apparaît souvent comme un personnage identifiable, traversé par des traits récurrents ou des événements clés. Cette tendance peut conduire à une reconstruction artificielle de soi, voire à une image figée.
Dans les autobiographies classiques, par exemple (Rousseau, Chateaubriand), l’auteur tend à relier les étapes de sa vie dans un récit cohérent, comme si le moi avait toujours été le même au fond. Ce processus produit une illusion d’unité, alors que l’existence est souvent marquée par des ruptures, des contradictions, des oublis. L’écriture semble alors stabiliser ce qui est par nature instable.
Cependant, de nombreuses œuvres cherchent à rendre compte du moi dans sa fluidité, son devenir, ses métamorphoses. Le roman proustien (À la recherche du temps perdu) explore un moi changeant, insaisissable, qui se transforme à travers le souvenir, le désir, la jalousie. La mémoire involontaire, par exemple, révèle un moi inconscient, enfoui, qui échappe au contrôle rationnel.
L’autofiction contemporaine (Annie Ernaux, Christine Angot, Camille Laurens) tente aussi de dire la vérité du moi sans l’idéaliser : elle met en scène les blessures, les zones d’ombre, les contradictions. Le moi y est souvent instable, marqué par la honte, la culpabilité, l’effondrement.
Dans les arts visuels, des artistes comme Cindy Sherman ou Sophie Calle déconstruisent le moi en jouant sur les identités multiples, les masques, les rôles. En danse ou en musique, le corps ou le son deviennent des moyens d’exprimer l’instantané, l’émotion brute, sans fixer définitivement une identité.
Ces formes artistiques refusent la clôture, et rendent hommage à ce que le moi a de fuyant, de fragmentaire, d’ouvert.
Si la littérature et les arts ont parfois figé le moi dans des représentations stables, ils sont aussi les lieux où sa profonde instabilité peut être pensée, vécue, représentée. Bien loin de figer l’identité, ils révèlent sa complexité, sa pluralité, son caractère évolutif. En ce sens, la littérature et les arts sont capables non seulement de saisir le moi, mais aussi de le faire apparaître comme ce qu’il est peut-être fondamentalement : un devenir, et non un être.
Vous pouvez aussi consulter les sujets HLP bac 2024 jour 1
Sujets HLP bac 2024 jour 1
Lecture des sujets en PDF
 Hlp 2024 jour 1 Amérique du nord (386.51 Ko)
Hlp 2024 jour 1 Amérique du nord (386.51 Ko)
Corrigé bac
Sujet :
- Anna DE NOAILLES, Le cœur innombrable, « La vie profonde » (1901)
- Première partie : interprétation littéraire
- En quoi ce poème exprime-t-il une présence sensible au monde ?
- Deuxième partie : essai philosophique
- Selon vous, la nature est-elle le seul moyen d’éveiller notre sensibilité ?
Sujets HLP bac 2025 jour 2
Lecture des sujets en PDF
Corrigé officiel
- Consultez le corrigé bac
Lecture du texte
Le dernier volume de la trilogie Auschwitz et après, écrit en 1970, évoque le retour des
survivantes et des survivants des camps, dont l'autrice Charlotte Delbo a fait partie.
Rentrer du camp rentrer dans le rang
après l'histoire
le tous les jours
après le maquis(1)
5
le traintrain de la vie.
Nous disions
que la vie sera belle quand elle sera libre
que la vie sera ardente quand nous serons libres
tout sera simple
10
transparent
tout nous sera rendu avec la liberté
la beauté l'amour l'amitié
tout
la liberté
15
c'est tout
il n'y aura qu'à vivre
quoi de plus simple
de plus facile
à celui qui sait souffrir
20
à celui qui sait mourir ?
Rentrer
Qui de nous osait penser plus loin ?
Rentrer
c'était déjà demander l'impossible
25
c'était tout demander
oserait-on demander davantage?
Rentrer
tout nous serait rendu.
Revenir, ce n’est pas tout
c’est revenir pour se remettre à vivre
30
à vivre le tous les jours
à travailler et à faire des dettes
à faire des économies pour payer ses dettes
à vendre du savon
parce qu’on ne sait pas faire autre chose
35
à retourner au bureau
parce qu'on ne sait pas faire autre chose
dans la vie de tous les jours
à chercher un logement
40
parce qu'on ne peut pas vivre autrement
à être à l'heure
parce qu'au travail il faut être à l'heure.
De quoi vous plaignez-vous
45
la vie c'est la vie
de quoi rêviez-vous dans votre là-bas ?
De manger à votre faim
de dormir à votre sommeil
d'aimer à votre amour
50
À manger à dormir à aimer
vous l'avez
depuis que vous êtes rentrés.
L'histoire
c'est fini
55
soyez heureux comme tout le monde
l'histoire
c'est un moment
maintenant
c'est la vie.
60
Et pourquoi donc vouliez-vous revenir ?
Sortir de l'histoire
pour entrer dans la vie
essayez donc vous autres et vous verrez.
Charlotte DELBO, Mesure de nos jours (1971)
(1)
Maquis : lieu où se réunissaient les résistants à l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
HLP du 22 mai 2025, jour 2
Première partie : interprétation littéraire
Comment l’autrice exprime-t-elle ici l’impossible retour à la vie après avoir subi laviolence de l’histoire?
Deuxième partie : essai philosophique
Suffit-il de ne plus subir la violence pour y échapper
Corrigé bac 2025 jour 2
- Première partie : interprétation littéraire
- Comment l’autrice exprime-t-elle ici l’impossible retour à la vie après avoir subi la violence de l’Histoire ?
Dans ce texte extrait de Mesure de nos jours (1971), Charlotte Delbo, rescapée des camps de concentration, livre une réflexion poignante sur le retour à la vie ordinaire après l’expérience de la déportation. Elle interroge avec lucidité et douleur la possibilité de "rentrer dans la vie", après avoir été confrontée à la violence absolue de l’Histoire. À travers une écriture fragmentée, sobre et incantatoire, elle exprime l'impossible retour à une normalité qui n’en est plus une pour celles et ceux qui ont survécu.
1. Le rêve du retour comme illusion vitale
Le début du texte évoque les espoirs nourris durant la guerre et la déportation : "Nous disions / que la vie sera belle quand elle sera libre". L’autrice rapporte les paroles de celles et ceux qui rêvaient d’un après lumineux, intense, simple : "la beauté, l’amour, l’amitié". Cette attente de liberté prend une forme quasi mystique, comme en témoignent les répétitions ("tout", "la liberté", "c’est tout") et la syntaxe réduite à l’essentiel. Cette économie de moyens traduit une parole intérieure, chargée d’espoir vital.
Mais ce rêve, fondé sur l’idée d’un retour possible à la vie, s’effondre dès que cette vie redevient concrète. La phrase "Rentrer / c’était déjà demander l’impossible" marque une rupture. L'espoir d’un retour devient un vœu irréalisable, tant le lien entre l’avant et l’après a été rompu.
2. Une vie ordinaire devenue absurde et aliénante
À mesure que le texte avance, l’énumération des tâches du quotidien ("travailler", "payer ses dettes", "vendre du savon", "chercher un logement") fait basculer le ton dans une forme d’ironie tragique. Le retour à la vie, loin d’être une libération, apparaît comme une prison nouvelle, faite d’absurdité et de mécanismes sociaux rigides.
L’usage de l’anaphore "parce qu’on ne sait pas faire autre chose" souligne l’enfermement dans une routine que les survivants n’ont ni choisie ni désirée. L’autrice montre que ces tâches sont non seulement banales, mais surtout déconnectées de l’expérience vécue, comme si l’Histoire était niée, effacée par les impératifs du quotidien.
3. L’incompréhension du monde et la solitude du survivant
L’autrice met aussi en lumière l’incompréhension du reste de la société : "De quoi vous plaignez-vous ?", "soyez heureux comme tout le monde". Cette injonction à "passer à autre chose" révèle l’incapacité du monde ordinaire à entendre l’expérience extrême. Le survivant se retrouve seul, étranglé par la banalité du quotidien et l’indifférence générale.
Les dernières lignes, d’une ironie cinglante — "Pourquoi donc vouliez-vous revenir ?" —, soulignent la cruauté d’une société qui refuse d’accueillir les rescapés dans leur complexité, leur mémoire, leur fragilité. "Sortir de l’histoire / pour entrer dans la vie" : la formule finale condense le paradoxe central du texte. Revenir n’est pas revenir à la vie, mais être condamné à errer dans un monde sans mémoire.
Par la simplicité apparente de sa langue, ses répétitions, ses ruptures de rythme, Charlotte Delbo parvient à dire l’indicible : l’impossible retour à la vie après la violence absolue. Ce texte ne cherche pas à raconter, mais à faire ressentir la fracture intime entre l’avant et l’après, entre ceux qui savent et ceux qui ignorent. L’écriture elle-même, dépouillée, trouée, fragmentée, devient l’écho de cette impossibilité.
- Deuxième partie : essai philosophique
- Suffit-il de ne plus subir la violence pour y échapper ?
L’arrêt d’une violence ne signifie pas nécessairement la fin de ses effets. Que ce soit dans les contextes historiques, politiques ou personnels, la violence laisse des traces, visibles ou invisibles. Dès lors, peut-on dire qu’il suffit de ne plus subir la violence pour en être libéré ? Ou faut-il reconnaître que certaines violences, une fois vécues, continuent à habiter les individus bien au-delà de leur terme apparent ?
Nous verrons que cesser de subir la violence ne suffit pas toujours pour y échapper, car ses conséquences sont profondes, durables, parfois indélébiles. Toutefois, sous certaines conditions, il est possible de reconstruire une forme de liberté intérieure.
I. La fin de la violence physique n’efface pas la violence psychique
Subir la violence, c’est être privé de sa liberté, de son intégrité physique ou morale. Lorsque cette violence cesse, l’individu est en apparence libre. Mais cette libération n'est pas totale, car les effets de la violence perdurent dans la mémoire, dans le corps, dans la subjectivité.
Les témoignages des survivants de conflits, de génocides ou de tortures — comme Charlotte Delbo dans le texte étudié — montrent bien que le traumatisme s’inscrit dans le temps long. Le retour à la vie normale, même en l’absence de violence directe, n’efface pas ce qui a été vécu. La personne reste marquée, hantée. L’arrêt de la violence ne signifie donc pas l’évasion de son emprise psychique.
II. L’environnement social peut réactiver ou prolonger la violence
Même quand la violence directe cesse, l’attitude de la société peut entretenir une forme de violence symbolique ou morale. L’indifférence, l’injonction à "oublier", à "passer à autre chose", comme dans le texte de Delbo, peuvent faire revivre le sentiment d’abandon, d’incompréhension, voire d’humiliation.
De nombreux rescapés de catastrophes ou d’oppressions dénoncent la "seconde violence" : celle du silence collectif, de l’oubli institutionnalisé. C’est pourquoi échapper à la violence suppose aussi un environnement favorable, capable d’écouter, de reconnaître, de réparer symboliquement.
III. Peut-on vraiment échapper à la violence ? Une question de résilience et de reconstruction
Si la violence laisse des traces, elle ne condamne pas forcément à l’immobilisme ou au désespoir. Des philosophes comme Viktor Frankl, lui aussi rescapé des camps, ont montré qu’il était parfois possible de redonner un sens à la souffrance, de reconstruire une vie digne malgré la blessure.
Échapper à la violence, ce n’est donc pas seulement ne plus la subir, c’est la dépasser intérieurement, en l’intégrant à son histoire, sans en être prisonnier. Cela nécessite un travail sur soi, mais aussi le soutien de la communauté, de la mémoire collective, de la culture.
Il ne suffit donc pas de ne plus subir la violence pour y échapper : la mémoire, les séquelles physiques et psychiques, le regard des autres, continuent souvent à enfermer l’individu. Cependant, une fois la violence terminée, un chemin de libération est possible, fondé sur la reconnaissance, la parole, et la capacité humaine à reconstruire du sens. L’évasion de la violence est alors moins un événement qu’un processus, lent, fragile, mais nécessaire.
Sujet secours, jour 2
- jeudi 22 mai 2025
- HLP Amérique du nord 2025
- Lecture du sujet
- Sujet secours jour 2
Alain, Éléments de philosophie, 1941.
Tout change en moi sous mon regard et par mon regard. Et l'on voudrait maintenant expliquer comment je me saisis et comment je me reconnais, en ce contenu où le rêve le plus absurde peut rester attaché aux perceptions les plus raisonnables, où la superstition résiste autant que les idées, où tant de souvenirs sont oubliés, tant d'autres décolorés, où tout change enfin par le temps et l'âge.
- Interprétation philosophique :
- D'après ce texte, pourquoi le moi, malgré ses métamorphoses, ne peut-il pas se perdre lui-même ?
- Essai littéraire :
- Que nous apprennent la littérature et les arts sur la complexité du moi ?
Corrigé bac du sujet secours
- Interprétation philosophique :
- D'après ce texte, pourquoi le moi, malgré ses métamorphoses, ne peut-il pas se perdre lui-même ?
Dans cet extrait des Éléments de philosophie (1941), le philosophe Alain s’interroge sur la nature du Moi, sur sa permanence à travers le changement, et sur le lien entre le Moi et la pensée. Il constate que tout change en nous : les perceptions, les souvenirs, les sentiments. Pourtant, il affirme que le Moi, en dépit de ses métamorphoses, ne peut jamais se perdre lui-même. Comment comprendre cette affirmation paradoxale ? Pourquoi le Moi demeure-t-il inchangé alors qu’il traverse des états si différents ? Nous verrons que, pour Alain, le Moi ne peut se perdre car il est toujours le sujet de la pensée, même dans la confusion ou le doute, et qu’il constitue le fondement de toute expérience vécue.
Tout d’abord, Alain souligne la nature changeante du Moi : il est traversé par des souvenirs qui s’effacent, des sentiments contradictoires, des perceptions instables. Le Moi semble donc multiple, incertain, insaisissable. Pourtant, à travers cette instabilité, un élément demeure constant : le fait que le Moi est toujours présent en tant que sujet de la pensée. Quelle que soit l’idée ou l’émotion qui me traverse, c’est toujours « moi » qui la ressens ou la pense. Le philosophe écrit ainsi : « Toute pensée, confuse ou claire […] a pour sujet constant le Moi, ou pour mieux parler le Je. » Même dans les moments de doute, de rêve ou d’illusion, c’est encore un sujet pensant, un Je, qui est à l’œuvre.
Alain rejoint ici une thèse cartésienne : on ne peut pas penser que l’on n’existe pas, car penser suppose toujours un sujet qui pense. C’est pourquoi il affirme qu’« on ne peut penser que "je ne suis pas" ». Même l’hypothèse de la disparition ou de l’absence du Moi est impensable, car le Moi serait encore présent pour formuler cette pensée. Cette idée fait du Moi le fondement logique de toute connaissance et de toute représentation. Toute expérience, qu’elle soit réelle ou imaginaire, passe par lui et ne peut s’en détacher.
Enfin, Alain montre que le Moi ne peut être divisé sans contradiction. Lorsqu’il se dédouble, lorsqu’il se pense « tel » puis « autre », c’est toujours lui-même qui pense cette différence. Il écrit : « Je reste le même ; car si je suis tel, et puis autre, c’est toujours moi qui suis autre. » Ainsi, le Moi n’est pas une substance figée, mais un point de vue permanent sur le monde et sur lui-même, une unité dynamique qui se reconnaît dans la diversité de ses états. C’est pourquoi il ne peut jamais véritablement se perdre.
En définitive, bien que le Moi change d’état, d’humeur, de pensée, il demeure toujours le sujet de toute expérience. Il ne peut se perdre, car il est la condition même de la pensée : on ne peut penser sans que le Moi soit présent pour penser. Cette constance fait de lui un repère fondamental, une présence continue au cœur même de la diversité de notre vie intérieure.
Cette réflexion d’Alain pourrait être mise en regard avec d’autres conceptions du Moi, notamment celle du philosophe David Hume, pour qui le Moi n’est qu’un faisceau de perceptions sans réelle unité. Alors que pour Alain, le Moi est une exigence de toute pensée cohérente, certains philosophes modernes ou bouddhistes, par exemple, envisagent l’illusion d’un soi permanent, soulignant davantage la discontinuité de l’expérience subjective.
- Essai littéraire :
- Que nous apprennent la littérature et les arts sur la complexité du moi ?
Depuis toujours, la littérature et les arts s’attachent à explorer l’intériorité humaine. Poètes, romanciers, dramaturges, peintres ou cinéastes ont tenté de percer le mystère du Moi, cette conscience que l’on a de soi-même. Or, le Moi n’est pas une réalité simple ni figée : il est mouvant, fragmenté, parfois contradictoire. À travers les œuvres, nous découvrons que l’identité personnelle n’est ni stable ni transparente. Ainsi, en quoi la littérature et les arts nous permettent-ils de mieux comprendre la complexité du Moi ? Nous verrons que ces domaines expriment d’abord la pluralité du Moi, qu’ils en révèlent ensuite les fractures et les contradictions, et qu’enfin ils offrent parfois un moyen de recomposer ou de transcender cette complexité.
I. La littérature et les arts révèlent un Moi pluriel
Dès l’Antiquité, les écrivains ont compris que l’identité ne se réduit pas à une définition unique. Le théâtre, par exemple, met en scène des personnages qui jouent des rôles différents selon les situations, comme dans Le Menteur de Corneille, où le héros se perd dans ses mensonges au point de ne plus savoir qui il est. De même, le roman moderne, à partir de l’époque romantique, insiste sur l’inconstance du Moi : Les Confessions de Rousseau montrent un Moi à la fois sincère et contradictoire, tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de se justifier.
En peinture, les autoportraits – de Rembrandt à Frida Kahlo – expriment cette diversité du Moi : chaque tableau offre une facette différente de l’artiste, selon son âge, son état d’âme, sa vision du monde. Les arts nous montrent ainsi que le Moi n’est jamais uniforme, mais composé de multiples couches, de masques, d’émotions changeantes.
II. Le Moi est aussi marqué par la faille, le doute et la souffrance
La littérature explore souvent les zones d’ombre du Moi, ses déchirures et ses paradoxes. Dans L’Attrape-cœurs de Salinger, Holden Caulfield est un adolescent en crise, incapable de s’identifier aux normes sociales, errant entre révolte et mélancolie. Il incarne ce Moi fragile, instable, qui ne sait plus à quoi se raccrocher. De même, dans la poésie moderne – chez Baudelaire ou Aragon – le Moi est souvent déchiré entre des élans contraires : aspiration au sublime et chute dans le désespoir, comme dans Les Fleurs du Mal.
Les arts visuels traduisent aussi cette souffrance identitaire. Le surréalisme, par exemple, avec les œuvres de Salvador Dalí, donne forme à l’inconscient, au rêve, au trouble. Ce que la pensée rationnelle ne peut exprimer clairement, les images le traduisent : visages fondants, corps morcelés, espaces irréels… autant de représentations du Moi éclaté.
III. Mais la littérature et les arts peuvent aussi aider à comprendre ou reconstruire le Moi
Face à cette complexité, les œuvres offrent parfois un moyen de mise en ordre, voire de réconciliation avec soi-même. L’écriture autobiographique en est un exemple : elle permet à l’auteur de relier les différentes étapes de son existence, de donner du sens à ce qui semblait chaotique. Dans Sido, Colette se remémore son enfance pour mieux saisir les racines de sa personnalité d’adulte, transformant la mémoire en poésie et en compréhension de soi.
En musique, en danse, dans l’art contemporain, la création devient parfois un exutoire : une manière de dire ce qui est indicible, de sublimer la douleur. L’art peut ainsi être un miroir du Moi, mais aussi un outil de connaissance de soi, voire de transformation intérieure. En ce sens, il ne se contente pas de révéler la complexité du Moi : il nous aide aussi à l’accepter, voire à en faire une richesse.
Loin d’apporter des réponses simples, la littérature et les arts nous apprennent que le Moi est une réalité mouvante, fragmentée, parfois obscure. Ils donnent voix à cette complexité, tantôt en la mettant en scène, tantôt en la questionnant, tantôt en la dépassant. En cela, ils nous invitent non seulement à mieux nous connaître, mais aussi à accueillir en nous cette multiplicité qui fait toute la profondeur de l’expérience humaine.
On pourrait prolonger cette réflexion en s’interrogeant sur la manière dont les nouvelles formes artistiques – comme les réseaux sociaux ou les intelligences artificielles créatives – transforment aujourd’hui notre rapport au Moi : ne tendons-nous pas désormais à fabriquer une image de soi plus qu’à la découvrir ?
Vous pouvez aussi consulter les sujets HLP bac 2024 jour 2
Lecture des sujets en PDF
![]() HLP 2024 Amérique du nord jour 2 (385.1 Ko)
HLP 2024 Amérique du nord jour 2 (385.1 Ko)
Sujet :
- Friedrich NIETZSCHE, Le Gai Savoir (1882)
- Première partie : interprétation philosophique
- Comment l’auteur défend-il dans ce texte « le nouveau », contre l’opinion commune ?
- Deuxième partie : essai littéraire
- Selon vous, le « goût du neuf, du risqué, de l’inessayé » suffit-il à définir le rôle de l’écrivain ou de l’artiste ?
Centres étrangers Afrique
Epreuve : Spécialité - Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)
Niveau d'études : Terminale
Année : 2025
Jour 1 : jeudi 12 juin
Jour 2 : vendredi 13 juin
Session : Normale
Sujets HLP bac 2025 jour 1
Lecture des sujets en PDF
- Extrait de Marie d'Agoult, Premières années (1877).
- Marie d'Agoult, future grande écrivaine, voyageuse, musicienne, découvre, adolescente, le plaisir de la lecture.
- Interprétation littéraire :
- Comment la narratrice décrit-elle dans cet extrait le plaisir de la lecture ?
- Essai philosophique :
- L'interdit est-il essentiel à toute éducation ?
Vous pouvez aussi consulter les sujets HLP bac 2024 jour 1
Sujets HLP bac 2024 jour 1
Corrigé officiel
- Sujet :
- VOLTAIRE, L’Éducation des filles (1761)
- Première partie : interprétation littéraire
- Quel idéal d’éducation féminine le personnage de Sophronie incarne-t-il ?
- Deuxième partie : essai philosophique
- Selon vous, toute éducation est-elle émancipatrice ?
Corrigé bac 2025 jour 1
Texte : Marie d’Agoult, Premières années (1877)
Sujet : Comment la narratrice décrit-elle dans cet extrait le plaisir de la lecture ?
Dans ses Premières années, l’écrivaine Marie d’Agoult revient sur ses souvenirs d’enfance et évoque un épisode marquant : la découverte clandestine de la lecture dans une bibliothèque familiale. Loin d’être une simple activité scolaire, la lecture devient ici un plaisir intense, mêlé de transgression, de fascination et de liberté.
On peut alors se demander comment la narratrice rend compte du plaisir de la lecture dans cet extrait autobiographique.
Nous verrons que ce plaisir se manifeste d’abord comme une expérience secrète et presque interdite, puis comme une aventure sensorielle et intellectuelle captivante, avant de devenir un moteur de construction intérieure et de mémoire durable.
I. Le plaisir de la lecture comme transgression discrète
Une situation de départ ambiguë
Dès le début, l’armoire à livres se présente comme un objet à la fois accessible et mystérieux. Sa description minutieuse (placard grillagé, doublé de soie verte fanée) lui confère une aura presque sacrée. Bien que « jamais » on ne lui ait interdit l’accès, la narratrice ressent instinctivement qu’il y a là quelque chose de défendu.
Le plaisir naît alors d’une tension entre curiosité et culpabilité.
Une mise en scène du vol ou de l’interdit
Le comportement de l’adolescente rappelle celui d’un personnage de roman d’aventure : elle agit en cachette, surveille les bruits, dissimule ses gestes, se cache derrière ses cahiers. Le récit est dynamique, plein de suspense.
Le plaisir de la lecture se construit dans le frisson de la transgression, comme un jeu dangereux et délicieux.
Une stratégie d’évitement
La narratrice invente des ruses pour masquer son activité : elle « trempe sa plume dans l’encre », elle « écrit » sur l’Assyrie tout en pensant à autre chose. Cela crée un double jeu, entre le monde de l’obligation scolaire et celui, bien plus attirant, des romans.
II. Un plaisir sensoriel et intellectuel intense
L’attrait du livre-objet
La narratrice souligne la beauté physique des livres : « petits formats très variés », « joliment reliés ». Elle choisit « le plus petit, le plus joli » – preuve que le plaisir de la lecture commence par le contact avec l’objet-livre.
La lecture est d’abord une séduction visuelle et tactile.
Le contenu : un monde fascinant
Elle découvre d’abord Le Diable amoureux de Cazotte, puis lit des romancières comme Mme Cottin ou Ann Radcliffe. Ces œuvres, souvent sentimentales ou gothiques, nourrissent son imagination et l’émotion.
Le plaisir est aussi intellectuel et romanesque : l’adolescente se laisse emporter par les aventures et les sentiments.
L’expérience physique de la lecture
Le texte insiste sur la gestuelle corporelle de la jeune fille : oreilles aux aguets, jambes prêtes à fuir, rapidité des gestes. L’émotion est si forte qu’elle devient physique, presque comparable à celle d’un amour secret ou d’un interdit amoureux.
III. Un plaisir formateur et durable
Une activité fondatrice
La lecture clandestine devient peu à peu une habitude (« je lus pendant toute une saison une infinité de romans »). Cette activité, répétée, forme peu à peu son esprit et son imaginaire.
Le plaisir ne se réduit pas à l’instant : il façonne la personnalité.
Une mémoire vivante
Même privée des livres, la narratrice conserve dans sa mémoire les titres, les images, les noms, les émotions. Ce plaisir laisse une trace durable : il nourrit l’imaginaire, la sensibilité et la culture de l’adolescente.
La lecture devient un réservoir intime, une source à laquelle elle pourra toujours puiser.
Une vocation d’écrivaine en germe
Ce souvenir est raconté bien des années plus tard, avec humour, tendresse et lucidité. On devine que cette première passion pour les livres a contribué à faire de Marie d’Agoult une écrivaine. La lecture clandestine devient ainsi le point de départ d’un parcours intellectuel et artistique.
La narratrice décrit le plaisir de la lecture comme une expérience d’abord secrète et transgressive, puis profondément enrichissante. Ce plaisir mêle les sens, l’émotion, l’imaginaire et laisse une empreinte durable dans la mémoire. La lecture devient un chemin de liberté intérieure, qui forge la jeune fille et l’oriente vers l’écriture.
L’interdit est-il essentiel à toute éducation ?
L’éducation vise à former les êtres humains, à développer leur intelligence, leur sens moral, leur capacité à vivre en société. Mais peut-elle se faire sans limites ? Faut-il, pour bien éduquer, poser des interdits, c’est-à-dire marquer ce qui est défendu, ce qui ne se fait pas, ce qui est dangereux ou nuisible ? L’interdit semble alors une balise nécessaire à la construction de l’individu.
Pourtant, on pourrait aussi penser qu’une éducation trop marquée par l’interdit risque d’étouffer la liberté, la curiosité ou la créativité de l’élève. Il s’agit donc de se demander : l’interdit est-il une condition nécessaire de toute éducation, ou peut-on apprendre et se former sans passer par lui ?
Nous verrons que l’interdit joue un rôle fondateur dans l’éducation, mais qu’il doit s’articuler avec la liberté, et se transformer peu à peu en autonomie morale.
I. L’interdit est un repère nécessaire dans l’éducation
L’enfant a besoin de limites pour se structurer
Le psychologue et pédagogue Jean Piaget montre que l’enfant construit sa pensée et sa conscience morale en intégrant des règles. Les interdits l’aident à distinguer le bien du mal, le possible de l’impossible, le permis du défendu.
L’interdit n’est pas seulement une contrainte extérieure, il est un repère qui structure l’individu en formation.
L’interdit protège et encadre
Dans toute société, l’éducation commence par des interdits protecteurs : « tu ne dois pas frapper », « tu ne dois pas mentir », « tu ne dois pas te mettre en danger ». Ces interdits initiaux préservent l’enfant de lui-même et des autres.
On peut penser ici à l’interdit du meurtre dans Discours de la servitude volontaire de La Boétie : la société repose sur une base commune de lois implicites. Sans un minimum d’interdits, c’est la violence qui domine.
Exemple littéraire : Gargantua de Rabelais
Rabelais, dans Gargantua, fait l’éloge d’une éducation humaniste, joyeuse, fondée sur la liberté. Mais cette liberté s’exerce dans un cadre moral clair : « Fais ce que voudras » ne signifie pas l’anarchie, mais suppose une conscience bien formée, qui sait ce qu’il ne faut pas faire.
L’interdit, même discret, est le fondement invisible de la liberté responsable.
II. Mais une éducation fondée uniquement sur l’interdit peut être contre-productive
Le risque d’une éducation autoritaire
Si l’interdit devient omniprésent, il peut bloquer la créativité, la curiosité, la confiance en soi. L’enfant ou l’adolescent n’agit plus par conviction, mais par peur. Il se soumet sans comprendre, ce qui peut engendrer des comportements de révolte ou d’hypocrisie.
L’éducation devient alors dressage plutôt que formation libre.
La lecture comme acte libérateur
Dans Premières années, Marie d’Agoult raconte comment la lecture interdite devient pour elle une source de plaisir, de connaissance, de développement personnel. Ce que l’éducation formelle n’enseigne pas, elle le découvre dans les livres lus en cachette.
L’interdit suscite parfois le désir d’apprendre… mais montre aussi que trop d’interdits peuvent priver de richesses éducatives essentielles.
Philosophie des Lumières
Les penseurs des Lumières (Rousseau, Diderot, Voltaire) défendent une éducation qui développe le jugement personnel, la raison, l’esprit critique. Rousseau, dans Émile, propose de limiter les interdits imposés de l’extérieur et de privilégier une éducation par l’expérience, où l’enfant découvre par lui-même ce qui est bon ou mauvais.
III. Vers une éducation qui transforme l’interdit en liberté intérieure
De l’interdit imposé à la règle librement choisie
L’idéal éducatif n’est pas de maintenir éternellement l’élève sous la dépendance des interdits, mais de l’aider à intérioriser des principes pour qu’il devienne autonome. On passe alors de l’obéissance à la responsabilité morale.
L’interdit n’est essentiel que comme étape de transition vers une liberté éclairée.
La notion de « loi intérieure » chez Kant
Kant montre que la liberté véritable consiste à obéir à la loi que l’on se donne à soi-même, par raison. Une éducation réussie fait donc émerger un sujet capable de se guider lui-même, en sachant ce qu’il ne faut pas faire, non par peur, mais par conviction.
Aujourd’hui : une pédagogie de la confiance
Les pédagogues modernes, comme Célestin Freinet ou Maria Montessori, insistent sur l’importance d’un cadre souple, respectueux de l’enfant, où les règles sont expliquées et partagées. Le but n’est pas d’interdire, mais de faire comprendre pourquoi certaines limites existent, et comment elles protègent la liberté de tous.
L’interdit est bien essentiel à toute éducation, car il fonde le cadre moral et social dans lequel l’enfant peut se construire. Mais il ne doit pas être une fin en soi : il prépare à la liberté. Une éducation réussie transforme peu à peu l’interdit en discernement, l’obéissance en autonomie, la règle imposée en responsabilité.
L’interdit, loin d’étouffer, est donc le socle à partir duquel l’homme libre peut grandir.
Sujets HLP bac 2025 jour 2
Lecture des sujets en PDF
- Consultez les sujets
Corrigé officiel
- Consultez le corrigé bac
Sujet :
HLP jour 2, vendredi 13 juin
- Première partie : interprétation littéraire
- Deuxième partie : essai philosophique
Vous pouvez aussi consulter les sujets HLP bac 2024 jour 2
Sujets HLP bac 2024 jour 2
Corrigé officiel
Sujet :
- Extrait de Jean-Louis Chrétien, Parole et poésie (2023).
- Ce voyage à travers la parole des autres que forme la lecture, il peut être le chemin le plus aigu pour revenir vers soi, pour apercevoir en nous des possibilités qui nous étaient jusqu’alors inconnues, et auxquelles la seule introspection n’eût pas pu nous conduire.
- Interprétation philosophique :
- Selon l'auteur, en quoi la lecture nous permet-elle de devenir nous-même ?
- Essai littéraire :
- Selon vous, la littérature élargit-elle "l'horizon de notre expérience" ?
Corrigé bac 2025 jour 2
Asie pacifique
Epreuve : Spécialité - Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)
Niveau d'études : Terminale
Année : 2025
Jour 1 : mercredi 11 juin
Jour 2 : jeudi 12 juin
Session : Normale
Sujets HLP bac 2025 jour 1
Lecture des sujets en PDF
Sujet :
HLP jour 1 mercredi 11 juin
- Première partie : interprétation littéraire
- « L’adolescent souffleté » de René Char
- Comment, dans ce poème, l’adolescent surmonte-t-il la violence qu’il subit ?
- Deuxième partie : essai philosophique
- Peut-on devenir soi-même sans ruptures ?
Corrigé bac 2025 jour 1
Première partie : interprétation littéraire
Comment, dans ce poème, l’adolescent surmonte-t-il la violence qu’il subit ?
Dans le poème en prose intitulé L’Adolescent souffleté, extrait du recueil Les Matinaux (1950), René Char évoque la souffrance d’un jeune être aux prises avec la violence. Mais cette épreuve n’est pas uniquement destructrice : elle semble jouer un rôle formateur, initiatique. Dès lors, on peut se demander comment l’adolescent parvient à surmonter la violence qu’il subit.
Nous verrons que cette souffrance, tout en l’abattant, le projette aussi en avant (I), qu’elle déclenche chez lui un repli fécond, source de transformation intérieure (II), et qu’enfin, elle lui permet de s’ouvrir au monde avec une nouvelle force (III).
I. Une violence qui projette autant qu’elle blesse
L’adolescent est décrit comme une figure souffrante, marquée par des « coups » qui le jettent « au sol » — image d’une violence physique et existentielle. Pourtant, cette chute ne signifie pas un anéantissement. Au contraire, les coups le « lançaient en même temps loin devant sa vie » : ils le propulsent vers l’avenir, vers « les futures années ». La douleur devient paradoxalement un moteur de croissance.
L’opposition entre le verbe « envoyer au sol » et l’expression « loin devant sa vie » met en évidence ce double mouvement de chute et d’élan. La violence n’est pas seulement une épreuve, elle devient aussi une éducation brutale qui le prépare à affronter l’existence, à la manière d’un rite initiatique.
Cette dynamique se manifeste aussi dans la temporalité : « quand il saignerait, ce ne serait plus à cause de l’iniquité d’un seul ». La violence, d’abord subie comme une injustice personnelle, prend un sens plus large : elle prépare à affronter une souffrance plus collective et mature.
II. Un repli silencieux et intérieur pour se reconstruire
L’adolescent réagit à la violence par un repli intérieur qui n’est pas un simple retrait, mais un moment essentiel de transformation. La métaphore végétale de « l’arbuste » qui « réconforte ses racines » et « presse ses rameaux meurtris contre son fût résistant » souligne la résistance vitale de l’être blessé.
Ce moment de silence — « il descendait ensuite à reculons dans le mutisme » — est un repli dans le savoir et dans l’innocence : il s’agit d’un retour aux sources, à une part encore préservée de lui-même, d’où il peut puiser la force de se reconstruire.
Ce mutisme n’est pas négatif : c’est un temps de gestation intérieure, une retraite nécessaire avant la renaissance. La violence subie lui fait découvrir sa propre résilience, sa capacité à transformer la douleur en force.
Enfin, ce mouvement intérieur conduit à l’évasion : « il s’échappait, s’enfuyait et devenait souverainement heureux ». La fuite est ici une libération, mais aussi l’affirmation d’une souveraineté nouvelle. Il gagne une forme de liberté intime en tournant le dos à la violence subie.
III. Une renaissance par la nature et la réintégration dans l’humanité
La suite du poème montre une connexion intense avec la nature : la « prairie », « la barrière des roseaux », « la vase », « le frémissement ». La nature devient le lieu de la réconciliation et de l’adoption. Il semble que « la terre avait produit de plus noble et de plus persévérant », comme si le monde naturel reconnaissait et accueillait son combat intérieur.
Cette image évoque une forme de renaissance, à la fois sensorielle, morale et symbolique. L’adolescent trouve un refuge dans le monde vivant, qui valide son expérience de douleur par cette adoption.
Enfin, le dernier paragraphe marque la sortie du cycle de la fuite. Il « recommencerait ainsi » jusqu’au jour où « la nécessité de rompre disparue », il pourrait « se tenir droit et attentif parmi les hommes ». Cela signifie que le cheminement douloureux conduit finalement à la maturité, à l’intégration dans le monde humain, plus fort et plus vulnérable à la fois, c’est-à-dire profondément humain.
Ainsi, dans ce poème, l’adolescent surmonte la violence par un triple mouvement : propulsion dans l’avenir, repli intérieur fécond, puis renaissance par la nature et réintégration dans la communauté humaine. René Char fait de la souffrance non un simple mal, mais un passage nécessaire vers la dignité, la lucidité et la force intérieure.
Deuxième partie : essai philosophique
Peut-on devenir soi-même sans ruptures ?
Devenir soi-même, c’est conquérir une forme d’identité personnelle, une cohérence intérieure qui permet à chacun de s’affirmer dans le monde. Mais ce processus est-il linéaire, progressif, continu ? Ou bien implique-t-il au contraire des ruptures — blessures, détachements, oppositions — sans lesquelles aucune transformation véritable ne peut avoir lieu ? Le poème L’Adolescent souffleté de René Char suggère que c’est précisément à travers les ruptures que l’individu devient pleinement lui-même.
I. Le moi naît de la rupture avec l’enfance et l’innocence
Dans le poème, l’adolescent est exposé à des coups, symboles de la violence de la vie et de la société. Ces coups le « jettent au sol » mais le « lancent aussi loin devant sa vie ». Autrement dit, la violence du réel l’arrache à l’enfance, à l’innocence, pour le projeter dans un avenir où il doit construire son identité. Cette rupture est douloureuse, mais nécessaire.
Comme le souligne le philosophe Hegel, dans La Phénoménologie de l’esprit, l’individu ne devient sujet qu’en passant par la négativité, par la confrontation avec l’autre, avec l’échec, avec l’opposition. C’est ce conflit qui suscite la prise de conscience de soi.
La rupture initiale dans le poème — celle de l’innocence blessée — est donc le point de départ du devenir personnel.
II. La rupture comme isolement fécond et reconquête intérieure
Le repli de l’adolescent « dans le mutisme de son savoir et de son innocence » n’est pas un simple abandon, mais une rupture avec le monde extérieur, un moment d’introspection nécessaire pour reconstruire le moi blessé.
Cette idée rejoint les réflexions de Simone Weil, qui considère dans La pesanteur et la grâce que l’âme humaine ne se forme que dans le retrait, dans une certaine forme de privation et de silence. Il faut s’arracher à la confusion du monde pour mieux se trouver.
La rupture devient alors un retrait volontaire, un moment de solitude qui permet de puiser en soi des ressources de résistance et de transformation.
III. La véritable affirmation de soi passe par la fin de la rupture
À la fin du poème, l’adolescent se tient « droit et attentif parmi les hommes », une fois la « nécessité de rompre » disparue. Cela signifie que les ruptures, bien qu’indispensables pour se former, ne sont pas une fin en soi : elles sont un passage vers une réconciliation possible, vers une maturité capable d’assumer sa vulnérabilité et sa force.
Cette idée rejoint la pensée de Paul Ricœur, qui dans Soi-même comme un autre, montre que l’identité personnelle se construit dans le temps, à travers des épreuves, des cassures, mais qu’elle vise à l’unification d’un récit de soi. La rupture n’est pas l’identité, mais ce qui permet de la produire.
Ainsi, on ne devient soi-même qu’en traversant des ruptures, et en les intégrant à un processus de construction cohérente.
René Char, à travers ce poème, donne une réponse claire à la question : non, on ne devient pas soi-même sans ruptures. C’est à travers les blessures, les fuites, les retraits, que l’individu apprend à se connaître, à se reconstruire, à s’orienter dans le monde. Le soi ne se forge pas dans la continuité paisible, mais dans les fractures fécondes de l’existence. Une fois celles-ci intégrées, l’individu peut enfin « se tenir droit parmi les hommes ».
Sujets HLP bac 2025 jour 2
Lecture des sujets en PDF
Sujet :
HLP jour 2, jeudi 12 juin
- Première partie : interprétation littéraire
- Quelle idée de l’éducation ce texte interroge-t-il ?
- Deuxième partie : essai philosophique
- La littérature et les arts doivent-ils nous apprendre quelque chose ?
Corrigé bac 2025 jour 2
- Première partie : interprétation littéraire
- Quelle idée de l’éducation ce texte interroge-t-il ?
Le passage extrait de De l’éducation intellectuelle, morale et physique (1854) de Herbert Spencer s’inscrit dans la réflexion moderne sur la pédagogie. Spencer y observe que l’enfant manifeste spontanément une activité intellectuelle foisonnante : il « observe, interroge, conclut ». Or, l’institution scolaire, au lieu de s’appuyer sur cette disposition naturelle, l’étouffe en substituant à l’exploration libre une transmission autoritaire de savoirs abstraits.
Problématique : Quelle conception de l’éducation Spencer remet‑il en cause et quelle alternative esquisse‑t‑il ?
I. L’enfant, sujet naturellement actif de son propre apprentissage
Constat empirique : des sens en éveil, une curiosité insatiable.
« activité incessante », « remarques avisées » : le vocabulaire souligne la vivacité et l’autonomie de la recherche enfantine.
Capacité d’auto‑construction du savoir : Spencer imagine qu’« appliquée systématiquement » cette activité suffirait pour que l’enfant « vienne à bout » de connaissances « sans aucun secours ».
On retrouve ici l’intuition de Rousseau (Émile, livre II) : l’enfant apprend d’abord par l’exercice de ses propres facultés.
II. Critique du modèle transmissif et coercitif
Décrochage entre programmes scolaires et besoins réels
L’adulte « arrache » l’enfant à ce qui l’intéresse pour lui imposer des faits « beaucoup trop complexes », provoquant ennui et incompréhension.
Recours à la contrainte : « menaces et châtiments » suppléent l’absence de motivation intrinsèque.
Spencer dénonce l’effet pathogène (« état morbide des facultés ») : la surcharge stérile engendre « le dégoût de toute étude ».
Cercle vicieux institutionnel
Après avoir fabriqué la passivité, l’école prétend la soigner… par les mêmes méthodes : « nous faisons de sa passivité un motif de continuer l’application de notre méthode ».
Critique d’une logique de reproduction sociale : l’infantilisation justifie l’autorité magistrale.
III. Vers une pédagogie de l’autonomie et de l’expérience
Réhabiliter l’intérêt spontané
Spencer prône un enseignement « à la portée » de l’enfant, c’est‑à‑dire gradué, concret, en lien avec son environnement immédiat (anticipation des méthodes actives : Montessori, Freinet).
Apprentissage inductif
Il faut partir des « faits » que l’enfant s’approprie, pour aller vers les principes ; démarche scientifique inversée par l’école traditionnelle.
Finalité : former un esprit critique, non un récipient
L’objectif n’est pas de transmettre un stock de vérités, mais de développer la puissance de penser : Spencer rejoint ici l’idéal libéral d’un individu autonome, capable de juger par lui‑même.
Le texte interroge donc la conception encyclopédique, autoritaire et descendante de l’éducation : l’élève, traité en vase vide, reçoit un savoir abstrait qui l’aliène au lieu de l’émanciper. Spencer oppose à ce modèle une pédagogie fondée sur l’activité spontanée, l’expérience directe et le respect du rythme de l’enfant, annonçant les pédagogies actives du XXᵉ siècle. L’enjeu n’est pas seulement didactique : il s’agit de former des esprits libres, capables de se gouverner eux‑mêmes, condition d’une société véritablement démocratique.
- Deuxième partie : essai philosophique
- La littérature et les arts doivent-ils nous apprendre quelque chose ?
La littérature et les arts touchent à notre sensibilité, notre imagination, nos émotions. Mais doivent-ils aussi nous instruire ? Doivent-ils nous apprendre quelque chose, transmettre des savoirs, une morale, une vérité ? Cette question engage la place que nous accordons à la culture dans la formation humaine. Le texte de Herbert Spencer, philosophe du XIXᵉ siècle, critique une éducation figée, autoritaire, qui empêche l'enfant de développer librement ses facultés. Il invite à penser une autre manière d’apprendre, plus active, plus organique. Or, la littérature et les arts, parce qu’ils suscitent curiosité et attention, peuvent justement ouvrir des voies d’apprentissage authentiques, bien différentes de la simple transmission.
Faut-il donc qu’ils nous apprennent quelque chose pour être légitimes ? Ou leur puissance réside-t-elle dans leur liberté et leur capacité à émouvoir sans forcément instruire ?
Nous verrons d’abord que l’art et la littérature peuvent nous apprendre des choses fondamentales, puis qu’ils ne doivent pas se réduire à une fonction didactique, avant de montrer qu’ils proposent une autre forme d’apprentissage, indirecte, mais formatrice.
I. Littérature et arts peuvent transmettre des connaissances essentielles
Depuis l’Antiquité, l’art et la littérature ont souvent été pensés comme des moyens de transmettre des savoirs et des valeurs. Platon, dans La République, mettait en garde contre le pouvoir éducatif de la poésie, jugée dangereuse s’il n’était pas bien orienté. À l’inverse, La Fontaine, à travers ses fables, enseigne la prudence, la justice ou le respect des autres, en unissant le plaisir du récit et la force de la morale.
La littérature peut aussi avoir une fonction historique ou politique. Germinal de Zola nous apprend beaucoup sur les luttes ouvrières, comme Une saison blanche et sèche d’André Brink éclaire l’apartheid. Le roman devient alors outil de conscience, d’ouverture sur le monde.
De même, dans les arts plastiques, les tableaux de Goya (comme Les désastres de la guerre) dénoncent la violence et nous instruisent sur les ravages humains des conflits.
C’est en ce sens que Spencer peut nous éclairer : il dénonce une éducation qui impose des savoirs abstraits sans lien avec l’expérience concrète de l’enfant. Or, la littérature et les arts, parce qu’ils mobilisent l’imagination et l’émotion, permettent à l’élève d’assimiler activement des vérités humaines. Ils rejoignent ce qu’il appelle les « faits qui l’intéressent » et donnent ainsi naissance à une forme d’apprentissage vivante.
II. Mais ils ne doivent pas être réduits à un devoir d’instruction
Pour autant, l'art et la littérature n'ont pas à être utiles ou éducatifs pour être légitimes. La doctrine de « l’art pour l’art », défendue au XIXᵉ siècle par Théophile Gautier, refuse toute soumission de l’œuvre à une mission morale ou didactique. L’art existe pour lui-même, pour le plaisir esthétique. Un tableau abstrait de Kandinsky, un poème de Mallarmé ou une pièce de Beckett (En attendant Godot) ne cherchent pas à nous apprendre quelque chose, mais à troubler, émouvoir, faire vivre une expérience unique.
Le risque d’une littérature ou d’un art uniquement « utiles » serait de tomber dans l’instrumentalisation, voire la propagande. Si on exige de l’art qu’il enseigne, qu’il délivre une vérité, on le réduit à un outil, et on nie sa puissance propre.
C’est précisément ce que Spencer critique dans l’éducation : le fait d’imposer de l’extérieur un contenu à assimiler passivement. Appliquée aux arts, une telle logique produirait des œuvres figées, sans liberté créative.
L’art et la littérature peuvent ainsi être gratuits, inutiles au sens fonctionnel, mais profondément nécessaires à l’existence, comme un espace de respiration, de beauté ou de liberté.
III. Une autre forme d’apprentissage : sensible, indirecte, humanisante
Si la littérature et les arts ne doivent pas être forcés à enseigner, ils enseignent autrement : ils nous forment, nous transforment, sans forcément transmettre un savoir théorique.
Là encore, Spencer éclaire cette idée : il valorise un apprentissage qui part de l’activité spontanée, du désir de comprendre. Or, l’art et la littérature suscitent ce désir, éveillent des questionnements, ouvrent à la complexité du réel.
Un roman comme Les Misérables de Hugo ne nous apprend pas un savoir précis, mais il nous fait ressentir l’injustice sociale, la misère, le pardon, et ainsi développe notre sens moral. Une pièce comme Antigone de Sophocle ne livre pas une vérité dogmatique, mais nous met en face d’un conflit éthique fondamental : faut-il obéir à la loi ou à sa conscience ? Ces œuvres ne « disent » pas quoi penser : elles nous forment à penser par nous-mêmes.
L’art peut aussi apprendre le regard, comme dans High School de Wiseman : le documentaire ne commente pas, mais laisse voir, provoque le jugement. C’est une pédagogie indirecte, proche de celle que Spencer appelle de ses vœux : respectueuse de l’activité de l’élève, non imposée de l’extérieur.
L’art et la littérature n’ont pas pour obligation de nous apprendre quelque chose, mais ils le font souvent, à leur manière. Ni cours magistral, ni simple divertissement, ils éveillent, interrogent, bouleversent, et forment ainsi un espace d’apprentissage libre, sensible, profond. C’est cette richesse que Spencer semble défendre quand il critique l’éducation passive : il appelle à une pédagogie qui rejoint ce que l’art et la littérature ont de plus précieux — la capacité à faire naître un désir de comprendre, sans jamais l’imposer.
Comme le disait Albert Camus : « L’art n’est pas une leçon de morale. Il est une révélation. »
Asie Pacifique
- Sujets HLP bac 2024 jour 1
- Lecture des sujets en PDF
- Sujets HLP bac 2024 jour 2
- Lecture des sujets en PDF
Vous pouvez aussi consulter les sujets HLP bac 2025
Polynésie française
Consultez les sujets HLP du bac 2024
Polynésie française
- Sujets HLP bac 2024 jour 1
- Lecture des sujets en PDF
- Sujets HLP bac 2024 jour 2
- Lecture des sujets en PDF
-
Les pouvoirs de la parole HLP 2025 12
Présentation de la spécialité : Humanités, Littérature, Philosophie Autour des nouveaux programmes de HLP 2025 Semestre 1 de première : Les pouvoirs de la parole (De l’Antiquité à l’Âge classique) L’art de la parole / L’autorité de la parole / Les séductions de la parole -
La recherche de soi Période de référence : Du romantisme au XXe siècle 7
Présentation de la spécialité : Humanités, Littérature, Philosophie Autour des nouveaux programmes de HLP 2025 Terminale, semestre 1 La recherche de soi Période de référence : Du romantisme au XXe siècle Éducation, transmission et émancipation Les expressions de la sensibilité Les métamorphoses du moi -
Les représentations du monde HLP 1ère, semestre 2 6
Présentation de la spécialité : Humanités, Littérature, Philosophie HLP 2025-Première, semestre 2 - représentations du monde - Période de référence : Renaissance, Âge classique, Lumières Découverte du monde et pluralité des cultures - Décrire, figurer, imaginer - L’homme et l’animal -
Les sujets E3C pour le bac - Spécialité HLP classe de Première -révisions pour les épreuves communes de contrôle continu-Présentation de la spécialité : Humanités, Littérature, Philosophie programmes de HLP 2020 - 2021 Semestre 1 de première : Les pouvoirs de la parole Semestre 2 : Les représentations du monde
-
Autour des nouveaux programmes de HLP Terminale, semestre 2 L’Humanité en question Période de référence : Période contemporaine (XXe-XXIe siècles) Création, continuités et ruptures Histoire et violence L’humain et ses limites - Consultez les supports cours, questionnaires et quiz du site pour vos révisions
-
Corrigé des sujets de spécialité HLP bac 2025 sur sujetscorrigesbac.fr
Corrigé des sujets de spécialité HLP bac 2025, métropole, Centres étrangers, DOM-TOM. Retrouvez les corrections du site et évaluez votre note -
Humanités, littérature, philosophie-Épreuves communes de contrôle continu 1ère la voie générale. Sujet zéro pour vous entraîner-L'art de la parole
Humanités, littérature et philosophie -Épreuves communes de contrôle continu classe de 1ère de la voie générale. Sujet zéro pour vous entraîner-L'art de la parole, thème 1, sujets 1 et 2. Classe de 1ère voie générale 1er semestre - L’ART DE LA PAROLE PLATON, Gorgias -MOLIÈRE, George Dandin -
Les annales de spécialité HLP du bac 2023, métropole, Groupes 1 et 2, DOM-TOM. Annales zéro corrigées
Annales de spécialité HLP bac 2023 métropole, DOM-TOM, Groupes 1 et 2 sujets corrigés en ligne le jour J. Annales zéro corrigées, entraînez-vous -
Les annales de spécialité HLP du bac 2024, métropole, Groupes 1 et 2, DOM-TOM. Annales zéro corrigées
Annales de spécialité HLP bac 2024 métropole, DOM-TOM, Groupes 1 et 2 sujets corrigés en ligne le jour J. Annales zéro corrigées, entraînez vous -
Humanités,littérature,philosophie-Épreuves communes contrôle continu 1ère la voie générale. Sujet zéro pour vous entraîner-Représentations du monde
Humanités, littérature et philosophie -Épreuves communes contrôle continu classe de 1ère de la voie générale. Sujet zéro pour vous entraîner-Les représentations du monde, thème 2 sujets 1, 2. Classe de 1ère voie générale 2ème semestre -DESCARTES, Discours de la méthode UN ANIMAL DANS LA LUNE-LA FONTAINE Fables VII -
Les annales de spécialité HLP du bac 2022, métropole, Groupes 1 et 2, DOM-TOM. Annales zéro corrigées
Annales de spécialité HLP bac 2022 métropole, DOM-TOM, Groupes 1 et 2 en ligne le jour J. Annales zéro corrigées, entraînez-vous. Consultez les questions qui pourraient tomber -
Les annales de spécialité HLP du bac 2021, métropole sujets corrigés, DOM-TOM, Groupes 1 et 2, annales zéro corrigées
Les annales de spécialité HLP du bac 2021, métropole sujets corrigés, DOM-TOM, Groupes 1- 2, annales zéro corrigées Consultez les questions qui pourraient tomber -
Les sujets corrigés en HLP du site. 32 exercices pour s'entraîner à la question d'interprétation et à l'essai
32 sujets corrigés en HLP du site. Exercices pour s'entraîner à la question d'interprétation et à l'essai - 32 sujets corrigés pour vous entraîner avant le jour J : L'humanité en question et la recherche de soi
Date de dernière mise à jour : 20/09/2025