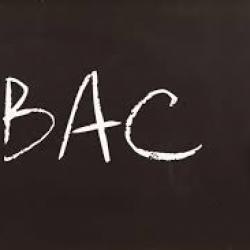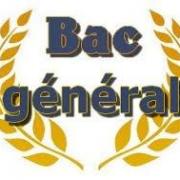Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique

Sujets du bac général 2025
Filière du bac : Voie générale
Epreuve : Philosophie
Niveau d'études : Terminale
Session : Normale
Centre d'examen : Asie pacifique
Date de l'épreuve : 10 juin 2025
Durée de l'épreuve : 4 heures
Téléchargez les sujets PDF
- Dissertation 1
- Dissertation 2
- Explication de texte
 Philosophie 2025 Asie pacifique sujet officiel (266.74 Ko)
Philosophie 2025 Asie pacifique sujet officiel (266.74 Ko)- Eléments d'évaluation
 Philosophie 2025 asie corrige officiel (500.18 Ko)
Philosophie 2025 asie corrige officiel (500.18 Ko)
- Dissertation n°1 :
- La justice a-t-elle besoin de la force ?
- Dissertation n°2 :
- La science nous éloigne-t-elle de la réalité ?
- Explication de texte :
- Il s'agit d'un extrait de Sartre, Qu'est-ce que la littérature ? (1948). Ce texte évoque les notions philosophiques de l'art et du langage.
Dissertation 1 :
La justice est souvent présentée comme un idéal moral et juridique, fondé sur l'équité, la reconnaissance des droits de chacun, et le respect des lois. Pourtant, dans la réalité, la justice ne peut pas toujours se contenter d’être un principe abstrait : elle s’incarne dans des institutions, des juges, des lois, mais aussi dans une autorité capable de faire appliquer ses décisions. Or, cette autorité suppose la force, qu’elle soit symbolique ou physique. Dès lors, une tension se fait jour : la justice, censée garantir le droit et la morale, peut-elle se passer de la force, qui évoque au contraire la contrainte, voire la violence ?
Ainsi, nous pouvons nous demander : la justice, pour exister et s’appliquer, a-t-elle nécessairement besoin du recours à la force, ou peut-elle se suffire à elle-même, en tant qu’idéal rationnel et moral ?
Nous verrons dans un premier temps que la justice, en tant que principe, est indépendante de la force, puis nous analyserons en quoi la force semble indispensable pour faire appliquer la justice, avant d’envisager enfin les dangers et les limites de cette alliance entre force et justice.
I. La justice comme idéal moral n’a pas besoin de la force
1. La justice comme concept rationnel et moral
La justice peut être pensée indépendamment de la force : elle repose sur la raison, l’équité, la morale.
Chez Platon, la justice est une vertu de l’âme avant d’être une institution : une harmonie intérieure, une régulation des désirs par la raison.
Ainsi, dans un monde parfaitement juste, il n’y aurait pas besoin de contrainte : chacun agirait selon le juste.
2. La justice se distingue de la force brutale
La force, au sens de violence physique ou contrainte, semble contredire l’idéal de justice.
La maxime de Pascal : « La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. » suggère que la justice doit rester indépendante dans ses principes, même si elle a besoin de moyens pour s’imposer.
3. Utopie d’une justice sans contrainte
On peut imaginer une société idéale (Rousseau, contrat social) où la loi serait librement acceptée par tous : nul besoin de la force, car chacun obéirait à la loi qu’il s’est donnée.
Dans ce modèle, la justice est la force même du lien social, non une contrainte extérieure.
II. Pourtant, la force semble nécessaire pour faire appliquer la justice
1. La justice comme institution a besoin d’une puissance d’exécution
Une décision juste qui ne s’applique pas est inefficace. Le jugement d’un tribunal, par exemple, doit pouvoir être exécuté.
La force publique (police, armée) est garante de cette exécution. Sans cela, la justice reste théorique.
2. L'État comme monopole légitime de la violence (Max Weber)
L'État de droit se fonde sur l'idée que seule une force centralisée et légitime peut faire appliquer la loi.
La justice se réalise dans le cadre d’institutions soutenues par la force de l'État.
Sans force, la loi serait impuissante face à ceux qui refusent de s’y soumettre.
3. La force comme moyen de restaurer la justice
Dans certains cas, la force est le seul moyen de faire cesser une injustice (par exemple, intervention humanitaire, libération d’un peuple opprimé).
La désobéissance civile elle-même peut inclure une forme de force (résistance, grève) pour rétablir une justice supérieure à la loi du moment.
III. Mais le lien entre justice et force est dangereux et doit être encadré
1. Le risque d’une justice instrumentalisée par la force
Si la force devient le critère de la justice ("est juste ce qui est imposé par le plus fort"), on tombe dans le cynisme.
Thucydide ou Calliclès (chez Platon) affirment que la justice des faibles s’efface devant la loi du plus fort.
Cela mène à la tyrannie ou à la dictature.
2. Nécessité de soumettre la force à la justice, non l’inverse
La force ne doit être qu’un moyen au service de la justice, non un fondement de celle-ci.
Il faut des contre-pouvoirs, des institutions indépendantes, pour éviter les abus.
Montesquieu défend la séparation des pouvoirs pour garantir une justice impartiale.
3. Construire une justice légitime, non seulement légale
Toute loi n’est pas nécessairement juste (ex : lois racistes, discriminatoires).
Il faut distinguer légalité et légitimité. La force au service d’une loi injuste n’est pas une vraie justice.
La désobéissance civile (Thoreau, Gandhi, Martin Luther King) rappelle que la force peut être contestée au nom d’une justice supérieure.
En définitive, la justice ne trouve pas son fondement dans la force, mais elle a besoin de la force pour être effective, c’est-à-dire pour se faire respecter et s’incarner dans la société. Toutefois, ce recours à la force doit être encadré, contrôlé et toujours justifié par des principes moraux et juridiques, sans quoi la justice risque de se dénaturer. C’est la condition pour que la force ne serve pas l’arbitraire, mais bien la justice.
On peut dès lors se demander dans quelle mesure les nouvelles formes de justice non-violente (justice restaurative, médiation) pourraient représenter un modèle d’avenir, où la force céderait la place à une justice fondée sur la parole, la réparation et la reconnaissance mutuelle.
Dissertation 2 :
La science est l’une des activités humaines les plus puissantes pour comprendre le monde. Par ses méthodes rigoureuses, elle cherche à expliquer les phénomènes naturels, à établir des lois, à construire des théories. Pourtant, certains reprochent à la science de produire des abstractions, des modèles mathématiques éloignés de notre expérience sensible. En se spécialisant, en utilisant un langage technique, la science nous rapprocherait-elle de la vérité du réel, ou au contraire, nous en éloignerait-elle ?
Dès lors, il faut se demander : la science, en cherchant à expliquer le monde, nous permet-elle d'accéder à la réalité véritable, ou bien nous en détourne-t-elle en la réduisant à des schémas abstraits ?
Nous verrons d'abord que la science vise à connaître la réalité avec précision et rigueur, puis que sa méthode peut nous éloigner de l'expérience immédiate du réel, avant d’envisager enfin que la science ne nous éloigne pas de la réalité, mais en propose une compréhension plus profonde et médiatisée.
I. La science cherche à connaître la réalité de manière objective
1. La science repose sur l'observation et l’expérimentation
Elle part de faits observables, mesurables, reproductibles.
Elle vise une connaissance du réel indépendante de l'opinion ou de l'illusion.
Exemple : Galilée observe la chute des corps pour réfuter les idées d’Aristote ; la physique moderne repose sur l’expérience.
2. La science construit des lois qui traduisent les structures réelles du monde
Elle met en évidence des régularités, des constantes universelles (loi de la gravitation, lois de la thermodynamique).
Ces lois ne sont pas de simples fictions : elles rendent compte du réel de manière fiable et prédictive.
Exemple : la loi de Newton permet de prédire les éclipses, les mouvements planétaires.
3. La science permet une action efficace sur la réalité
Les avancées techniques et technologiques sont une preuve de l’efficacité de la science.
Ce qui fonctionne (dans la médecine, l’aéronautique, l’informatique) suppose une connaissance du réel.
La science ne peut pas être complètement déconnectée de la réalité si elle permet de la transformer avec succès.
II. Pourtant, la science élabore des modèles abstraits et s’éloigne de notre expérience immédiate
1. Une réalité réduite à ce qui est mesurable et quantifiable
La science néglige parfois la qualité des choses au profit de la quantité.
Elle ne s’intéresse pas à ce que nous ressentons, mais à ce qui est objectivable.
Exemple : une équation chimique ne dit rien de la couleur, de l’odeur ou de la beauté d’un feu.
2. Des modèles souvent très éloignés du réel vécu
La physique quantique ou la théorie de la relativité décrivent un univers très différent de notre perception quotidienne.
Les particules n’ont pas de position déterminée, le temps n’est pas absolu : la science produit des concepts qui contredisent le « sens commun ».
Cela peut donner le sentiment que la science ne décrit pas la réalité, mais construit un monde parallèle.
3. Le langage scientifique est abstrait, spécialisé, inaccessible
Les formules, les langages mathématiques sont parfois si éloignés de l’expérience concrète qu’ils semblent nous couper du monde.
Ce n’est plus la réalité sensible qui est décrite, mais des modèles théoriques.
III. La science nous éloigne des apparences, mais pour mieux comprendre la réalité
1. La science ne s’oppose pas à la réalité, elle s’oppose aux illusions
La science remet en question les apparences trompeuses pour aller vers une réalité plus profonde.
Exemple : la Terre semble plate et immobile, mais l’astronomie montre qu’elle est ronde et en mouvement.
Ce n’est pas s’éloigner de la réalité, c’est corriger une perception fausse.
2. Les modèles scientifiques sont des outils pour accéder à l’invisible
Le réel n’est pas toujours accessible directement : l’atome, la cellule, les forces physiques sont invisibles sans instruments.
Les modèles sont des fictions opératoires : ils simplifient, mais pour mieux comprendre.
Comme le disait Einstein : « La théorie, c’est quand on sait tout mais rien ne fonctionne ; la pratique, c’est quand tout fonctionne mais on ne sait pas pourquoi. »
3. La science complète, mais ne remplace pas, les autres formes d’expérience du réel
L’art, la littérature, la philosophie ou la religion donnent aussi un accès à la réalité humaine et sensible.
La science n’épuise pas le réel, mais elle y contribue. Elle permet de comprendre ce qui dépasse nos sens.
Elle propose une vérité médiatisée, non immédiate, mais fondée sur des preuves et des démonstrations.
La science ne nous éloigne pas de la réalité : elle nous en éloigne en apparence, car elle remet en question nos intuitions et nos perceptions premières, mais elle nous en rapproche en vérité, en nous donnant des outils rigoureux pour comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Elle transforme notre rapport au réel, non pour le fuir, mais pour le connaître plus profondément.
On peut alors s’interroger sur la place croissante de l’intelligence artificielle et des simulations numériques dans la science moderne : ne risquent-elles pas de nous faire perdre le contact avec la réalité physique au profit d’un monde entièrement modélisé et virtuel ?
Explication de texte :
Dans Qu’est-ce que la littérature ? (1948), Jean-Paul Sartre s’interroge sur la nature de l’art, et en particulier sur la manière dont l’artiste perçoit le réel. Dans le passage proposé, il s’intéresse à des éléments du monde sensible – couleurs, fleurs, sons – pour montrer que le regard artistique diffère profondément du regard utilitaire ou symbolique que l’on adopte souvent dans la vie quotidienne.
À partir de l’exemple des roses blanches, Sartre oppose deux attitudes : celle qui voit dans les choses des signes renvoyant à des idées, et celle qui s’attache aux choses elles-mêmes dans leur richesse sensible. Ce texte pose ainsi une question essentielle :
Faut-il voir dans l’art une forme de langage chargé de signification, ou une manière singulière de se rapporter au réel ?
Sartre défend la thèse suivante :
L’artiste ne cherche pas à transmettre un message à travers des signes, mais à faire exister des choses sensibles et imaginaires ; il s’attache à la qualité de l’objet perçu, et non à sa signification.
Nous verrons comment cette idée se déploie dans le texte en trois mouvements :
La distinction entre perception sensible et lecture symbolique.
La spécificité du regard artistique.
La nature de la création artistique comme opposition à toute fonction langagière.
I. De la perception sensible à la lecture symbolique : une opposition entre voir et interpréter
Du début du texte jusqu’à « je ne les ai pas même perçues »
Sartre commence par poser une distinction fondamentale : certaines réalités sensibles (comme les couleurs) existent par elles-mêmes, sans qu’on leur attribue de signification. Il y a « le vert » et « le rouge » : ce sont des choses, des éléments du monde, qui ne renvoient à rien d’autre qu’eux-mêmes.
Pourtant, l’être humain tend à transformer les objets en signes, à travers des conventions sociales. Il en va ainsi du langage des fleurs, où les roses blanches peuvent symboliser la fidélité. Sartre admet cette possibilité, mais critique la conséquence de cette transformation :
lorsqu’on lit une rose comme un signe, on cesse de la percevoir comme chose. On traverse son apparence pour viser une idée abstraite – ici, la fidélité.
Cette démarche revient à oublier l’objet dans sa matérialité : on ne prête plus attention à sa forme, à son parfum, à sa texture. C’est donc une perte du rapport sensible au réel, une sorte de cécité esthétique.
II. Le regard de l’artiste : une attention émerveillée au réel sensible
De « Cela veut dire que je ne me suis pas comporté en artiste » à « il s’en enchante »
À ce stade, Sartre introduit la figure de l’artiste, par contraste avec celui qui perçoit les choses comme des signes. Pour l’artiste, le réel sensible n’est jamais un simple moyen de signifier quelque chose d’autre. Il ne traverse pas les objets pour en tirer des idées : il s’y arrête, il les contemple.
Le texte devient alors élogieux : l’artiste revient sans cesse aux formes, aux couleurs, aux sons – et s’en enchante. Il ne cherche pas à interpréter le réel mais à l’éprouver dans toute sa richesse perceptive. Il adopte une attitude esthétique, proche de la contemplation.
Ce passage valorise une présence au monde immédiate et charnelle. L’artiste est celui qui redonne aux choses leur densité, leur singularité. Il est capable de percevoir ce que les autres ne voient plus, habitués à filtrer le monde par les codes sociaux ou les fonctions pratiques.
III. Créer, ce n’est pas signifier : l’art comme production d’une chose imaginaire
De « c’est cette couleur-objet […] » à la fin du texte
Dans le dernier mouvement, Sartre étend sa réflexion au travail du peintre. Celui-ci ne cherche pas à produire un langage – au sens d’un système de signes – mais à faire exister une chose nouvelle : un objet imaginaire, une œuvre.
Même lorsqu’il compose une toile avec plusieurs couleurs, le peintre ne vise pas une signification précise. L’assemblage des formes et des couleurs ne renvoie pas à une idée définissable. Il ne s’agit pas de représenter un concept, mais de faire apparaître une réalité esthétique nouvelle, qui ne dit rien mais se montre.
Ainsi, Sartre défend une conception de l’art non symbolique, non utilitaire, non intellectuelle. Il s’oppose à l’idée selon laquelle tout art serait langage, ou renverrait à un sens extérieur. L’œuvre d’art est une fin en soi – une chose à regarder, écouter, éprouver, non à traduire ou interpréter.
Dans ce texte, Sartre oppose deux rapports au monde :
Celui du langage et de la convention, qui dépossède les choses de leur richesse sensible,
Et celui de l’art, qui restaure leur présence pleine et perceptible.
Il affirme que l’artiste n’est pas un traducteur d’idées, mais un créateur de formes, qui nous invite à redécouvrir le monde non comme un message, mais comme un miracle sensible à contempler.
Cette réflexion invite à repenser le rôle de l’art dans nos vies : loin d’être un discours caché à interpréter, il peut être une expérience poétique du réel, proche de ce que recherchent les poètes ou les peintres dans la contemplation du monde ordinaire.
Vous pouvez consulter les corrigés bac de philosophie 2024
Téléchargez les sujets
Téléchargez les corrections
Corrigé officiel complet
- Dissertation 1 :
- Faut-il se battre pour la vérité ?
- Dissertation 2 :
- Doit-on se libérer de soi-même ?
- Explication de texte :
- Il s'agit d'un extrait d'Alain, "Des Poètes", dans Humanités (1946). Ce texte évoque les notions philosophique du langage et de la conscience.
Sujets du bac technologique 2025
Filière du bac : Voie technologique
Epreuve : Philosophie
Niveau d'études : Terminale
Session : Normale
Centre d'examen : Asie pacifique
Date de l'épreuve : juin 2025
Durée de l'épreuve : 4 heures
Consultez les sujets en ligne
Téléchargez les sujets
Dissertation n°1 :
Sujet 1 Peut-on critiquer la religion sans la rejeter ?
La religion occupe une place centrale dans l’histoire humaine : elle structure des civilisations, propose des réponses aux grandes questions existentielles, fonde des normes morales et sociales. Pourtant, elle n’échappe pas à la critique : ses dogmes peuvent être perçus comme irrationnels, son influence sociale comme oppressive, et certains actes commis en son nom comme inacceptables. Dès lors, critiquer la religion peut apparaître comme un acte de rejet : la contester, n’est-ce pas forcément la refuser ?
Mais faut-il pour autant confondre critique et rejet ? Ne peut-on pas distinguer une critique rationnelle ou morale, qui vise à améliorer ou clarifier, d’un rejet total de la religion, de sa validité ou de son utilité ?
Ainsi, peut-on critiquer la religion sans la rejeter ? Autrement dit, est-il possible de formuler des objections contre certains aspects d’une religion tout en en conservant le respect, voire l’adhésion à ses valeurs fondamentales ?
Nous verrons que la critique de la religion peut apparaître comme un rejet dans une perspective rationaliste, mais qu’elle peut aussi être interne et constructive. Enfin, nous envisagerons une posture nuancée, qui reconnaît la légitimité de la critique sans exclure la valeur spirituelle ou sociale de la religion.
I. La critique de la religion peut être un rejet : raison contre foi
Dans un premier temps, critiquer la religion peut signifier la remettre radicalement en question, en tant que système de croyance.
Les philosophes des Lumières (Voltaire, Diderot, d’Alembert) critiquent la religion en dénonçant l’obscurantisme, les superstitions et les abus de l’Église. Voltaire écrivait : « Écrasez l’infâme », en visant l’intolérance religieuse. Pour eux, la raison doit remplacer la foi aveugle, et la critique conduit à un rejet de la religion comme obstacle au progrès.
Marx voit dans la religion une aliénation : « La religion est l’opium du peuple ». Elle maintient les masses dans l’illusion, détourne de la lutte politique et sociale. La critiquer, c’est vouloir la dépasser, donc la rejeter.
Nietzsche, dans Le Gai Savoir, proclame « Dieu est mort ». Il voit dans la religion une forme de négation de la vie, de faiblesse morale. Il appelle à la transvaluation des valeurs.
Pour ces penseurs, critiquer la religion, c’est la refuser en bloc, en tant qu’elle repose sur des croyances irrationnelles ou nocives.
II. Mais la critique peut être interne : distinguer foi et institution
Cependant, il est possible de critiquer certains aspects de la religion sans pour autant rejeter l’idée de Dieu, de spiritualité ou de communauté croyante.
Critique interne : On peut distinguer la foi personnelle de l’institution religieuse. De nombreux croyants critiquent leur religion de l’intérieur : abus de pouvoir, rigidité dogmatique, discrimination... Sans pour autant renoncer à leur foi. Par exemple, Martin Luther critique l’Église catholique, mais pas le christianisme : il déclenche la Réforme.
La foi comme expérience intérieure : Pour Kierkegaard, le religieux est avant tout subjectif : il repose sur un rapport intime et existentiel à Dieu. Critiquer les formes extérieures, ce n’est pas rejeter la foi elle-même, mais refuser son instrumentalisation.
Tolérance et rationalité : Pour Spinoza, dans Traité théologico-politique, on peut critiquer les textes religieux en les soumettant à la raison, sans rejeter leur valeur éthique ou symbolique. Il propose une lecture rationnelle et critique des Écritures. Ainsi, la critique devient un moyen de purifier la religion de ses dérives.
Il est donc possible de distinguer religion et religiosité, dogme et foi, et de pratiquer une critique qui n'est pas destructrice, mais réformatrice.
III. Une critique constructive : penser la religion comme fait humain et spirituel
Enfin, il est possible d’adopter une posture philosophique nuancée, qui ne rejette pas la religion mais cherche à en comprendre les fonctions et les limites.
La religion comme fait humain : Selon Durkheim, la religion est une institution sociale qui répond à des besoins fondamentaux : cohésion du groupe, sens, rites. On peut critiquer certaines formes d’aliénation religieuse tout en reconnaissant son rôle structurant dans les sociétés.
Religion et morale : Pour Paul Ricœur, la critique peut viser des aspects historiques ou éthiques (violence, exclusion), tout en reconnaissant dans la religion une source de symboles, de récits fondateurs et de réflexion morale.
Critique et dialogue interreligieux : La critique peut ouvrir la voie à un dialogue entre croyances, à une meilleure compréhension mutuelle. Rejeter toute critique mène à l’intégrisme ; rejeter toute religion mène à une perte de sens possible. La voie du dialogue critique, sans rejet, est une posture philosophiquement mature.
Ainsi, la critique n’est pas forcément une négation, mais peut devenir une exigence de vérité, de cohérence et d’authenticité.
Critiquer la religion, c’est interroger ses dogmes, ses pratiques, ses institutions, parfois même sa validité. Une telle critique peut aboutir au rejet total, comme chez certains penseurs rationalistes ou athées. Mais elle peut aussi prendre une forme interne, éthique ou spirituelle, qui ne rejette pas la foi, mais cherche à l’approfondir.
Oui, on peut critiquer la religion sans la rejeter, à condition de faire la distinction entre la foi et ses expressions institutionnelles ou culturelles. La critique est alors une preuve de liberté de pensée, mais aussi une chance pour la religion elle-même, de se renouveler et de mieux répondre aux exigences contemporaines de vérité, de justice et d’humanité.
Dissertation n°2 :
Sujet 2 La justice peut-elle se passer de l’usage de la force ?
La justice est un idéal moral et politique qui vise à garantir l’équité, l’ordre social et les droits de chacun. Elle se présente souvent comme le contraire de la force : là où la justice règne, la force brute, la violence, devraient disparaître. Pourtant, dans les faits, la justice s’impose par des lois qui sont sanctionnées par des tribunaux, des policiers, des prisons. Ainsi, même la justice semble avoir besoin de la force pour exister.
Mais cette situation soulève un paradoxe : si la justice est ce qui est juste, comment peut-elle s’accompagner de contrainte ou de violence ? Est-ce à dire qu’elle trahit ses propres principes ? Ou bien l’usage de la force est-il nécessaire à sa mise en œuvre, sans en compromettre la légitimité ?
D’où la question : la justice peut-elle se passer de l’usage de la force ?
Nous verrons d’abord que toute justice humaine semble avoir besoin de la force pour être efficace, puis que cet usage de la force pose un problème moral et philosophique. Enfin, nous nous demanderons s’il est possible de penser une justice sans recours à la contrainte, ou du moins avec un usage limité, encadré et légitimé de la force.
I. La justice ne peut pas se passer de la force pour s’appliquer
Dans un monde idéal, les hommes respecteraient spontanément ce qui est juste. Mais dans les faits, les lois sont souvent transgressées, les intérêts divergents, et l’égoïsme prédomine. La justice a donc besoin de se faire obéir.
Pas de droit sans sanction : Une loi sans possibilité de sanction est inefficace. Selon Hobbes, dans Le Léviathan, l’homme à l’état de nature est en guerre contre tous. Seul un pouvoir fort, souverain, peut garantir la paix : le droit a besoin d’une force pour être respecté. La justice sans force est impuissante, et la force sans justice est tyrannique.
L’État, garant de la justice : Pour Weber, l’État est défini comme « le monopole de la violence légitime ». Cela signifie que la force est encadrée par le droit, utilisée pour protéger la société. Sans force publique (police, justice, armée), la loi serait lettre morte.
Exécution des décisions de justice : Même dans un État de droit démocratique, la justice repose sur des institutions coercitives. Un jugement implique souvent une exécution forcée (amende, emprisonnement). La force rend possible la mise en œuvre du droit.
Donc, dans la réalité, la justice humaine ne peut se passer de la force : c’est une condition de son efficacité et de son autorité.
II. Pourtant, l’usage de la force semble trahir l’idéal même de justice
Mais cette dépendance de la justice envers la force soulève un problème moral et philosophique : la justice ne devrait-elle pas convaincre plutôt que contraindre ?
La violence contredit la liberté : La justice vise à respecter la dignité humaine, la liberté, la raison. Or, la force repose sur la contrainte physique. Selon Rousseau, dans Du contrat social, « la force ne fait pas le droit » : on ne peut justifier l’obéissance par la seule menace. La justice qui s’impose par la force cesse d’être juste si elle n’est pas librement consentie.
La tentation de l’arbitraire : L’usage de la force peut conduire à des abus, surtout si la légitimité du pouvoir est contestée. Quand l’autorité devient oppressive, la force devient violence illégitime. La justice peut alors devenir un instrument de domination.
Le risque de la violence institutionnelle : Walter Benjamin, dans Pour une critique de la violence, distingue la violence fondatrice de droit (ex : la Révolution) de la violence conservatrice (celle exercée par l’État). Il montre que la justice est toujours liée à une forme de violence, ce qui est philosophiquement problématique.
Ainsi, la force peut corrompre la justice, la faire dériver vers la répression, le pouvoir pour lui-même, et l’oubli de l’idéal moral.
III. Vers une justice sans violence ? Une régulation légitime de la force
Peut-on alors penser une justice sans force, ou à tout le moins maîtriser son usage ?
Une justice fondée sur le dialogue et la médiation : Dans certaines sociétés ou contextes, on privilégie la justice réparatrice (plutôt que punitive), fondée sur la médiation, la réconciliation, l’écoute des parties. C’est une tentative de réduire la violence dans le traitement du conflit.
La force comme dernier recours : Même si elle ne peut totalement se passer de force, une justice peut en limiter l’usage, le soumettre au droit, à la proportionnalité, à la transparence. La justice démocratique repose alors sur une force légitime, contrôlée, non arbitraire.
La paix par le droit : Kant, dans Vers la paix perpétuelle, imagine une société internationale où le droit remplacerait la force entre États. La justice y serait assurée par la raison, les institutions, et le respect mutuel, non par la guerre ou la contrainte. Cela montre que la force n’est pas inévitable, mais transitoire, à dépasser progressivement.
Il est donc possible de penser une forme de justice qui tend vers l’élimination de la force, sans en être totalement exempte aujourd’hui. La force devient alors un outil au service de la justice, non sa contradiction.
La justice, en tant qu’idéal moral, devrait pouvoir s’imposer par la raison et le dialogue. Mais dans le monde réel, marqué par les conflits d’intérêts, les injustices et les résistances, elle ne peut se passer d’un minimum de force, pour garantir l’ordre et faire respecter le droit. Toutefois, l’usage de la force ne doit jamais être confondu avec la justice elle-même : il doit rester encadré, légitime, proportionné, au service de valeurs supérieures.
La justice ne peut peut-être pas totalement se passer de la force aujourd’hui, mais elle doit toujours viser à la limiter, la légitimer, et, si possible, la dépasser.
Explication de texte :
Sujet 3 Expliquer le texte suivant :
Prenons, si tu veux bien, deux blocs de pierre, tout simplement placés l’un à côté de l’autre ; l’un sans proportion et sur lequel l’art n’est pas intervenu, et l’autre sur lequel l’art a eu prise pour fabriquer la statue d’une divinité ou d’un homme. S’il s’agit d’une divinité, ce sera la statue d’une Grâce1 ou de l’une des Muses2 ; s’il s’agit d’un homme, non pas celle de n’importe qui, mais la statue de l’homme que l’art a produite à partir de tout ce qu’il y a de beau. Il est évident que la pierre en laquelle l’art a engendré la beauté de la forme est belle non parce que c’est une pierre, car à ce compte-là une autre pierre eût été aussi belle, mais en raison de la forme que l’art y a fait entrer. Eh bien, cette forme, la matière ne la possédait point, mais elle se trouvait dans la pensée de l’artiste et elle était là avant qu’elle ne fût dans la pierre. Elle se trouvait dans l’artiste, non dans la mesure où il a des yeux ou des mains, mais parce qu’il participe à l’art. Cette beauté était donc dans l’art, et elle y était bien supérieure.
Plotin, Ennéades, V, 8 (IIIème siècle)
Vous pouvez consulter les corrigés du bac 2024
Consultez les sujets en ligne
Téléchargez les sujets
Dissertation n°1 :
La relation entre l'humanité et la nature implique-t-elle un rapport de domination ?
Dissertation n°2 :
Peut-on se passer d'art ?
Explication de texte :
Il s'agit d'un extrait de Platon, Les Lois (Vème siècle avant J.-C.). Ce texte évoque les notions philosophiques de justice et de loi.
Si le candidat choisit de suivre le développement proposé par le sujet, il devra alors répondre à des questions d'analyse et de synthèse :
- - Expliquez la distinction entre "l'éloge et le blâme" d'un côté, "la loi" de l'autre.
- - Comment Platon justifie-t-il que la vérité vienne en tête de tous les biens ?
- - Est-il toujours bon de dévoiler la vérité ?
- - Pensez-vous qu'il faut pousser les citoyens à combattre l'injustice par tous les moyens ?
Les annales de philosophie, bac 2025
-
Corrigés bac philo 2025 – Métropole (bac général) : découvrez les corrigés dès la sortie de l’épreuve
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série générale, Métropole. Sujets du 16 juin corrigés dès la sortie de l’épreuve -
Retrouvez dès la sortie des épreuves, le corrigé de philosophie bac technologique métropole 2025
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série technologique, Métropole. Sujets du 16 juin avec dissertations et commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2025 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés
Sujets corrigés philosophie bac général Amérique du Nord 2025 – découvrez les corrections, dissertations , commentaire du 20 mai. Entraînez-vous avec les corrigés -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2025
Retrouvez les sujets corrigés du bac technologique de philosophie 2025, centres étrangers groupe 1, dissertation et commentaire. -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2025
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2025 - Consultez les corrections du site -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Antilles Guyane, bacs général et technologique.
Consultez les sujets corrigés du bac de philosophie Antilles Guyane 2025, ils sont en ligne : commentaire et dissertation. Bacs général et technologique. -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique
Sujets de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations 2024 -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Polynésie française, bacs général et technologique.
Retrouvez tous les sujets corrigés de l'épreuve de philosophie 2025 de Polynésie française, ils sont en ligne sur sujetscorrigesbac.fr
Les annales de philosophie, bac 2024
-
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve Consultez les corrections proposées des dissertations et du commentaire dès la sortie de la salle d'examen -
Bac technologique philosophie 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac technologique philosophie sessions juin et septembre 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve. Consultez les corrigés, évaluez votre copie dissertation, commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés proposés
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés proposés du bac 2023 -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés du bac
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous-Centres de baccalauréat ouverts à l’étranger -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés bac du site pour le jour J. -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Polynésie française, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Polynésie française, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site et entrainez vous -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Antilles Guyane, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Antilles Guyane, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique.
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations corrigés 2023 et 2022 pour réussir votre examen
Date de dernière mise à jour : 05/10/2025