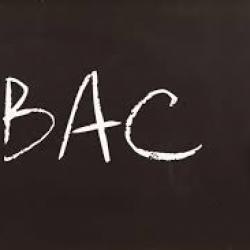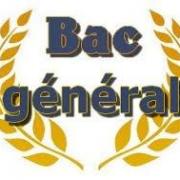Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2025 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés

Le baccalauréat 2025 débute, comme chaque année, avec les centres étrangers, et notamment l’épreuve de philosophie en Amérique du Nord. En ce 20 mai, les élèves de terminale des lycées français à l’étranger ouvrent le bal des épreuves avec des sujets qui donnent le ton de la session.
Sur cette page, tu trouveras les corrigés détaillés des sujets proposés au bac de philosophie 2025 pour la série générale – Amérique du Nord, accompagnés d’analyses pour t’aider à mieux comprendre les enjeux des dissertations et du commentaire de texte.
Ces premiers sujets sont précieux pour s’entraîner, affiner ses méthodes et anticiper les grandes problématiques qui pourraient revenir lors de la session métropolitaine de juin.
Filière du bac : Voie générale
Epreuve : Philosophie
Niveau d'études : Terminale
Année : 20 mai 2025
Session : Normale
Centre d'examen : Amérique du Nord
Durée de l'épreuve : 4 heures
Le candidat traite, au choix, l’un des trois sujets suivants.
- Dissertation n°1 :
- Une oeuvre d'art doit-elle toujours plaire ?
- Dissertation n°2 :
- Suffit-il de faire son devoir pour être juste ?
- Explication de texte :
- Sartre, L'être et le néant (1943). Ce texte évoque les notions philosophiques de conscience et de liberté.
Consultez les sujets en ligne
Dissertation n°1 :
Une oeuvre d'art doit-elle toujours plaire ?
Dans les allées d’un musée, les réactions varient : un visiteur s’émerveille devant un tableau abstrait, un autre détourne le regard, dérangé par une sculpture trop provocante. L’histoire de l’art est jalonnée d’œuvres qui fascinent, intriguent, dérangent, choquent ou même rebutent. Dès lors, une question se pose : l’œuvre d’art doit-elle nécessairement plaire pour remplir sa fonction ? Autrement dit, le plaisir esthétique est-il un critère indispensable de l’art ?
Certains considèrent que l’art doit séduire les sens et l’esprit, apporter du beau, de l’harmonie, susciter l’admiration. Mais d'autres défendent une conception plus libre de l’art, qui peut déranger, bousculer, interroger, sans forcément plaire.
Nous verrons donc que si l’art a souvent pour vocation de plaire, il peut aussi viser d’autres buts, comme faire réfléchir ou provoquer une émotion forte ; en ce sens, une œuvre d’art n’a pas à toujours plaire.
I. L’art peut avoir pour but de plaire : séduire les sens, l’âme et l’intelligence
1. Le plaisir esthétique comme fonction traditionnelle de l’art
L’art a longtemps été associé à la beauté. Dans l’Antiquité, chez Platon ou Aristote, l’art imite la nature pour en révéler l’harmonie. À la Renaissance, la recherche du beau est essentielle : proportions parfaites, équilibre, lumière. L’œuvre plaît car elle procure une satisfaction visuelle ou auditive.
2. Une fonction apaisante et universelle du plaisir artistique
L’art peut consoler, élever l’âme. La musique classique, la peinture impressionniste ou les romans sentimentaux cherchent souvent à émouvoir, à procurer un sentiment d’harmonie. Ce plaisir esthétique rassemble, apaise, et crée un langage universel.
3. Plaire n’est pas superficiel : c’est parfois un moyen de toucher en profondeur
Une œuvre plaisante peut aussi transmettre un message fort. Une comédie de Molière fait rire, mais elle critique la société. Le plaisir devient un outil pour éduquer, éveiller les consciences. La séduction artistique peut donc cacher une profondeur morale ou intellectuelle.
II. Mais l’art peut aussi déranger : provoquer, interroger, choquer
1. L’art comme rupture avec le goût commun
Au fil des siècles, de nombreuses œuvres ont choqué leur époque. Les tableaux de Goya, les toiles de Picasso ou les performances de l’art contemporain peuvent heurter le spectateur. Pourtant, ces œuvres marquent l’histoire : elles brisent les codes pour mieux innover.
2. L’art engagé : faire passer un message, même au prix du malaise
Des œuvres comme Guernica de Picasso, ou Les Misérables de Hugo, ne cherchent pas à plaire mais à dénoncer l’injustice, la guerre, la misère. Elles provoquent une réaction. Le choc esthétique devient un outil de transformation sociale.
3. Le spectateur bousculé : une autre forme de plaisir ?
Il est possible de ressentir un « plaisir paradoxal » face à une œuvre dérangeante : l’émotion intense, la stupeur ou même la colère deviennent des expériences riches, profondes. L’art ne caresse pas toujours dans le sens du poil ; il peut aussi réveiller.
III. Finalement, l’art n’a pas pour devoir de plaire : sa liberté prime
1. L’artiste n’est pas un artisan du goût : il est libre
Créer pour plaire reviendrait à se soumettre à un public ou à une norme. Or, beaucoup d’artistes refusent cette idée : ils créent avant tout pour s’exprimer, explorer leur vision du monde, parfois incomprise. La sincérité artistique compte plus que l’adhésion du public.
2. L’art évolue : ce qui ne plaît pas aujourd’hui peut devenir chef-d’œuvre demain
L’histoire de l’art montre que certaines œuvres, d’abord mal accueillies, sont devenues majeures. L’Olympia de Manet ou Le Sacre du printemps de Stravinsky ont été hués à leur création. Le goût change, et l’art qui déplaît aujourd’hui peut éclairer l’avenir.
3. Plaire à tout prix risquerait de limiter la puissance de l’art
Si une œuvre d’art devait toujours plaire, elle deviendrait consensuelle, fade, sans force. L’audace, la provocation, l’originalité seraient sacrifiées. L’art perdrait sa puissance transformatrice. Il ne serait plus qu’un objet de consommation.
Conclusion
L’œuvre d’art peut séduire, plaire, procurer un plaisir immédiat ou profond. Mais elle peut aussi bousculer, provoquer, faire réfléchir. L’art ne se réduit donc pas à ce qui plaît : il est d’abord un espace de liberté, un dialogue entre l’artiste et le monde. Vouloir qu’il plaise toujours, c’est lui imposer une contrainte étrangère à sa nature.
En définitive, l’art n’a pas à plaire : il a à exister, à toucher, à interroger.
Ouverture : Dans une époque saturée d’images et de contenus produits pour séduire, l’art qui dérange ou déplaît n’est-il pas plus nécessaire que jamais pour réveiller les consciences et résister au conformisme ?
Dissertation n°2 :
Suffit-il de faire son devoir pour être juste?
Dans Les Misérables, Victor Hugo raconte comment Javert, représentant inflexible de la loi, poursuit Jean Valjean au nom du devoir, sans jamais prendre en compte la bonté ou les efforts de rédemption de l’homme qu’il traque. Son attitude, pourtant conforme au devoir légal, finit par apparaître comme profondément injuste. Cette scène illustre une question fondamentale : est-ce que le fait de remplir son devoir garantit que l’on agit de manière juste ?
Autrement dit, le devoir – qu’il soit moral, social ou légal – est-il un critère suffisant de justice ?
Nous verrons que si faire son devoir semble aller dans le sens de la justice, cela ne suffit pas toujours, car il faut aussi considérer l’intention, les conséquences et le contexte de l’action.
I. Faire son devoir semble a priori une condition essentielle de la justice
1. Le devoir est souvent défini comme ce que l’on doit moralement faire
Dans la pensée kantienne, le devoir repose sur la raison et l’universalité : on agit de manière juste si l’on suit des principes qui valent pour tous (l’impératif catégorique). Accomplir son devoir moral est donc la voie vers la justice.
2. Le devoir permet d’échapper aux intérêts personnels
Faire son devoir, c’est justement s’arracher aux désirs égoïstes. Par exemple, un juge qui applique la loi au nom de son devoir, sans favoritisme, semble agir de manière juste, car il se place au-dessus de ses préférences.
3. Le respect du devoir est la base du lien social et juridique
Dans une société, chacun a des devoirs : respecter les lois, autrui, les engagements. Sans cela, la justice ne peut exister. Faire son devoir, c’est donc contribuer à une forme de justice sociale et collective.
II. Mais faire son devoir ne suffit pas toujours : cela peut mener à l'injustice
1. Tous les devoirs ne sont pas justes en soi
Certains devoirs imposés par l’État ou la société peuvent être contraires à la justice morale : par exemple, obéir à des lois discriminatoires, ou suivre des ordres injustes au nom de l’obéissance. L’histoire regorge d’exemples où « faire son devoir » a conduit à l’injustice (soldats sous des régimes totalitaires, bureaucrates complices).
2. Le devoir formel peut négliger la situation concrète et humaine
L’application rigide du devoir peut ignorer les cas particuliers. Comme chez Javert, suivre la loi à la lettre peut devenir inhumain. La justice exige parfois de dépasser la règle pour prendre en compte les intentions, les circonstances, l’équité.
3. La justice suppose une visée du bien, pas seulement le respect d’une règle
Être juste, ce n’est pas seulement suivre un devoir extérieur ; c’est vouloir le bien de l’autre, faire preuve d’empathie, de discernement. Une action conforme au devoir mais faite sans souci de l’autre peut être moralement insuffisante.
III. Être juste suppose d’aller au-delà du simple devoir : discernement, responsabilité, conscience
1. La justice demande une conscience morale personnelle
Être juste, ce n’est pas seulement faire ce qu’on « doit », mais comprendre pourquoi on le fait, en conscience. La justice vient d’un choix éclairé, pas d’une simple soumission. Un résistant sous l’Occupation, par exemple, désobéissait à la loi pour rester fidèle à une justice supérieure.
2. La justice exige un jugement personnel dans des situations complexes
Les dilemmes moraux montrent que le devoir ne suffit pas : que faire quand deux devoirs s’opposent (aider un proche ou respecter une promesse) ? Être juste, c’est alors arbitrer, peser, choisir avec responsabilité.
3. La justice comme vertu dépasse l’obéissance à la règle
Depuis Aristote, la justice est une vertu, c’est-à-dire une disposition à bien agir. Elle suppose l’équité, le souci du bien commun, le courage de s’opposer à l’injustice. Ce n’est donc pas un automatisme, mais une qualité humaine supérieure.
Conclusion
Faire son devoir est un chemin important vers la justice, car il nous pousse à agir avec rigueur et à respecter les règles communes. Mais cela ne suffit pas toujours : il faut aussi de la conscience, du discernement, et parfois le courage de désobéir à un devoir injuste.
Être juste, c’est donc plus que remplir ses obligations : c’est agir avec humanité, responsabilité et sagesse.
Ouverture : Dans une société de plus en plus normative et encadrée par des lois, la question reste brûlante : comment enseigner la justice, au-delà du simple respect des règles ?
Explication de texte :
Sartre, L'être et le néant (1943)
La signification du passé est étroitement dépendante de mon projet présent. Cela ne signifie nullement que je puis faire varier au gré de mes caprices le sens de mes actes antérieurs ; mais, bien au contraire, que le projet fondamental que je suis décide absolument de la signification que peut avoir pour moi et pour les autres le passé que j'ai à être. Moi seul en effet peux décider à chaque moment de la portée du passé : non pas en discutant, en délibérant et en appréciant en chaque cas l'importance de tel ou tel événement antérieur, mais en me projetant vers mes buts, je sauve le passé avec moi et je décide par l'action de sa signification. Cette crise mystique de ma quinzième année, qui décidera si elle « a été » pur accident de puberté ou au contraire premier signe d'une conversion future ? Moi, selon que je déciderai - à vingt ans, à trente ans - de me convertir. Le projet de conversion confère d'un seul coup à une crise d'adolescence la valeur d'une prémonition que je n'avais pas prise au sérieux. Qui décidera si le séjour en prison que j'ai fait, après un vol, a été fructueux ou déplorable ? Moi, selon que je renonce à voler ou que je m'endurcis. Qui peut décider de la valeur d'enseignement d'un voyage, de la sincérité d'un serment d'amour, de la pureté d'une intention passée, etc. ? C'est moi, toujours moi, selon les fins par lesquelles je les éclaire.
Dans cet extrait de L’Être et le néant, Sartre réfléchit à la relation entre notre passé et notre liberté présente. Contre une vision déterministe qui ferait du passé un poids figé conditionnant notre être, Sartre affirme que c’est à partir de notre projet présent que le passé prend sens. Autrement dit, je décide au présent de la signification de mon passé. Cette idée exprime la radicalité de la liberté humaine selon Sartre : l’homme est ce qu’il fait. Comment le sujet peut-il donner sens à son passé sans en être prisonnier ?
Le commentaire suivra la progression du texte en trois mouvements :
Dépendance du passé vis-à-vis du projet présent.
L’exemple de la crise adolescente relue par l’avenir.
La subjectivité souveraine du moi comme seul juge du sens
1er Mouvement : Le passé dépend du projet présent (ligne 1 à 6)
« La signification du passé est étroitement dépendante de mon projet présent. Cela ne signifie nullement que je puis faire varier au gré de mes caprices le sens de mes actes antérieurs [...] je décide par l’action de sa signification. »
Sartre commence par une thèse forte : le passé n’a pas de signification « en soi », indépendamment du projet que je poursuis aujourd’hui. Cela ne veut pas dire qu’on peut déformer librement son passé ("au gré de mes caprices"), mais plutôt que c’est depuis le présent que je donne du sens à mes actes passés. Le "projet fondamental" que je suis — ma manière d’être au monde actuelle — restructure mon passé à la lumière de ce que je vise.
Il s’agit d’un renversement radical de la vision habituelle : le passé ne détermine pas le présent, c’est le présent qui éclaire le passé. Sartre emploie des termes actifs : « je décide », « je sauve », « en me projetant vers mes buts ». Il montre que l’humain n’est jamais prisonnier d’un passé fixé ; il est liberté et dépassement.
2e Mouvement : L’exemple de la crise d’adolescence (ligne 6 à 11)
« Cette crise mystique de ma quinzième année [...] Moi, selon ce que je déciderai — à vingt ans, à trente ans — de me convertir. »
Sartre illustre sa thèse par un exemple concret : une crise vécue à 15 ans peut être interprétée comme une simple "puberté" ou comme le prélude à une véritable conversion spirituelle. Le sens de cette expérience n’est pas inscrit objectivement dans l’événement lui-même, mais dépendra du sens que je lui donnerai plus tard.
Ainsi, le passé est ouvert, indéterminé tant qu’il n’est pas repris par un projet. C’est la relecture du passé par un avenir choisi qui confère à ce passé une valeur, une interprétation. Le projet de conversion "requalifie" le passé : il le sauve, le transforme, lui donne sens. L’homme est donc l’auteur de la cohérence de sa propre histoire.
3e Mouvement : La souveraineté du moi face à son histoire (ligne 11 à la fin)
« Qui décidera si le séjour en prison [...] selon les fins par lesquelles je les éclaire. »
Le texte se termine sur une série de questions rhétoriques. Toutes ces interrogations (sur le vol, la prison, un amour, un serment...) visent à montrer que le seul juge du sens du passé, c’est le moi, en fonction de son orientation présente. C’est le projet d’avenir qui réorganise rétroactivement la valeur des événements passés.
Le moi sartrien est un être de liberté, toujours capable de donner une signification nouvelle à ce qu’il a vécu. Cette liberté implique aussi une responsabilité radicale : je suis responsable du sens que je donne à mes échecs, à mes choix, à mes fautes.
Le texte se clôt sur une formule forte : « C’est moi, toujours moi, selon les fins par lesquelles je les éclaire. » — Le passé n’a de lumière que celle que je lui prête par mon projet.
Dans cet extrait de L’Être et le néant, Sartre affirme avec force la liberté du sujet existentiel : le passé ne nous détermine pas, il est reconfiguré par notre liberté présente. Loin de nous enfermer, ce que nous avons vécu prend sens à la lumière de notre projet d’être, que nous réinventons constamment.
Cette réflexion nous invite à penser l’homme non comme un être figé dans une histoire, mais comme un être en construction, engagé dans l’élaboration permanente de lui-même, libre jusque dans l’interprétation de ce qu’il a été.
Cette pensée rejoint l’idée sartrienne selon laquelle « l’existence précède l’essence » : nous ne sommes pas ce que notre passé a fait de nous, mais ce que nous choisissons d’en faire.
Vous pouvez consulter les corrigés bac 2024
Consultez les sujets en ligne
Consultez les corrigés des sujets
- Dissertations
- Sujet 1
- Comment être heureux si rien ne dure ?
- Le corrigé de la dissertation
- Toutlebacdefrancais.com
- Sujet 2
- Peut-on parler sans savoir ?
- Sujet 3
- Commentaire philosophique
- Entretiens, Epictète
Les annales de philosophie, bac 2025
-
Corrigés bac philo 2025 – Métropole (bac général) : découvrez les corrigés dès la sortie de l’épreuve
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série générale, Métropole. Sujets du 16 juin corrigés dès la sortie de l’épreuve -
Retrouvez dès la sortie des épreuves, le corrigé de philosophie bac technologique métropole 2025
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série technologique, Métropole. Sujets du 16 juin avec dissertations et commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2025 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés
Sujets corrigés philosophie bac général Amérique du Nord 2025 – découvrez les corrections, dissertations , commentaire du 20 mai. Entraînez-vous avec les corrigés -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2025
Retrouvez les sujets corrigés du bac technologique de philosophie 2025, centres étrangers groupe 1, dissertation et commentaire. -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2025
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2025 - Consultez les corrections du site -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Antilles Guyane, bacs général et technologique.
Consultez les sujets corrigés du bac de philosophie Antilles Guyane 2025, ils sont en ligne : commentaire et dissertation. Bacs général et technologique. -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique
Sujets de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations 2024 -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Polynésie française, bacs général et technologique.
Retrouvez tous les sujets corrigés de l'épreuve de philosophie 2025 de Polynésie française, ils sont en ligne sur sujetscorrigesbac.fr
Les annales de philosophie, bac 2024
-
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve Consultez les corrections proposées des dissertations et du commentaire dès la sortie de la salle d'examen -
Bac technologique philosophie 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac technologique philosophie sessions juin et septembre 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve. Consultez les corrigés, évaluez votre copie dissertation, commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés proposés
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés proposés du bac 2023 -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés du bac
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous-Centres de baccalauréat ouverts à l’étranger -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés bac du site pour le jour J. -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Polynésie française, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Polynésie française, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site et entrainez vous -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Antilles Guyane, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Antilles Guyane, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique.
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations corrigés 2023 et 2022 pour réussir votre examen
Date de dernière mise à jour : 21/05/2025