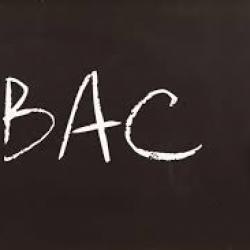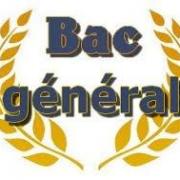Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Polynésie française, bacs général et technologique.

Corrigé du bac général 2025
Epreuve : Bac Général
Matière :Philosophie
Classe : Terminale
Centre : Polynésie française
Date : 16 juin 2025
Durée : 4h
Consultez les sujets en ligne
Dissertation n°1 :
La fréquentation des œuvres d’art est-elle une perte de temps ?
On reproche parfois à l’art de n’être qu’un divertissement superflu. Dans un monde marqué par l’urgence, la productivité et l’efficacité, passer des heures devant un tableau, un roman ou un film pourrait apparaître comme un luxe inutile, voire comme une perte de temps. Pascal, dans ses Pensées, souligne déjà le caractère ambigu du divertissement, qui détourne l’homme de ses véritables préoccupations. Pourtant, l’histoire montre que l’humanité n’a jamais cessé de produire et de fréquenter des œuvres d’art, signe que celles-ci répondent à un besoin essentiel. Dès lors, la question se pose : fréquenter les œuvres d’art, est-ce véritablement une perte de temps ou au contraire un usage essentiel de notre temps d’existence ?
Nous montrerons d’abord que l’art peut sembler vain au regard de l’exigence pratique de la vie humaine (I), puis qu’il est en réalité une école de sensibilité, de pensée et de connaissance (II), avant de comprendre que l’art n’est pas une perte mais une métamorphose du temps, qui permet à l’homme de se relier à ce qui le dépasse (III).
I. La fréquentation de l’art peut apparaître comme une perte de temps
L’exigence d’efficacité et d’utilité dans la vie pratique
Dans une perspective utilitariste, seul ce qui contribue directement à la survie, au travail ou au progrès matériel a de la valeur.
Les œuvres d’art, qui ne nourrissent pas, ne protègent pas, n’enrichissent pas directement, apparaissent comme superflues.
Exemple : Platon critique les poètes dans La République en les accusant d’être des « faiseurs d’illusions » qui détournent de la vérité et du bien.
L’art comme simple divertissement
L’art peut n’être qu’un moyen de se distraire, d’échapper aux difficultés du réel.
Pascal analyse le divertissement comme une fuite : l’homme s’y abandonne pour ne pas affronter sa condition mortelle.
Dans cette perspective, fréquenter les œuvres revient à s’aveugler et donc à perdre un temps précieux.
Le risque de consommation superficielle de l’art
Dans les sociétés modernes, la multiplication des images, des films, des spectacles peut engendrer une consommation rapide et passive.
L’art devient alors une marchandise, consommée comme n’importe quel produit de loisir.
Exemple : binge-watching de séries ou visites « touristiques » expédiées dans les musées.
Dans ce cas, la fréquentation des œuvres peut réellement ressembler à une perte de temps.
II. Mais l’art développe en réalité l’esprit, la sensibilité et la connaissance
L’art comme élévation de la sensibilité
L’œuvre d’art éduque le regard, l’oreille, le goût.
Elle apprend à percevoir le monde autrement, avec plus d’acuité.
Kant, dans la Critique de la faculté de juger, montre que le jugement esthétique repose sur une satisfaction désintéressée, ce qui affine notre faculté de juger.
L’art comme accès à la vérité humaine
Les œuvres ne sont pas de simples fictions : elles expriment des vérités sur l’homme et son monde.
Exemple : les tragédies de Sophocle révèlent la fatalité et la complexité des choix humains ; les romans de Balzac dévoilent les mécanismes sociaux.
Nietzsche dira que « nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité », ce qui souligne sa fonction vitale.
L’art comme ouverture à l’universalité
Fréquenter des œuvres, c’est entrer dans des univers culturels différents et dépasser son horizon limité.
L’art crée une communauté d’expériences et d’émotions partagées.
Exemple : la musique de Beethoven émeut encore aujourd’hui des auditeurs de toutes cultures.
Ainsi, l’art n’est pas une perte mais un gain de compréhension et d’humanité.
III. L’art transforme le rapport au temps : il n’est pas perdu mais intensifié
L’expérience esthétique comme suspension du temps
L’art offre des moments où le temps ordinaire est suspendu : le spectateur se trouve absorbé par une œuvre.
C’est une forme d’intensité du présent, qui n’est pas perte mais accomplissement.
Exemple : l’extase devant une œuvre picturale ou musicale.
L’art comme mémoire et transmission
Les œuvres d’art fixent dans le temps des expériences, des visions du monde, et les transmettent à travers les siècles.
Regarder une fresque de la Renaissance ou lire Homère, c’est se relier à l’humanité passée.
Cette continuité donne sens au temps, loin de le gaspiller.
L’art comme promesse d’éternité
L’art ne se contente pas d’occuper le temps : il lui donne une dimension intemporelle.
Hegel dans son Esthétique affirme que l’art manifeste l’Esprit absolu : il révèle la liberté humaine et son rapport à l’infini.
Ainsi, fréquenter les œuvres, c’est élargir l’horizon de la vie au-delà de l’utile et du mortel.
Fréquenter les œuvres d’art peut sembler au premier abord une perte de temps, tant elles ne produisent rien de directement utile ou matériel. Mais en réalité, l’art élargit notre regard, approfondit notre sensibilité et nous relie à l’humanité universelle. Plus encore, il transforme notre rapport au temps en intensifiant notre expérience du présent et en nous inscrivant dans une continuité historique et spirituelle.
Ainsi, loin d’être une perte, la fréquentation des œuvres d’art est une manière de donner sens à notre temps d’existence. Perdre du temps avec l’art, c’est en vérité apprendre à mieux habiter le temps.
Ouverture : On peut alors se demander si, à l’inverse, ce n’est pas la vie réduite au seul travail et à l’utilité qui constitue la véritable perte de temps, puisqu’elle nous prive de cette dimension esthétique et spirituelle qui fait la valeur même de l’existence.
Dissertation n°2 :
Peut-on combattre une croyance par le raisonnement ?
Dans la vie quotidienne comme dans l’histoire des sociétés, les croyances occupent une place considérable. On croit en l’existence de Dieu, à l’efficacité d’un remède, à des superstitions, ou encore à des idéologies politiques. Mais qu’est-ce qu’une croyance ? On peut la définir comme une adhésion de l’esprit à une idée que l’on ne peut pas justifier de façon pleinement rationnelle et démontrable. À l’inverse, le raisonnement suppose l’usage de la logique et de l’argumentation rationnelle, fondé sur des preuves ou sur des principes cohérents.
Dès lors, une question cruciale se pose : si la croyance repose sur une conviction affective ou sociale, peut-elle être ébranlée, combattue, voire détruite par la seule force du raisonnement ?
Nous verrons d’abord que le raisonnement a pour vocation de remplacer la croyance par le savoir et peut donc la combattre (I). Mais nous montrerons ensuite que la croyance a une dimension affective et existentielle qui échappe aux démonstrations rationnelles (II). Enfin, nous chercherons à dépasser cette opposition en montrant que si le raisonnement ne suffit pas à vaincre une croyance, il peut la transformer et la réorienter (III).
I. Le raisonnement peut combattre les croyances en les soumettant à l’examen critique
La croyance s’oppose au savoir rationnel
Croire, c’est admettre sans preuve, tandis que savoir suppose une justification rationnelle.
Exemple : croire que le Soleil tourne autour de la Terre, c’est une illusion que la science (Copernic, Galilée) a réfutée par raisonnement.
Ici, la croyance peut être détruite par une démonstration scientifique.
La méthode critique des philosophes et des savants
Socrate, dans les dialogues platoniciens, combat les croyances de ses interlocuteurs en les interrogeant, jusqu’à les amener à reconnaître leurs contradictions.
Descartes, dans son Discours de la méthode, propose de rejeter toutes les opinions incertaines pour ne garder que les vérités claires et distinctes.
Le raisonnement devient un instrument de purification des croyances.
Le rôle de l’éducation et de la diffusion du savoir
Par l’enseignement des sciences, des règles de logique, on peut libérer les esprits des croyances fausses et irrationnelles.
Exemple : l’enseignement de la théorie de l’évolution a permis de remplacer des croyances fixistes par une explication scientifique.
Ainsi, le raisonnement semble capable de combattre efficacement les croyances.
II. Mais la croyance possède une dimension affective et sociale qui résiste au raisonnement
La croyance comme réponse au besoin d’espérance
Pascal distingue entre l’esprit de géométrie (raison) et l’esprit de finesse (cœur) : certaines croyances, comme la foi religieuse, relèvent du cœur plus que de la raison.
La croyance donne du sens à l’existence, ce que le raisonnement abstrait ne peut pas remplacer.
La force des habitudes et des traditions
Beaucoup de croyances sont transmises par l’éducation, la culture et les coutumes.
Même face à des arguments rationnels, elles continuent à s’imposer par la force de la tradition.
Exemple : certaines superstitions persistent malgré leur absurdité (porter un porte-bonheur, craindre le vendredi 13).
Le rôle de l’inconscient et de l’irrationnel
Freud montre que certaines croyances sont profondément enracinées dans les désirs inconscients.
Le raisonnement n’a pas de prise sur ces forces affectives.
Exemple : croire en des complots malgré toutes les preuves contraires.
Ainsi, le raisonnement ne peut pas toujours combattre efficacement la croyance.
III. Le raisonnement ne supprime pas la croyance, mais il peut la transformer et l’orienter
De la croyance aveugle à la croyance raisonnable
Kant distingue l’opinion, la croyance et le savoir. Certaines croyances peuvent être rationnellement justifiées, sans être démontrables.
Exemple : la croyance en l’existence d’autrui ou en l’ordre de la nature : ce sont des croyances nécessaires pour agir.
Le raisonnement ne détruit pas ici la croyance mais l’éclaire.
La fonction régulatrice des croyances rationnelles
Certaines croyances orientent l’action et donnent sens à la vie sans être des illusions.
Exemple : la croyance en la dignité de l’homme fonde les droits de l’homme.
Le raisonnement peut transformer des croyances irrationnelles en principes rationnellement discutables.
Un dialogue entre raison et croyance
Plutôt que d’opposer radicalement raison et croyance, il faut reconnaître que le raisonnement peut corriger et élever les croyances.
Exemple : dans la philosophie de Ricoeur, la foi religieuse peut entrer en dialogue avec la raison critique.
Ainsi, le raisonnement ne détruit pas la croyance mais la rend plus lucide.
Le raisonnement peut, en un sens, combattre les croyances, lorsqu’elles reposent sur des illusions ou des erreurs que la science et la critique intellectuelle mettent en lumière. Mais la croyance a une dimension affective, sociale et existentielle qui la rend résistante aux arguments rationnels : il ne suffit pas de démontrer pour convaincre.
Ainsi, si l’on ne peut pas toujours éradiquer une croyance par le raisonnement, on peut au moins la transformer, en l’éclairant et en la rendant plus consciente. La raison ne supprime pas toutes les croyances, mais elle permet de distinguer celles qui sont aveugles et dangereuses de celles qui sont fécondes et nécessaires.
Ouverture : On peut alors se demander si l’homme peut jamais se passer totalement de croyances, ou si, même dans le domaine scientifique, nous avons toujours besoin d’une part de confiance et d’adhésion qui dépasse le pur raisonnement.
Explication de texte :
Dans Les Lois, Platon réfléchit aux conditions qui permettent de fonder une cité juste. Ici, il s’intéresse à ce qui, dans l’âme humaine, empêche la recherche du vrai et du bien : l’amour de soi, ou philautia. Loin de le considérer comme un penchant naturel excusable, il y voit un mal radical : il engendre l’aveuglement, l’illusion de savoir et l’égoïsme qui empêchent de reconnaître la justice.
Le problème soulevé est donc le suivant : comment l’excès d’amour de soi fausse-t-il notre jugement moral et intellectuel, et quelle attitude permet de s’en libérer ?
Analyse du texte
a) L’amour de soi comme indulgence envers soi-même
Platon commence par constater que « chacun est pour lui-même plein d’indulgence » : l’homme tend naturellement à excuser ses propres défauts. On appelle cela « amour de soi », que certains considèrent comme légitime. Mais Platon nuance : en réalité, cet amour excessif de soi est la racine de toutes nos fautes.
b) L’aveuglement du jugement par l’intérêt personnel
L’amour de soi conduit à un biais : celui qui aime se rend aveugle aux défauts de ce qu’il aime. Par conséquent, l’individu juge mal ce qui est juste, bon et beau. Au lieu de suivre la vérité, il donne la priorité à son intérêt particulier. Platon dénonce donc un conflit entre intérêt personnel et recherche du vrai.
c) La véritable grandeur : aimer le juste plus que soi-même
Platon propose un renversement : le véritable grand homme n’est pas celui qui se privilégie lui-même, mais celui qui aime la justice, même lorsque l’action juste vient d’autrui. Autrement dit, il faut mettre la vérité et le juste au-dessus de l’amour de soi.
d) L’illusion de savoir : une autre conséquence de l’amour de soi
Cet égocentrisme explique aussi un autre mal : l’illusion de savoir. Parce qu’il s’aime trop, l’homme se croit savant alors qu’il est ignorant. Il refuse de laisser faire les autres, même dans les domaines qu’il ne maîtrise pas. Il s’obstine à agir lui-même, et se trompe. Ici, Platon rejoint la critique qu’il formule dans d’autres dialogues (comme dans L’Apologie de Socrate) : le pire n’est pas de ne pas savoir, mais de croire que l’on sait.
e) La solution : fuir l’amour excessif de soi et chercher meilleur que soi
La conclusion est claire : il faut échapper à la philautia en reconnaissant ses limites et en acceptant de s’instruire auprès de plus sage que soi. Il ne faut pas avoir honte de reconnaître qu’autrui est meilleur, car c’est la seule voie vers la vérité et la justice.
Discussion critique
Le texte met en lumière un paradoxe universel : l’amour de soi, qui semble naturel et légitime, devient un obstacle à la connaissance et à la vertu lorsqu’il est excessif. Platon prône une exigence de dépassement de soi : l’homme doit se tourner vers le juste et non vers son intérêt particulier, et reconnaître l’autorité des plus sages.
Ce passage a plusieurs prolongements :
Éthique : il annonce la distinction chrétienne entre « amour de soi » (légitime) et « amour-propre » (pernicieux), que développera Pascal.
Épistémologie : il rappelle la leçon socratique : « Je sais que je ne sais rien ». Le véritable savant est celui qui reconnaît ses limites.
Politique : une cité juste ne peut se construire que si ses citoyens acceptent de ne pas se croire omniscients et de suivre des lois inspirées par la raison.
Platon montre que l’amour excessif de soi est une racine de l’erreur morale et intellectuelle : il pousse à préférer son intérêt à la vérité, et à confondre ignorance et savoir. La véritable sagesse suppose de mettre le juste au-dessus de soi et d’accepter de recevoir d’autrui la lumière que l’on n’a pas soi-même.
Ouverture : On peut alors se demander si l’homme peut totalement échapper à l’amour de soi, ou si le problème n’est pas plutôt de le transformer en une exigence d’estime de soi légitime, qui ne s’oppose pas à la recherche du vrai.
Vous pouvez consulter les corrigés bac 2024
Consultez les sujets en ligne
Consultez les corrigés du site
Corrigé du bac technologique
Epreuve : Bac technologique
Matière :Philosophie
Classe : Terminale
Centre : Polynésie française
Date : juin 2025
Durée : 4h
Consultez les sujets en ligne
Dissertation n°1 :
Sujet 1 Peut-on être indifférent à la vérité ?
La vérité se définit communément comme l’accord de la pensée avec la réalité, ce qui est, indépendamment de nos opinions ou croyances. Or, dans la vie courante, nous sommes souvent confrontés à des discours mensongers, à des illusions ou encore à des croyances subjectives. Mais peut-on réellement se montrer indifférent à la vérité, c’est-à-dire n’accorder aucune importance au fait de savoir ce qui est vrai ou faux ?
Cette question est cruciale car elle touche à la valeur même de notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes : l’homme peut-il vivre sans souci de vérité, ou bien la recherche de celle-ci est-elle constitutive de notre condition rationnelle et morale ?
Problématique : L’indifférence à la vérité est-elle une attitude possible et légitime, ou bien la vérité s’impose-t-elle toujours comme un horizon nécessaire pour l’existence humaine ?
Annonce du plan : Nous montrerons d’abord qu’il semble possible d’être indifférent à la vérité, notamment dans la vie quotidienne ou pour des raisons de confort. Nous verrons ensuite que cette indifférence est en réalité difficilement soutenable, car la vérité a une valeur vitale et rationnelle. Enfin, nous examinerons si l’attitude la plus juste n’est pas de reconnaître que la vérité importe, tout en admettant ses limites et en cultivant une relation lucide et critique avec elle.
I. L’indifférence à la vérité semble possible
Dans la vie courante, le faux peut suffire à vivre.
Beaucoup se contentent d’illusions ou de croyances, tant que cela rend leur existence supportable (exemple : illusions amoureuses, superstitions). Comme le suggère Nietzsche, « l’illusion est nécessaire à la vie », et certains préfèrent la consolation à la lucidité.
La vérité peut apparaître comme une exigence secondaire.
Dans certains domaines, seule l’efficacité ou l’utilité comptent, non la vérité (exemple : publicités, discours politiques). On peut donc se montrer indifférent à la vérité si l’objectif est simplement de convaincre ou de réussir.
L’indifférence peut protéger du désespoir.
Savoir la vérité sur certaines réalités (maladies, avenir tragique, absurdité de l’existence) peut être insupportable. Alors, l’indifférence à la vérité devient un mécanisme de défense psychologique.
II. Mais en réalité, la vérité demeure incontournable
L’homme est un être de raison : il cherche naturellement la vérité.
Comme le dit Aristote dans la Métaphysique, « tous les hommes désirent naturellement savoir ». L’indifférence est donc contre-nature pour un être doué de raison et de langage.
La vérité est vitale pour l’action.
Sans vérité, nos décisions seraient aveugles et inefficaces. Par exemple, pour se soigner, il faut connaître la vérité médicale ; pour agir politiquement, il faut savoir ce qui est réellement le cas.
L’indifférence ouvre la voie à la manipulation et au mensonge.
Si les individus se montrent indifférents à la vérité, ils deviennent vulnérables aux discours trompeurs. La recherche de la vérité est une condition de liberté (cf. Kant : l’autonomie repose sur la connaissance et la raison).
III. Vers une juste attitude face à la vérité
La vérité est un idéal, mais elle reste relative dans certains domaines.
Dans les sciences, la vérité est toujours révisable. Dans l’art ou la morale, il n’existe pas de vérité unique. Il faut donc distinguer les niveaux de vérité.
Plutôt que l’indifférence, il faut un rapport critique à la vérité.
Comme le rappelle Descartes, l’esprit doit éviter la crédulité mais aussi le scepticisme radical : il s’agit de chercher la vérité sans prétendre la posséder absolument.
La vérité ne vaut que si elle est orientée vers la vie humaine.
Nietzsche souligne que la vérité n’a de sens que si elle sert l’existence, et non si elle l’écrase. L’attitude juste serait donc de chercher la vérité, tout en reconnaissant ses limites et ses usages.
Il semble qu’on puisse, dans certains cas, se détourner de la vérité, par facilité, par confort ou par nécessité. Mais cette indifférence ne peut être qu’apparente ou passagère : en tant qu’êtres rationnels et libres, nous avons besoin de vérité pour comprendre, agir et exister authentiquement. Toutefois, plutôt qu’une quête naïve ou absolue, la juste attitude est une recherche lucide, critique et vivante de la vérité, adaptée aux différents domaines de l’existence.
Ouverture : Peut-être faudrait-il, au-delà de la question de la vérité, se demander si ce qui importe avant tout à l’homme n’est pas le sens — sens qui peut se nourrir de vérités objectives, mais aussi de fictions, de récits ou de valeurs.
Dissertation n°2 :
Sujet 2 Le but de l’artiste est-il de plaire au plus grand nombre ?
L’art traverse toutes les époques et se décline sous des formes variées : peinture, musique, littérature, cinéma. Mais à quoi vise-t-il fondamentalement ? On pourrait penser que l’artiste cherche à séduire le public, à plaire au plus grand nombre, car c’est ce qui assurerait la reconnaissance et la diffusion de son œuvre. Pourtant, réduire l’art à une simple recherche de popularité semble problématique : l’art n’est-il pas aussi une quête de vérité, d’expression personnelle, voire de critique du monde ?
Problématique : L’artiste a-t-il pour finalité essentielle de plaire au public majoritaire, ou bien poursuit-il un but plus profond, qui peut aller jusqu’à déplaire ?
Annonce du plan : Nous verrons d’abord que l’art peut effectivement viser à plaire au plus grand nombre. Nous montrerons ensuite que l’art ne saurait se réduire à cette recherche, car il exprime une vérité singulière. Enfin, nous examinerons si le véritable but de l’art n’est pas d’émouvoir et d’interroger, au-delà du simple plaisir et du nombre.
I. L’art peut viser à plaire au plus grand nombre
L’art comme divertissement.
Depuis l’Antiquité (les spectacles romains, le théâtre), l’art a souvent pour fonction de distraire et de plaire. Au cinéma ou dans la musique populaire, le succès est mesuré par le nombre de spectateurs ou d’auditeurs.
La reconnaissance passe par l’approbation du public.
Un artiste isolé, sans auditoire, risque de rester inconnu. Plaire au plus grand nombre peut donc être une stratégie de survie artistique et matérielle.
L’art répond à un besoin universel de beauté.
Comme le souligne Kant dans sa Critique de la faculté de juger, le beau a une prétention à l’universalité : il tend à susciter un plaisir partagé. L’artiste peut donc naturellement viser à produire une émotion esthétique accessible à tous.
II. Mais l’art ne peut pas se réduire à plaire
L’artiste exprime avant tout sa subjectivité.
L’art n’est pas qu’un produit de consommation : il est l’expression d’une vision singulière du monde. Van Gogh ou Kafka, par exemple, n’ont pas plu à leur époque, mais leur art a révélé une vérité qui dépasse la simple séduction.
L’art peut choquer plutôt que plaire.
Certaines œuvres dérangent ou scandalisent (les tableaux de Goya, les pièces de Beckett, les performances contemporaines). Leur but n’est pas de flatter le goût commun, mais de questionner, voire de troubler.
Le goût du plus grand nombre peut être superficiel.
Ce que Platon critiquait déjà dans La République : l’art qui vise uniquement à séduire les foules tombe dans la démagogie ou la flatterie, et perd sa valeur de vérité.
III. Le véritable but de l’art : émouvoir, interroger, transformer
L’art vise à éveiller la sensibilité.
Au-delà du simple plaisir, l’art cherche à provoquer une émotion profonde, qui peut être joie, tristesse, indignation ou nostalgie. Aristote, avec la catharsis du théâtre, montre que l’art purifie les passions en les mettant en scène.
L’art a une fonction critique et existentielle.
Il ne cherche pas seulement à plaire, mais à dévoiler une vérité sur le monde, à interroger la condition humaine (exemple : Picasso avec Guernica).
L’art peut plaire, mais indirectement.
En touchant profondément, en questionnant, l’art finit par rencontrer un public, parfois bien après la mort de l’artiste. Le but n’est donc pas de viser le plus grand nombre, mais de créer une œuvre authentique qui pourra éventuellement plaire.
Si l’art peut chercher à plaire au plus grand nombre, notamment dans ses formes populaires ou divertissantes, il ne saurait se réduire à cette visée. L’artiste poursuit avant tout une recherche de vérité, d’émotion et d’expression, qui peut aller jusqu’à choquer ou déplaire. Le véritable but de l’art est moins de flatter que de transformer notre regard sur le monde.
Ouverture : On pourrait alors se demander si l’art ne se définit pas moins par sa finalité que par sa liberté : l’art n’a-t-il pas pour but premier d’être libre, sans obligation de plaire ni de déplaire ?
Explication de texte :
Sujet 3 Expliquez le texte suivant :
La justice et le respect des contrats semblent faire l'accord du plus grand nombre ; c'est un principe qui, pense-t-on, pénètre jusque dans les repaires de brigands, et dans les bandes des plus grands malfaiteurs ; et ceux qui sont allés le plus loin dans l'abandon de leur humanité respectent la fidélité et la justice entre eux. Je reconnais que les hors-la-loi eux-mêmes les respectent entre eux ; mais ces règles ne sont pas respectées comme des lois de nature innées1 : elles sont appliquées comme des règles utiles dans leur communauté ; et on ne peut concevoir que celui qui agit correctement avec ses complices mais pille et assassine en même temps le premier honnête homme venu, embrasse la justice comme un principe pratique2. La justice et la vérité sont les liens élémentaires de toute société : même les hors-la-loi et les voleurs, qui ont par ailleurs rompu avec le monde, doivent donc garder entre eux la fidélité et les règles de l'équité, sans quoi ils ne pourraient rester ensemble. Mais qui soutiendrait que ceux qui vivent de fraude et de rapine3 ont des principes innés de vérité et de justice, qu'ils acceptent et reconnaissent ?
Locke, Essai sur l'entendement humain (1690).
- A - Éléments d’analyse :
- 1. Que permet d’établir le recours aux exemples des « hors-la-loi » et des « voleurs » ?
- 2. Quelle différence Locke pose-t-il entre des « lois de nature innées » et des « règles utiles » ?
- 3. Expliquez la phrase suivante : « La justice et la vérité sont les liens élémentaires de toute société ».
- B - Éléments de synthèse :
- 1. Quelle est la question à laquelle répond le texte ?
- 2. Dégagez les différents moments de l’argumentation de l’auteur.
- 3. En vous appuyant sur les éléments précédents, dégagez l’idée principale du texte.
- C - Commentaire :
- 1. Si le droit dépend des circonstances, faut-il renoncer à l'idée d'une justice pour tous les hommes ?
- 2. Avoir des intérêts communs, est-ce suffisant pour fonder une société ?
A – Éléments d’analyse
1. Que permet d’établir le recours aux exemples des « hors-la-loi » et des « voleurs » ?
Locke prend l’exemple extrême des brigands pour montrer que même ceux qui rejettent les lois sociales doivent conserver entre eux un minimum de règles de justice et de fidélité. Cela prouve que la justice n’est pas seulement une invention des sociétés policées, mais une condition minimale de toute vie commune, même chez ceux qui vivent en marge de la loi.
2. Quelle différence Locke pose-t-il entre des « lois de nature innées » et des « règles utiles » ?
Une loi de nature innée serait une règle inscrite dans l’esprit humain dès la naissance, une disposition universelle et spontanée à respecter la justice. Or, selon Locke, il n’existe pas de tels principes innés : si les hors-la-loi respectent certaines règles entre eux, ce n’est pas par vertu naturelle mais par intérêt, parce que ces règles leur sont utiles pour maintenir leur groupe uni.
3. Expliquez la phrase suivante : « La justice et la vérité sont les liens élémentaires de toute société ».
Locke affirme ici que sans justice (respect des engagements, équité) et sans vérité (fidélité à la parole donnée), aucune société ne peut subsister. Ces principes ne sont pas forcément innés, mais ils constituent des conditions de possibilité de toute vie collective. Autrement dit, ils sont le ciment qui relie les individus entre eux.
B – Éléments de synthèse
1. Quelle est la question à laquelle répond le texte ?
Le texte répond à la question suivante : la justice est-elle un principe inné de la nature humaine, ou bien résulte-t-elle simplement d’un calcul d’intérêt et d’utilité dans la vie commune ?
2. Dégagez les différents moments de l’argumentation de l’auteur.
Locke commence par constater que même les hors-la-loi respectent entre eux des règles de justice.
Puis il distingue deux manières de comprendre cela : soit on pense que ces règles sont naturelles et innées, soit on voit qu’elles ne sont que des conventions utiles.
Enfin, il conclut que la justice et la vérité sont nécessaires pour maintenir toute société, mais qu’elles n’ont pas besoin d’être innées pour jouer ce rôle.
3. En vous appuyant sur les éléments précédents, dégagez l’idée principale du texte.
L’idée principale est que la justice et la vérité ne sont pas des principes naturels innés de l’homme, mais des règles utiles et nécessaires au maintien de toute société, y compris les sociétés marginales comme celles des brigands.
C – Commentaire
1. Si le droit dépend des circonstances, faut-il renoncer à l'idée d'une justice pour tous les hommes ?
Locke montre que la justice n’est pas innée, mais qu’elle est nécessaire par convention. Cependant, cela ne conduit pas à renoncer à l’idée d’une justice universelle. Même si les formes juridiques varient selon les sociétés et les circonstances, le besoin de règles de vérité et de justice est universel, car toute société repose sur elles. On peut donc défendre l’idée d’un fondement rationnel universel du droit (comme le fera plus tard Kant avec l’idée d’un droit cosmopolitique), même si son application concrète varie.
2. Avoir des intérêts communs, est-ce suffisant pour fonder une société ?
Les intérêts communs suffisent à créer des associations temporaires (comme une bande de brigands), mais cela ne suffit pas pour fonder une véritable société politique. Une société durable suppose non seulement l’intérêt, mais aussi des règles reconnues comme légitimes par tous, qui dépassent l’utilité immédiate. Autrement dit, l’intérêt fonde la coopération, mais seule la reconnaissance d’un principe de justice partagé fonde une société stable et authentiquement humaine.
En résumé :
- Locke montre que la justice n’est pas innée mais découle de l’utilité.
- Elle reste cependant indispensable à toute vie en société.
- Les intérêts communs ne suffisent pas : il faut que les règles de justice et de vérité soient reconnues comme nécessaires pour que la société tienne durablement.
Consultez les sujets du bac 2024
Consultez les sujets en ligne
Téléchargez les sujets
Les annales du bac de philosophie 2025
-
Corrigés bac philo 2025 – Métropole (bac général) : découvrez les corrigés dès la sortie de l’épreuve
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série générale, Métropole. Sujets du 16 juin corrigés dès la sortie de l’épreuve -
Retrouvez dès la sortie des épreuves, le corrigé de philosophie bac technologique métropole 2025
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série technologique, Métropole. Sujets du 16 juin avec dissertations et commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2025 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés
Sujets corrigés philosophie bac général Amérique du Nord 2025 – découvrez les corrections, dissertations , commentaire du 20 mai. Entraînez-vous avec les corrigés -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2025
Retrouvez les sujets corrigés du bac technologique de philosophie 2025, centres étrangers groupe 1, dissertation et commentaire. -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2025
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2025 - Consultez les corrections du site -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Antilles Guyane, bacs général et technologique.
Consultez les sujets corrigés du bac de philosophie Antilles Guyane 2025, ils sont en ligne : commentaire et dissertation. Bacs général et technologique. -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique
Sujets de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations 2024 -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Polynésie française, bacs général et technologique.
Retrouvez tous les sujets corrigés de l'épreuve de philosophie 2025 de Polynésie française, ils sont en ligne sur sujetscorrigesbac.fr
Les annales du bac de philosophie 2024
-
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve Consultez les corrections proposées des dissertations et du commentaire dès la sortie de la salle d'examen -
Bac technologique philosophie 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac technologique philosophie sessions juin et septembre 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve. Consultez les corrigés, évaluez votre copie dissertation, commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés proposés
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés proposés du bac 2023 -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés du bac
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous-Centres de baccalauréat ouverts à l’étranger -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés bac du site pour le jour J. -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Polynésie française, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Polynésie française, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site et entrainez vous -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Antilles Guyane, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Antilles Guyane, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique.
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations corrigés 2023 et 2022 pour réussir votre examen
Date de dernière mise à jour : 20/09/2025