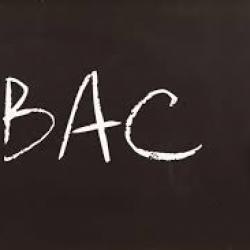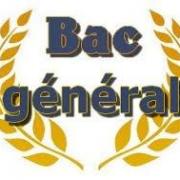Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2025

Centres de baccalauréat ouverts à l’étranger - session 2025. Entraînez-vous avec les corrections proposées du site pour le jour J
Epreuve : Bac technologique
Matière :Philosophie
Classe : Terminale
Centre : Centres étrangers groupe 1
Date : 11 juin 2025
Durée : 4h
Consultez les sujets en ligne
Sujet 1
A-t-on besoin d’artistes ?
Sujet 2
Pourquoi être juste ?
Sujet 3
Expliquer le texte suivant :
Les chevaux ont des sabots pour fouler le givre et la neige. Ils ont une robe qui les protège de la bise et de la froidure. Ils broutent l’herbe, boivent l’eau, lèvent les pattes et galopent. Telle est la véritable nature des chevaux. Ils n’ont que faire des manèges et des écuries. Un jour Po-lo 1 survint. Il déclara : « Je vais m’occuper des chevaux. » Il les brûla, les tailla, les perça, les brida ; il les lia avec des longes et des entraves ; il les parqua dans des enclos. Il en mourut trois sur dix. Il leur fit endurer la faim et la soif ; il les contraignit à prendre le trot ou le galop. Il les accoutuma à s’aligner et à se mouvoir de concert ; il leur imposa, devant, la torture du mors 2 et leur agita, derrière, la menace de la cravache. Il en mourut la moitié.
Le potier déclara : « Je sais pétrir la glaise. » Il la façonna au compas et à l’équerre pour obtenir des formes rondes ou carrées. Le charpentier décréta : « Je sais travailler le bois. » Il ploya les parties courbes à la forme à cintrer 3, rectifia les parties droites au cordeau. Était-il dans la nature de la glaise et du bois de se voir appliquer le compas, l’équerre et les instruments pour former des droites et des courbes ? Et pourtant de génération en génération on ne cesse de proclamer : « Po-lo sut dresser les chevaux, le potier façonner l’argile, le charpentier courber le bois. » Ceux qui prétendent gouverner le monde présentent le même défaut. Je considère, moi, que ceux qui savent réellement gouverner s’y prennent tout autrement. Si on laisse les gens s’abandonner à leur constitution naturelle, ils se contentent de tisser la toile pour se vêtir, de labourer pour se nourrir ; par là se manifeste une vertu commune, ils sont tous unis et il n’y a pas de partis. C’est ce qu’on appelle la liberté naturelle.
Tchouang Tseu, OEuvres complètes, chapitre 9 (IVème siècle av. J.-C)
1 Po-lo est un dresseur de chevaux légendaire.
2 Le mors est une pièce métallique qui passe dans la bouche du cheval.
3 Forme à cintrer : instrument pour imposer une forme courbe.
Rédaction de la copie
Le candidat a le choix entre deux manières de rédiger l’explication de texte.
Il peut :
- soit répondre dans l’ordre, de manière précise et développée, aux questions posées (option n°1);
- soit suivre le développement de son choix (option n°2).
Il indique son option de rédaction (option n°1 ou option n°2) au début de sa copie.
Questions de l’option n°1
A) Éléments d’analyse
1. En prenant appui sur l’exemple du dressage des chevaux, montrez les effets que produit la technique sur la nature.
2. Expliquez la phrase : « Était-il dans la nature de la glaise et du bois de se voir appliquer le compas, l’équerre et les instruments pour former des droites et des courbes ? »
3. Quel est le défaut de « ceux qui prétendent gouverner le monde » ?
B) Éléments de synthèse
1. Quelle est la question à laquelle l’auteur tente de répondre ici ?
2. Dégagez les différents moments de l’argumentation.
3. En vous appuyant sur les éléments précédents, dégagez l’idée principale du texte.
C) Commentaire
1. La technique est-elle contre-nature ?
2. Suivre notre constitution naturelle, est-ce le fondement de notre liberté ?
Dissertation n°1 :
« A-t-on besoin d’artistes ? »
L’artiste semble occuper une place particulière dans nos sociétés : il crée, imagine, dérange parfois, mais aussi enchante. Pourtant, dans un monde marqué par l’utilité, la productivité et l’efficacité, on peut s’interroger sur le rôle réel des artistes. Sont-ils indispensables au bon fonctionnement de nos vies ? Ou bien sont-ils seulement des luxes culturels, dont on pourrait se passer sans véritable perte ?
Dès lors, nous pouvons poser la question :
A-t-on vraiment besoin d’artistes ?
Autrement dit : leur présence est-elle essentielle à notre existence individuelle et collective ?
Nous verrons d’abord que les artistes ne semblent pas répondre à un besoin vital ou matériel (I), avant de montrer que leur rôle est pourtant essentiel pour nourrir notre esprit, notre liberté et notre humanité (II).
I. Les artistes ne paraissent pas nécessaires au sens strict
Un besoin désigne en général quelque chose d’indispensable à la survie ou au bien-être (comme se nourrir, se loger, se soigner). Or, les artistes ne produisent rien de vital au sens biologique du terme.
Dans une vision utilitariste, ce sont plutôt les médecins, les ingénieurs ou les agriculteurs qui semblent vraiment nécessaires. L’artiste, lui, serait superflu : il n’apporte rien de concret ou de mesurable.
De plus, certaines œuvres artistiques peuvent choquer, déstabiliser, ou sembler incompréhensibles. On pourrait donc penser que l’art est un luxe culturel, agréable mais non essentiel.
→ Selon cette approche, on n’a pas besoin des artistes pour vivre, mais seulement pour se distraire ou se cultiver.
II. Pourtant, les artistes jouent un rôle fondamental dans nos vies
Cependant, réduire l’existence humaine à ses seuls besoins matériels serait oublier une dimension essentielle de l’homme : sa vie intérieure, sa sensibilité, son imagination.
L’art permet d’exprimer l’indicible, de mettre en forme des émotions, de questionner le monde. L’artiste ne se contente pas de décorer le réel : il nous aide à le voir autrement.
Comme le dit Nietzsche, « l’art nous est donné pour ne pas mourir de la vérité ». Les artistes ouvrent notre regard, nous aident à supporter la complexité du monde, à mieux nous comprendre nous-mêmes.
Dans certaines sociétés, les artistes ont aussi été des passeurs de mémoire, des résistants, des révélateurs de ce que l’on ne voulait pas voir (ex. : Picasso avec Guernica, les écrivains engagés, les rappeurs des banlieues…).
En ce sens, les artistes sont nécessaires non pas pour survivre, mais pour vivre pleinement, avec conscience, sensibilité et esprit critique.
Nous avons vu que les artistes ne répondent pas à un besoin vital au sens matériel du terme. Pourtant, leur rôle dépasse la simple distraction : ils enrichissent notre pensée, notre regard, notre rapport à l’existence.
En ce sens, oui, nous avons besoin d’artistes, non pas pour vivre comme des machines, mais pour vivre en êtres humains sensibles, lucides et libres.
Dissertation n°2 :
Pourquoi être juste ? »
Être juste, c’est respecter les droits d’autrui, agir équitablement, sans favoritisme ni injustice. Dans la vie quotidienne, on attend des autres qu’ils soient justes : dans les lois, dans les relations, au travail ou à l’école. Mais cette exigence morale peut poser question. En effet, être juste peut parfois nous désavantager, nous contraindre ou aller contre notre intérêt personnel.
Dès lors, on peut se demander :
Pourquoi être juste ?
Autrement dit : quelles raisons avons-nous d’agir avec justice, même quand cela nous coûte ?
Nous verrons d’abord que la justice semble nécessaire pour vivre ensemble (I), puis qu’elle est aussi une exigence morale (II), avant de nous interroger sur ses limites et les tensions entre justice et intérêt personnel (III).
I. Être juste est nécessaire à la vie en société
La justice permet de réguler les relations humaines : sans elle, ce serait la loi du plus fort, le chaos, la violence.
Les règles justes assurent la paix sociale, la confiance, la coopération. On a donc intérêt à ce que la justice existe, même si elle nous contraint parfois.
C’est ce que montre Platon dans La République : la justice dans la cité permet à chacun d’occuper sa place, d’être protégé, de vivre en sécurité.
→ Être juste, c’est accepter des règles pour que la société fonctionne harmonieusement, et que chacun y trouve sa place.
II. Être juste, c’est répondre à une exigence morale
La justice ne se réduit pas à l’intérêt collectif : elle implique aussi une valeur morale, un respect du droit, de l’égalité et de la dignité de chacun.
Être juste, c’est reconnaître que les autres comptent autant que nous, et qu’il est mal de leur nuire pour notre propre avantage.
C’est ce que défend Kant : la justice repose sur l’idée que l’être humain doit toujours être traité comme une fin, jamais comme un moyen. Agir justement, c’est respecter la valeur morale de toute personne.
→ Même quand cela ne nous rapporte rien, la justice est un devoir, un exigence de respect envers autrui.
III. Peut-on toujours être juste ? Les limites de la justice
Pourtant, être juste peut être difficile quand la loi elle-même est injuste (lois racistes, discriminatoires…). Dans ce cas, doit-on obéir ou désobéir ?
Thoreau, dans son texte La Désobéissance civile, défend l’idée qu’il est parfois juste de désobéir à la loi, si elle viole les droits humains.
Par ailleurs, certains peuvent se demander s’il vaut vraiment la peine d’être juste quand les autres ne le sont pas. La tentation du profit, de l’égoïsme ou de la vengeance peut rendre la justice fragile.
→ Il faut donc du courage moral pour rester juste dans un monde imparfait. Mais ce courage fait justement la noblesse de la justice.
Être juste, ce n’est pas seulement respecter des lois : c’est permettre à la société de vivre en paix et affirmer la valeur de chaque individu. Même si elle est parfois difficile à suivre, la justice reste une exigence essentielle pour vivre ensemble, et pour être fidèle à notre humanité.
En somme, nous devons être justes non seulement pour les autres, mais aussi pour rester dignes et fidèles à nous-mêmes.
Explication de texte :
A) Éléments d’analyse
1. En prenant appui sur l’exemple du dressage des chevaux, montrez les effets que produit la technique sur la nature.
L’exemple des chevaux montre que la technique, lorsqu’elle cherche à transformer la nature pour l’adapter à des usages humains, produit des effets destructeurs. Les chevaux, adaptés naturellement à leur environnement, vivent de manière autonome. Mais dès qu’un dresseur comme Po-lo intervient, il utilise des moyens techniques (mors, entraves, cravache) pour les contrôler. Résultat : ces interventions ne respectent pas leur nature et entraînent la souffrance, la déformation, voire la mort d’un grand nombre d’entre eux.
La technique, ici, pervertit la nature au lieu de s’accorder avec elle.
2. Expliquez la phrase : « Était-il dans la nature de la glaise et du bois de se voir appliquer le compas, l’équerre et les instruments pour former des droites et des courbes ? »
Par cette question rhétorique, l’auteur critique l’usage d’outils techniques qui forcent les matériaux à adopter des formes artificielles. La glaise et le bois ont leurs propriétés propres, leur « nature » spontanée. Les façonner au moyen d’instruments géométriques revient à nier leur nature pour leur imposer des normes extérieures. Cette phrase remet donc en cause l’idée que maîtriser un matériau, c’est nécessairement bien faire : cela peut aussi signifier le dénaturer.
3. Quel est le défaut de « ceux qui prétendent gouverner le monde » ?
Ceux qui prétendent gouverner le monde reproduisent le même travers que le dresseur, le potier ou le charpentier : ils veulent modeler les êtres humains selon des règles abstraites, techniques, sans respecter leur nature propre. Ce défaut est celui de l’autoritarisme, de la normalisation, et surtout de l’oubli de la spontanéité naturelle des êtres humains.
Ils imposent de l’extérieur un ordre qui détruit l’équilibre naturel plutôt que de le cultiver.
B) Éléments de synthèse
1. Quelle est la question à laquelle l’auteur tente de répondre ici ?
La question implicite pourrait être formulée ainsi :
Faut-il transformer la nature (humaine ou non) pour bien la gouverner, ou faut-il la laisser suivre son cours ?
Autrement dit : La technique, l’intervention humaine et le pouvoir politique doivent-ils dominer la nature ou s’accorder à elle ?
2. Dégagez les différents moments de l’argumentation.
Le texte se compose de trois grands moments :
1er moment : l’exemple des chevaux → montre comment une intervention technique mal comprise peut détruire ce qu’elle prétend améliorer.
2e moment : le parallèle avec la glaise et le bois → critique générale de la technique comme force de déformation contre la nature.
3e moment : application à la politique → critique de ceux qui gouvernent sans respecter la nature humaine et valorisation d’une gouvernance fondée sur le non-agir (principe taoïste), qui laisse les individus vivre selon leur propre rythme.
3. En vous appuyant sur les éléments précédents, dégagez l’idée principale du texte.
L’idée principale du texte est que le respect de la nature (animale, matérielle, humaine) doit primer sur toute volonté de transformation technique ou politique.
Tchouang Tseu défend une conception anti-autoritaire et anti-artificielle du monde : l’intervention humaine, si elle cherche à modeler la nature de manière arbitraire, conduit à sa destruction. À l’inverse, une sagesse véritable consiste à accompagner le cours naturel des choses, en cultivant la liberté et l’harmonie plutôt que le contrôle.
La technique est-elle contre-nature ?
La technique, par essence, transforme la nature : elle façonne les choses, les êtres, et parfois même les comportements humains. Dans le texte de Tchouang Tseu, cette transformation est perçue comme une véritable violence faite au naturel. Que ce soit le cheval dressé, la glaise pétrie ou le bois plié, tout ce que la technique touche semble perdre sa liberté et sa forme originelle.
Dès lors, on peut se demander :
La technique est-elle forcément contre-nature ?
Nous verrons d'abord que la technique peut être perçue comme une agression contre la nature (I), avant de montrer qu'elle peut aussi en être le prolongement et le développement (II).
I. Une technique qui s’oppose à la nature : la critique de Tchouang Tseu
Dans le texte, Tchouang Tseu montre que la technique impose des formes extérieures à des réalités naturelles : les chevaux sont bridés, les matières sont déformées, les hommes sont contraints de se soumettre à des normes.
→ Il y a déformation, souffrance, perte de l’élan naturel.
Pour lui, cette intervention technique revient à trahir la nature propre des choses : le cheval ne galope plus librement, l’homme ne vit plus selon son rythme intérieur.
La technique devient donc une logique de domination, de maîtrise, qui contredit l’ordre spontané du monde. Il parle même de morts, pour souligner la violence symbolique et physique.
Selon cette critique, oui, la technique est contre-nature lorsqu’elle force, contraint et uniformise ce qui est divers et vivant.
II. Mais la technique peut aussi prolonger la nature humaine
Cependant, cette vision très critique néglige un fait important : l’homme est un être technique par nature. Il ne se contente pas de suivre son instinct, il imagine, il invente.
Le philosophe Henri Bergson affirme que l’intelligence humaine est faite pour fabriquer des outils.
→ La technique ne serait donc pas contre-nature, mais une expression essentielle de la nature humaine.
Par ailleurs, la technique permet souvent de se libérer des contraintes naturelles (faim, maladie, froid). Elle peut donc servir la vie au lieu de l’opprimer.
Ce qui rend la technique dangereuse, ce n’est pas son existence, mais le fait de l’utiliser sans conscience. C’est le message de Heidegger, qui nous invite à questionner le sens de nos techniques, sans les rejeter.
→ Donc, non, la technique n’est pas forcément contre-nature si elle respecte les équilibres du vivant et sert à épanouir la vie humaine.
Tchouang Tseu critique une technique qui déforme la nature et réduit la liberté. Il alerte sur les risques d’une maîtrise trop rigide. Mais en réalité, la technique peut aussi accompagner la nature humaine, si elle reste au service de la vie et de l’harmonie.
En somme, la technique devient contre-nature quand elle oublie le sens de la nature, mais elle peut être naturelle si elle prolonge la créativité humaine avec mesure et respect.
Suivre notre constitution naturelle, est-ce le fondement de notre liberté ?
Dans une société où les règles, les lois et les techniques conditionnent nos comportements, il peut sembler paradoxal de parler de liberté. Le texte de Tchouang Tseu défend pourtant l’idée que l’homme est naturellement libre, et que c’est en suivant sa constitution naturelle – c’est-à-dire ce qu’il est profondément – qu’il peut vivre en paix, sans domination ni conflit.
Dès lors, on peut se demander :
Est-ce en suivant notre nature propre que nous accédons à la vraie liberté ?
Autrement dit : le respect de ce que nous sommes suffit-il à nous rendre libres ?
Nous verrons d’abord que pour Tchouang Tseu, la liberté vient du respect de notre nature (I), avant de nuancer cette vision en montrant que la liberté peut aussi supposer un dépassement de notre nature (II).
I. Vivre selon sa nature, une voie vers la liberté (thèse de Tchouang Tseu)
Tchouang Tseu critique les contraintes imposées par la société, la technique et le pouvoir. Pour lui, quand on impose aux êtres une forme extérieure, on les dénature et on les rends esclaves.
À l’inverse, il défend une vision où chacun suit sa nature propre : les chevaux courent librement, les hommes tissent, cultivent, vivent sans hiérarchie ni violence.
C’est une liberté naturelle, spontanée, sans domination. Elle repose sur l’idée que la nature humaine est bonne si on ne la pervertit pas.
Cette vision rejoint celle de Rousseau, pour qui l’homme est libre tant qu’il n’est pas déformé par la société. La liberté résiderait alors dans le retour à soi, à une forme de simplicité originelle.
→ Oui, pour Tchouang Tseu, respecter notre nature, c’est retrouver notre liberté intérieure, loin des contraintes extérieures.
II. Mais la liberté suppose aussi une capacité à se dépasser
Cependant, cette vision peut être trop idéalisée : que veut dire « suivre notre nature » ? Et si notre nature inclut aussi des instincts violents, égoïstes ?
→ Peut-on vraiment être libre en obéissant simplement à nos penchants naturels ?
La liberté humaine ne consiste-t-elle pas plutôt à choisir, à se construire soi-même, parfois contre nos impulsions immédiates ?
→ C’est ce que pense Kant : pour être libre, il faut se donner à soi-même une loi morale, et non suivre simplement son instinct ou sa tendance naturelle.
De plus, la culture, l’éducation, la technique ne sont pas forcément des obstacles à la liberté : bien utilisées, elles peuvent nous émanciper, nous faire grandir.
→ Ainsi, suivre sa nature ne suffit pas toujours. Il faut parfois la transformer ou l’élever pour devenir pleinement libre.
Tchouang Tseu nous invite à penser une liberté simple, fondée sur l’harmonie avec notre nature profonde. Cette vision critique les normes artificielles et techniques qui déforment l’être humain. Mais pour être libre, il ne suffit pas toujours de suivre sa nature : il faut aussi apprendre à choisir, à se corriger, à faire des efforts. La liberté est peut-être moins un retour à la nature qu’un chemin vers une maîtrise de soi.
En somme, notre nature peut être le point de départ de la liberté, mais c’est par l’exercice de notre raison et de notre volonté que nous pouvons vraiment devenir libres.
Vous pouvez consulter les corrigés bac 2024
Consultez les sujets en ligne
Consultez le corrigé officiel
Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants.
- Sujet 1
- Y a-t-il un sens à refuser la technique ?
- Sujet 2
- La création artistique est-elle totalement libre ?
- Sujet 3
- Expliquer le texte suivant :
- Malebranche, De la recherche de la vérité, Livre VI, chap. 3 (1675)
Les annales du bac de philosophie 2025
-
Corrigés bac philo 2025 – Métropole (bac général) : découvrez les corrigés dès la sortie de l’épreuve
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série générale, Métropole. Sujets du 16 juin corrigés dès la sortie de l’épreuve -
Retrouvez dès la sortie des épreuves, le corrigé de philosophie bac technologique métropole 2025
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série technologique, Métropole. Sujets du 16 juin avec dissertations et commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2025 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés
Sujets corrigés philosophie bac général Amérique du Nord 2025 – découvrez les corrections, dissertations , commentaire du 20 mai. Entraînez-vous avec les corrigés -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2025
Retrouvez les sujets corrigés du bac technologique de philosophie 2025, centres étrangers groupe 1, dissertation et commentaire. -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2025
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2025 - Consultez les corrections du site -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Antilles Guyane, bacs général et technologique.
Consultez les sujets corrigés du bac de philosophie Antilles Guyane 2025, ils sont en ligne : commentaire et dissertation. Bacs général et technologique. -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique
Sujets de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations 2024 -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Polynésie française, bacs général et technologique.
Retrouvez tous les sujets corrigés de l'épreuve de philosophie 2025 de Polynésie française, ils sont en ligne sur sujetscorrigesbac.fr
Les annales du bac de philosophie 2024
-
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve Consultez les corrections proposées des dissertations et du commentaire dès la sortie de la salle d'examen -
Bac technologique philosophie 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac technologique philosophie sessions juin et septembre 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve. Consultez les corrigés, évaluez votre copie dissertation, commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés proposés
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés proposés du bac 2023 -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés du bac
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous-Centres de baccalauréat ouverts à l’étranger -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés bac du site pour le jour J. -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Polynésie française, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Polynésie française, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site et entrainez vous -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Antilles Guyane, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Antilles Guyane, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique.
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations corrigés 2023 et 2022 pour réussir votre examen
Date de dernière mise à jour : 11/06/2025