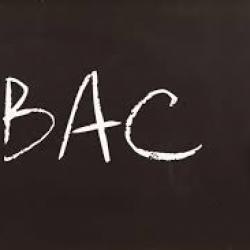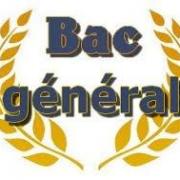Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2025

Centres de baccalauréat ouverts à l’étranger - session 2025. Entrainez-vous avec les corrections proposées du site pour le jour J
Epreuve : Bac général
Matière :Philosophie
Classe : Terminale
Centre : Centres étrangers groupe 1
Centres Etrangers Afrique
Date : 11 juin 2025
Durée : 4h
Le candidat traite, au choix, l’un des trois sujets suivants.
Consultez les sujets en ligne
- Dissertation 1
- Peut-on douter des pouvoirs de la raison?
- Dissertation 2
- L'art peut-il nous apprendre à voir le monde autrement?
- Commentaire
- Expliquer le texte de Bentham, Traités de législation civile et pénale
Dissertation n°1 :
Depuis des siècles, la raison est considérée comme la faculté proprement humaine qui permet de penser, de comprendre le monde, de distinguer le vrai du faux et d'agir avec discernement. Elle est au cœur des sciences, du droit, de la morale, et des Lumières, qui ont proclamé sa puissance contre les superstitions. Pourtant, l’histoire comme l’expérience individuelle montrent que la raison peut parfois échouer : elle peut être détournée, mise en doute, ou dépassée par d'autres forces comme les émotions, la foi, ou l’instinct.
Dès lors, se pose la question : peut-on légitimement douter des pouvoirs de la raison ? Autrement dit, la raison est-elle fiable, universelle et suffisante pour orienter notre pensée et nos actions, ou bien faut-il reconnaître ses limites ?
Nous verrons que si la raison semble en effet être un outil puissant (I), elle est cependant sujette à des limites internes et externes (II), mais que ces limites n’impliquent pas nécessairement un rejet de la raison, mais peut-être une autre manière de concevoir son usage (III).
I. La raison : une puissance essentielle à la connaissance et à l’action
La raison est ce qui permet à l’homme de construire des savoirs objectifs, comme en science : par la logique, l’analyse, le raisonnement, on peut démontrer, prouver, comprendre.
↳ Exemples : mathématiques, physique, médecine.
Elle est aussi le fondement du discernement moral : distinguer le bien du mal, juger, décider de manière rationnelle.
↳ Kant : l’homme n’est libre que s’il agit par devoir, selon les principes de la raison pratique.
En politique et en droit, la raison permet l’élaboration de lois justes, valables pour tous, en s’émancipant des passions individuelles.
↳ Lumières : raison contre fanatisme, ignorance, tyrannie.
⟶ En ce sens, douter des pouvoirs de la raison, ce serait douter de ce qui rend l’homme humain, libre et civilisé.
II. Les limites de la raison : impuissances, illusions et détournements
La raison n’est pas infaillible : elle peut être trompée ou mal utilisée.
↳ Pascal : « la raison a ses raisons que la raison ne connaît point ». La raison est limitée et ne peut pas tout expliquer (ex : foi, amour, intuition).
La raison peut être instrumentalisée au service de buts irrationnels : les régimes totalitaires ont parfois utilisé une logique froide, « rationnelle », pour justifier l’inhumain (ex : bureaucratie nazie).
↳ Hannah Arendt parle de « banalité du mal » : raison sans conscience.
La raison humaine est marquée par l’erreur : Descartes lui-même, pourtant grand défenseur de la raison, commence par douter de ses propres raisonnements, dans le Discours de la méthode.
Certaines choses échappent à la raison : l’art, l’émotion, la spiritualité, le sens de la vie…
↳ Bergson : la raison est analytique, figée ; elle ne peut saisir le mouvement vivant du réel.
⟶ Ces limites justifient un doute légitime sur la toute-puissance de la raison.
III. Vers une raison consciente de ses limites : ni rejet, ni aveuglement
Douter des pouvoirs de la raison ne signifie pas la rejeter, mais la penser de manière critique. La vraie rationalité consiste aussi à reconnaître ses limites.
↳ Descartes doute méthodiquement pour reconstruire un savoir solide.
Il faut distinguer raison et rationalisme dogmatique : la raison authentique est ouverte au dialogue avec d’autres formes de connaissance : intuition, imagination, expérience sensible.
La raison critique est indispensable pour éviter les excès de la foi, de l’idéologie ou de l’émotion brute. Mais elle doit être complétée par d’autres facultés humaines :
↳ Paul Ricœur parle de la « raison sensible » ou de l’« intelligence du cœur ».
⟶ Ce n’est pas la raison qu’il faut abandonner, mais la prétention à une raison absolue, omnisciente. Le doute est au contraire un acte rationnel, un signe de maturité philosophique.
On peut et on doit douter des pouvoirs de la raison, non pour les nier, mais pour mieux les comprendre. Car la raison est à la fois notre meilleure arme contre l’erreur et un outil faillible qu’il faut manier avec prudence. Elle n’est ni toute-puissante ni inutile. Ce doute n’est pas un rejet, mais un examen critique qui permet d’élargir notre rapport au monde et de penser une raison plus humaine, lucide et responsable.
Dissertation n°2 :
L’art a toujours été un moyen d’expression humaine puissant : qu’il s’agisse de peinture, de musique, de littérature ou de cinéma, il nous émeut, nous surprend, nous dérange parfois. Mais peut-il faire plus que cela ? Peut-il nous apprendre à voir le monde autrement, à transformer notre regard sur la réalité, la société, les autres ou nous-mêmes ?
Cette question suppose que l’art ne se contente pas d’imiter ou de reproduire le réel, mais qu’il nous forme, nous éduque, ou même nous ouvre à une autre vérité.
Dès lors, on peut se demander : en quoi l’art modifie-t-il notre manière de percevoir le monde ? Est-il un simple divertissement, ou bien un vecteur de transformation du regard et de la pensée ?
Nous verrons que l’art peut effectivement bouleverser notre perception du monde (I), mais qu’il ne s’agit pas d’un savoir objectif ou démonstratif (II), avant de montrer qu’il peut pourtant enrichir notre vision de manière sensible, symbolique et critique (III).
I. L’art ouvre un nouveau regard sur le monde
L’art ne montre pas le monde tel qu’il est, mais tel qu’il peut être vu, ressenti, interprété. Il nous décale de la réalité immédiate pour nous faire voir autrement.
→ Ex : les tableaux de Van Gogh ou Picasso ne représentent pas fidèlement la réalité, mais exaltent une vision personnelle et expressive.
Il peut révéler des aspects cachés du réel, des émotions, des injustices, des beautés qu’on ne perçoit pas toujours.
→ Ex : la littérature engagée (Zola, Sartre) ou les films comme Les Temps modernes de Chaplin nous font voir les souffrances sociales que l’on ignore ou banalise.
L’art peut même former notre regard : apprendre à lire une image, à comprendre une métaphore, à écouter une dissonance musicale, c’est apprendre à voir au-delà de l’apparence.
⟶ L’art ne copie pas le monde, il le recrée et nous invite à le voir autrement.
II. L’art ne transmet pas une connaissance objective du monde
L’art ne remplace pas la science, la philosophie ou l’expérience directe : ce qu’il nous apprend n’est pas démontrable ni universel.
→ Ce que l’on ressent devant un tableau ou un poème est subjectif.
Il peut aussi tromper ou manipuler notre regard : la propagande utilise l’art (affiches, films, musique) pour orienter les esprits.
→ Ex : l’art totalitaire ou publicitaire peut enfermer dans une vision biaisée du monde.
L’art ne donne pas un savoir au sens fort, mais plutôt une expérience esthétique, une émotion, une interprétation.
→ D’où le doute : peut-on vraiment « apprendre » quelque chose par l’art ?
⟶ L’art ne remplace pas les autres formes de connaissance, il n’enseigne pas au sens strict, mais cela ne veut pas dire qu’il est inutile pour penser.
III. L’art transforme notre perception de manière sensible et critique
Ce que l’art nous apprend, ce n’est pas un savoir théorique, mais une manière d’être au monde, une sensibilité renouvelée.
→ Ex : la poésie transforme notre rapport au langage, nous fait ressentir autrement les choses les plus simples.
Il nous permet de nous décentrer, d’adopter d’autres points de vue, d’entrer dans la peau d’un autre (empathie, imagination).
→ Ex : un roman comme L'Étranger de Camus nous montre un monde absurde, qui change notre manière de penser la vie et la mort.
L’art peut aussi dénoncer le monde tel qu’il est, le déconstruire pour nous inviter à le réinventer.
→ Ex : l’art contemporain, le street art, les installations immersives créent de nouveaux espaces de réflexion.
⟶ L’art ne donne pas des réponses, mais il ouvre des possibles, éveille une conscience, et forme une vision plus riche, plus libre du monde.
Oui, l’art peut nous apprendre à voir le monde autrement : non en nous enseignant des vérités fixes, mais en déplaçant notre regard, en enrichissant notre sensibilité, et en interrogeant la réalité sous un autre angle.
Il ne remplace pas la science ou la philosophie, mais il complète notre compréhension du monde par une approche sensible, créative et critique.
On peut donc dire que l’art est une école du regard, et peut-être même, une école de liberté.
Explication de texte :
Dans cet extrait des Traités de législation civile et pénale, Jeremy Bentham, philosophe utilitariste anglais, s’interroge sur les moyens dont dispose l’État pour maintenir l’ordre et inciter les citoyens à respecter les lois. Il montre les limites du pouvoir humain dans l’application des peines et des récompenses, et analyse le rôle que la religion a pu jouer historiquement pour suppléer à ces limites. La réflexion touche donc à des enjeux politiques, moraux et religieux : quels fondements permettent de garantir la justice et la cohésion sociale dans une société ?
Problématique : Comment l’État peut-il inciter les individus à respecter les lois, et quel rôle la religion peut-elle jouer dans ce dispositif ?
Bentham développe une réponse en trois temps : il commence par exposer les moyens propres à l’État (I), puis il montre leur insuffisance et la solution apportée par l’idée d’un juge suprême (II), enfin il analyse le rôle fonctionnel de la religion dans cette construction (III).
I. L’État et les deux leviers de l’ordre social : Peines et Récompenses
Bentham commence par affirmer que l’État, pour lutter contre les délits, ne dispose que de deux moyens : les peines (sanctions infligées aux contrevenants) et les récompenses (rétributions accordées aux individus méritants). Ces deux instruments reposent sur le principe utilitariste de l’association entre plaisir et douleur pour orienter les actions humaines.
Cependant, ces deux moyens présentent une limite structurelle :
Les peines sont ordinaires, donc accessibles, mais elles ne peuvent pas prévenir tous les comportements déviants.
Les récompenses sont extraordinaires, donc rares, et concernent peu de citoyens.
Ainsi, la justice humaine reste imparfaite : elle ne voit pas tout, n’intervient pas partout, et ne peut ni sanctionner ni récompenser toutes les actions. L’État est donc décrit comme impuissant dans bien des cas, et son autorité se révèle limitée.
II. Le recours à une puissance supérieure : la religion comme complément de pouvoir
Bentham analyse ensuite la réponse historique à cette faiblesse de l’État : l’invention ou l’introduction dans les esprits de la croyance en un Être suprême. Cette croyance vise à suppléer à l’insuffisance du pouvoir humain. Il s’agit d’un pouvoir invisible, supposé parfait, infaillible, omniscient et omnipotent, capable de voir toutes les actions et d'en rétribuer les conséquences après la mort.
La référence à un Dieu justicier permet donc :
D'étendre le champ de la surveillance morale à l’invisible.
D'encourager les hommes à agir moralement, même quand l’autorité humaine est absente.
De renforcer l’ordre social, en jouant sur la peur et l’espérance d’une sanction ou d’une récompense divine.
Le fonctionnement symbolique de cette idée est clair : elle installe dans l’esprit des hommes une autorité transcendante qui maintient les lois et complète le pouvoir politique.
III. La religion comme outil politique et moral
Bentham conclut sur une vision instrumentale de la religion. Il la considère non pas comme une vérité en soi, mais comme une construction utile à l’ordre social. C’est l’idée de religion, plus que la religion elle-même, qui importe : une croyance utile pour réguler les comportements humains en l’absence de punition humaine.
Il emploie des expressions révélatrices : la religion est une "peur utile", une "fiction" bénéfique, une construction allégorique destinée à fortifier la morale publique. La clarté du discours sur cette fonction montre que pour Bentham, la valeur de la religion est pragmatique, non spirituelle.
Dès lors, diminuer l’influence de la religion, c’est affaiblir les moyens dont dispose l’État pour assurer la vertu et lutter contre le crime. Le texte ne défend donc pas la foi, mais l’utilité politique de la foi, dans une perspective laïque et rationaliste.
Bentham propose une analyse lucide et utilitariste des moyens par lesquels une société peut maintenir l’ordre. Il reconnaît les limites du pouvoir humain et justifie l’invention d’un pouvoir supérieur pour pallier ses manques. Mais loin d’adopter un point de vue religieux, il insiste sur la fonction morale et sociale de la croyance, et voit dans la religion un instrument de gouvernement des hommes, plutôt qu’un absolu métaphysique. Ce texte invite ainsi à réfléchir sur la relation entre pouvoir politique, morale et religion, en interrogeant la part de fiction utile dans les croyances collectives.
Vous pouvez consulter les corrigés bac 2024
Lecture du sujet officiel, PDF
 Sujets bac général philosophie 2024 Groupe 1 (20.82 Ko)
Sujets bac général philosophie 2024 Groupe 1 (20.82 Ko)
Corrigé des sujets bac
Sujets de philosophie
Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants.
Durée de l’épreuve : 4 heures - Coefficient : 8
L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.
- Sujet 1
- L’art nous aide-t-il à vivre ?
- Sujet 2
- Pourquoi faut-il se fier à la science ?
- Sujet 3
- Expliquez le texte suivant :
- ARISTOTE, Éthique à Nicomaque (IV° s. av. J.-C.)
Consultez les sujets et corrigés de philosophie centre étranger du bac 2023
Sujets de philosophie
Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants.
Les corrigés bac des dissertations et du commentaire philosophique
- Sujet 1
- Peut-on s'accorder sur ce qui est juste ?
- Sujet 2
Le langage déforme-t-il la pensée ? - Sujet 3
- Explication de texte :
- Il s'agit d'un extrait de Bergson, Conférence de Madrid sur l'âme humaine, 1916.
- Expliquer le texte suivant :
Il est évident que, dans la matière, c’est la nécessité qui domine. Dans le monde matériel tout arrive fatalement. Le monde matériel, comme la science nous le présente, est une immense machine, une sorte d’horloge, dont les pièces s’ajustent parfaitement les unes aux autres ; tout en elle est mécanisme. Et lorsque, avec les habitudes scientifiques, nous considérons l’homme, nous sommes forcément poussés à le voir comme un mécanisme au milieu d’autres mécanismes, comme un être qui fonctionne automatiquement. Toute liberté semble impossible. Bien sûr, le sens commun proteste et a toujours protesté contre cette idée que l’homme serait une sorte d’automate. Il nous semble évident que la volonté jouisse du pouvoir de choisir. En ce moment, je suis libre, apparemment, de me tourner vers la droite ou vers la gauche. Vers la droite ? Ou vers la gauche ? Je me décide pour la droite. Voilà, selon les apparences, quelque chose d’incalculable, quelque chose de totalement imprévisible ; et l’on aura beau dire et répéter que la science, si elle disposait de données suffisantes, pourrait calculer d’avance tout ce qui arrive dans le ce monde, cet acte semble écarter absolument le calcul et la prévision ; comme il serait également impossible de calculer une éclipse de Soleil si la Lune, au moment de se glisser entre le Soleil et la Terre, pouvait se dire : « Que vais-je faire ? Et si je faisais une face à l’astronome qui est là, à me guetter ? » La liberté, si elle existe, est précisément cela : la faculté de tromper la science.
Bergson, Conférence de Madrid sur l’âme humaine, 1916
Les annales de philosophie, bac 2025
-
Corrigés bac philo 2025 – Métropole (bac général) : découvrez les corrigés dès la sortie de l’épreuve
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série générale, Métropole. Sujets du 16 juin corrigés dès la sortie de l’épreuve -
Retrouvez dès la sortie des épreuves, le corrigé de philosophie bac technologique métropole 2025
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série technologique, Métropole. Sujets du 16 juin avec dissertations et commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2025 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés
Sujets corrigés philosophie bac général Amérique du Nord 2025 – découvrez les corrections, dissertations , commentaire du 20 mai. Entraînez-vous avec les corrigés -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2025
Retrouvez les sujets corrigés du bac technologique de philosophie 2025, centres étrangers groupe 1, dissertation et commentaire. -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2025
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2025 - Consultez les corrections du site -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Antilles Guyane, bacs général et technologique.
Consultez les sujets corrigés du bac de philosophie Antilles Guyane 2025, ils sont en ligne : commentaire et dissertation. Bacs général et technologique. -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique
Sujets de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations 2024 -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Polynésie française, bacs général et technologique.
Retrouvez tous les sujets corrigés de l'épreuve de philosophie 2025 de Polynésie française, ils sont en ligne sur sujetscorrigesbac.fr
Les annales de philosophie, bac 2024
-
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve Consultez les corrections proposées des dissertations et du commentaire dès la sortie de la salle d'examen -
Bac technologique philosophie 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac technologique philosophie sessions juin et septembre 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve. Consultez les corrigés, évaluez votre copie dissertation, commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés proposés
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés proposés du bac 2023 -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés du bac
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous-Centres de baccalauréat ouverts à l’étranger -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés bac du site pour le jour J. -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Polynésie française, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Polynésie française, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site et entrainez vous -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Antilles Guyane, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Antilles Guyane, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique.
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations corrigés 2023 et 2022 pour réussir votre examen
Date de dernière mise à jour : 11/06/2025