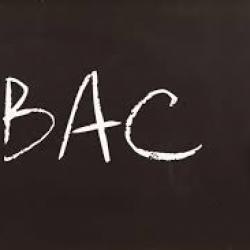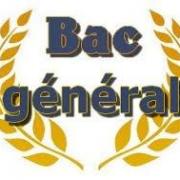Corrigés bac philo 2025 – Métropole (bac général) : découvrez les corrigés dès la sortie de l’épreuve

Corrigés bac philo 2025 – Métropole (bac général) : découvrez les sujets et nos propositions de correction dès la sortie de l’épreuve !
L’épreuve de philosophie est une épreuve écrite importante du bac. Ce lundi 16 juin 2025, les candidats des séries générales ont planché sur les sujets métropole… et dès leur sortie, notre équipe vous propose une première analyse et des corrigés complets pour vous aider à prendre du recul ou tout simplement comprendre ce qui était attendu.
Dissertations, explication de texte, axes possibles, notions clés, erreurs à éviter : cette page vous offre des pistes de réflexion solides pour explorer les sujets tombés cette année.
À vos stylos... ou plutôt à vos souris !
Epreuve : BAC Général
Matière : Philosophie
Classe : Terminale
Centre : Métropole
Date : 16 juin 2025
Heure : 08h00
Durée : 4h
Le baccalauréat général
L’épreuve de philosophie se déroulera le 16 juin 2025 de 8 h à 12 h.
Trois sujets seront proposés aux candidats qui devront choisir entre deux sujets de dissertation et un sujet d’explication de texte.
Chacun portera sur une ou plusieurs notions du programme. Toutes ces notions sont liées entre elles, évitez donc les impasses dans vos révisions !
L'épreuve écrite dure 4 heures et représente un coefficient 8 pour tous les candidats.
Consultez les sujets en ligne
 bac philo 2025 général (133.44 Ko)
bac philo 2025 général (133.44 Ko)
Le candidat traite un seul sujet au choix.
Dissertation - Sujet 1
Notre avenir dépend-il de la technique ?
Dissertation - Sujet 2
La vérité est-elle toujours convaincante ?
Explication de texte
Expliquer le texte suivant de John RAWLS Théorie de la justice (1971)
Tous les citoyens devraient avoir les moyens d’être informés des questions politiques. Ils devraient pouvoir juger de la façon dont les projets affectent leur bien-être et quels sont les programmes politiques qui favorisent leur conception du bien public. De plus, ils devraient avoir une juste possibilité de proposer des solutions nouvelles dans le débat politique. Les libertés qui sont protégées par le principe de la participation perdent une bonne partie de leur valeur quand ceux qui possèdent de plus grands moyens privés ont le droit d’utiliser leurs avantages pour contrôler le cours du débat public. Car, finalement, ces inégalités rendront les plus favorisés capables d’exercer une plus grande influence sur le développement de la législation. Au bout d’un certain temps, ils risquent d’acquérir un poids prépondérant (1) dans le règlement des problèmes sociaux, du moins en ce qui concerne les questions sur lesquelles ils sont habituellement d’accord, c’est-a-dire celles qui renforcent leur position privilégiée.
Il faut alors prendre des mesures de compensation pour préserver la juste valeur des libertés politiques égales pour tous. On peut pour cela utiliser divers moyens. Par exemple, dans une société qui autorise la propriété privée des moyens de production (2), on doit maintenir une large répartition de la propriété et de la richesse, et les subventions gouvernementales doivent être régulièrement distribuées pour développer les moyens d’un débat public libre.
(1) Ils risquent de peser beaucoup, d’avoir une très grande importance.
(2) Une société dans laquelle certains peuvent posséder des éléments qui produisent de la richesse, comme des usines, des machines, des médias, etc...
Dissertation n°1 :
« Notre avenir dépend-il de la technique ? »
Jamais l’humanité n’a été aussi profondément transformée par la technique. Depuis la révolution industrielle jusqu’à l’intelligence artificielle, en passant par le nucléaire ou Internet, la technique ne cesse de redessiner nos modes de vie, notre rapport au monde, et même à nous-mêmes. À première vue, notre avenir semble inextricablement lié à ces progrès techniques qui façonnent la société, les relations humaines, l’environnement, la santé, etc.
Mais faut-il en conclure que notre avenir dépend uniquement de la technique, ou avons-nous encore les moyens de le penser, de le décider, voire de le réorienter ?
Problématique : La technique est-elle une condition incontournable de notre avenir, ou bien sommes-nous en mesure de construire notre futur en dehors ou au-delà de la technique ?
Nous verrons d’abord que la technique est effectivement un facteur déterminant de notre avenir, puis qu’elle peut aussi devenir une menace qui aliène l’homme, avant d’envisager que si elle est orientée par l’éthique et la réflexion, elle peut être mise au service d’un avenir véritablement humain.
I. La technique, moteur du progrès et condition de notre avenir
A. La technique prolonge les capacités humaines et permet des avancées considérables
La technique est ce par quoi l’homme déploie sa puissance d’agir sur le monde : elle est une extériorisation de l’intelligence humaine (cf. Bergson, L’évolution créatrice).
Exemples : médecine moderne, technologies agricoles, communications mondiales…
Elle permet la survie, le confort, l’efficacité, et rend possible un avenir plus sûr.
Citation : « L’homme est un être technique » – Bertrand Gille. L’homme se définit par sa capacité à créer des outils.
B. Elle structure les sociétés et les oriente vers des modèles nouveaux
Chaque révolution technique produit un changement de civilisation : ex. imprimerie, machine à vapeur, numérique.
Le développement économique, l’organisation du travail, la mondialisation reposent sur la technique.
Le futur des sociétés humaines dépend donc en grande partie de leurs capacités techniques.
Référence : Jacques Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle : la technique devient l’élément structurant des sociétés modernes.
C. La technique devient indispensable face aux défis contemporains
Crises écologiques, pandémies, croissance démographique : les grands défis du XXIe siècle exigent des réponses techniques (énergies renouvelables, IA pour la santé, biotech, etc.).
Notre avenir commun repose sur la capacité à maîtriser ces techniques pour le bien commun.
Ex : Les enjeux climatiques ne peuvent être relevés qu’avec des outils techniques puissants (captage du CO₂, transports propres...).
II. Mais la technique peut aussi menacer l’avenir de l’homme
A. La technique peut échapper à notre contrôle
La technique progresse selon sa propre logique d’efficacité, indépendante de toute finalité morale (cf. Heidegger, La question de la technique).
Risque d’un avenir subi, non choisi : robotisation du travail, dépendance au numérique, surveillance généralisée.
Citation : « Ce n’est pas la technique qui nous asservit, mais le sacré transféré à la technique » – Jacques Ellul.
B. Elle produit de nouvelles formes d’aliénation
L’homme devient dépendant de ses outils : perte d’autonomie, addiction aux écrans, isolement social.
Le progrès technique ne garantit pas le progrès humain : il peut engendrer des inégalités, des destructions, une perte de sens.
Ex : Déshumanisation du travail par les algorithmes, manipulations génétiques, effets sociaux de l’IA.
C. La technique menace l’équilibre écologique et l’avenir même de la planète
La technique industrielle a provoqué une exploitation massive de la nature.
Le réchauffement climatique, la pollution, l’épuisement des ressources sont les conséquences d’un usage non maîtrisé de la technique.
Référence : Hans Jonas, Le principe responsabilité : la puissance de la technique oblige à une nouvelle éthique du futur.
III. Vers un avenir maîtrisé : la technique au service de l’humanité
A. L’homme reste responsable de l’usage de la technique
La technique n’est pas une force aveugle : l’homme en est le concepteur et l’usager.
C’est à nous de définir des finalités humaines et éthiques, et d’orienter la technique vers ces buts.
Citation : « La technique ne pense pas. Elle attend qu’on lui donne une direction » – Heidegger.
B. Une technique soumise à la raison et au débat démocratique
Il faut éduquer au discernement technique, développer une culture critique.
Des institutions éthiques, scientifiques, politiques doivent encadrer les innovations (commissions bioéthiques, droit du numérique...).
Ex : Encadrement du clonage, débat sur l’IA dans la santé ou la justice.
C. Une coexistence possible entre technique et humanisme
Plutôt que de refuser la technique, il faut l’intégrer dans un projet de société humain, respectueux de la nature et des libertés.
L’avenir peut être technique sans être inhumain, si l’on repense nos rapports à la nature, au progrès, à la responsabilité.
Référence : Albert Jacquard, Mon utopie : la technique doit être au service d’une société solidaire, cultivée et libre.
Il serait illusoire de nier que notre avenir dépend en grande partie de la technique, tant celle-ci est au cœur de notre mode de vie, de nos moyens d’action et de nos réponses aux crises. Mais cette dépendance peut devenir dangereuse si la technique n’est pas pensée, maîtrisée, encadrée.
Dès lors, notre avenir ne dépend pas seulement de la technique, mais de la manière dont nous la concevons, l’utilisons et l’orientons. Il dépend de notre capacité à mettre la technique au service d’une finalité humaine, éthique et écologique.
Ouverture : À l’ère de l’intelligence artificielle, il nous faut plus que jamais faire preuve d’intelligence humaine, pour que la technique ne construise pas l’avenir à notre place, mais avec nous, et pour nous.
Dissertation n°2 :
« La vérité est-elle toujours convaincante ? »
La vérité semble avoir un statut privilégié : elle est ce que chacun cherche à connaître, ce que les sciences s'efforcent de découvrir, ce que la justice tente de rétablir. Dès lors, on pourrait penser qu'elle s’impose d’elle-même dès qu’elle est connue. Pourtant, il n’est pas rare de voir des vérités ignorées, niées, voire combattues : l’histoire, les sciences ou la politique en témoignent.
Paradoxalement, ce n’est pas parce qu’une chose est vraie qu’elle convainc.
Problématique : La vérité a-t-elle toujours le pouvoir de convaincre ceux à qui elle se présente ? Ou bien faut-il admettre que d’autres facteurs (émotion, intérêt, préjugé) peuvent l’emporter sur elle ?
Nous verrons d’abord que la vérité a en elle-même une force rationnelle qui tend à convaincre, mais qu’elle se heurte souvent à des résistances humaines, avant d’envisager les conditions nécessaires pour qu’elle puisse effectivement convaincre.
I. La vérité possède une force rationnelle propre qui tend à convaincre
A. La vérité est ce qui correspond à la réalité, et la raison humaine y est naturellement sensible
Définition classique de la vérité : l’adéquation entre la pensée et le réel (adaequatio rei et intellectus).
L’homme, en tant qu’être rationnel, est porté à chercher ce qui est vrai.
La démonstration scientifique, mathématique ou logique, par sa cohérence, convainc par la seule force de l’évidence.
Ex. : Un théorème mathématique bien démontré impose l’assentiment à quiconque suit le raisonnement.
B. L’évidence de la vérité impose sa force à l’esprit
La vérité s’impose à celui qui examine honnêtement les faits ou les arguments : il est difficile de nier ce qui est prouvé.
Chez Descartes, l’idée claire et distincte est celle qui convainc parce qu’elle ne peut pas être fausse.
Citation : « Je pense, donc je suis » – Descartes, Discours de la méthode : cette vérité s’impose immédiatement à l’esprit.
C. La vérité a un pouvoir libérateur qui peut convaincre moralement et politiquement
D’un point de vue moral, la vérité est souvent associée à la justice, à la dignité, à l’authenticité.
En politique, révéler la vérité (sur une injustice, une manipulation) peut soulever une prise de conscience collective.
Exemple : les journalistes d’investigation, les lanceurs d’alerte comme Edward Snowden ont convaincu en exposant des vérités cachées.
II. Pourtant, la vérité n’est pas toujours reçue ni acceptée : elle peut échouer à convaincre
A. L’être humain n’est pas seulement rationnel : ses passions peuvent lui faire rejeter la vérité
L’homme est traversé par des désirs, des peurs, des intérêts, qui peuvent le rendre aveugle à la vérité.
Ce qui est vrai peut être dérangeant, humiliant, ou menaçant, donc refusé.
Ex. : Le refus de certaines vérités scientifiques (climat, évolution) pour des raisons idéologiques ou religieuses.
B. La vérité n’a pas toujours les moyens de se faire entendre
Ce n’est pas la vérité elle-même qui convainc, mais la manière dont elle est présentée : un discours vrai mais mal formulé peut ne pas convaincre.
La rhétorique, l’art de bien parler, est souvent plus efficace que la vérité nue.
Ex. : Les sophistes dans l’Antiquité enseignaient comment persuader, même sans vérité. Cf. Platon, Gorgias.
C. La vérité peut être combattue activement par ceux à qui elle nuit
Dans certains contextes, la vérité est censurée, étouffée, déformée.
Ceux qui y ont intérêt peuvent diffuser le mensonge avec plus de force que ne s’impose la vérité.
Exemple : les régimes totalitaires (comme dans 1984 d’Orwell) imposent une « vérité officielle » qui n’a rien à voir avec le réel.
III. La vérité peut convaincre, à condition qu’on y soit disposé et qu’elle soit bien transmise
A. Il faut une éducation de l’esprit pour que la vérité puisse convaincre
Être convaincu par la vérité suppose une attitude intellectuelle honnête et critique.
L’éducation philosophique, scientifique, éthique forme à chercher la vérité au-delà des apparences.
Citation : « On ne naît pas homme, on le devient » – Alain : il faut se former à recevoir la vérité.
B. La vérité doit être accompagnée d’une capacité à persuader
Convaincre ne dépend pas seulement du contenu (le vrai), mais aussi de la forme : clarté, sensibilité, contexte.
Il faut parfois adapter le langage, user de pédagogie, de narration pour faire entendre une vérité.
Ex. : Socrate, dans les dialogues de Platon, utilise la maïeutique pour amener son interlocuteur à découvrir la vérité par lui-même.
C. Le dialogue et la liberté sont les conditions d’une vérité réellement convaincante
La vérité ne s’impose pas par la force, mais dans un cadre de discussion libre, rationnelle et respectueuse.
C’est dans une société démocratique, ouverte au débat et à la critique, que la vérité a le plus de chances de convaincre.
Référence : Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis : la recherche de la vérité passe par le débat contradictoire.
La vérité, en tant que correspondance avec le réel, a en elle une force rationnelle qui tend à convaincre. Mais cette force n’est pas absolue : l’adhésion à la vérité dépend aussi de facteurs humains, sociaux et psychologiques.
Elle ne convainc pas toujours, car elle peut déranger, être mal exprimée, ou être volontairement rejetée. Pour qu’elle convainque, il faut créer les conditions d’une pensée libre, instruite, critique et ouverte au dialogue.
Ouverture : Dans un monde saturé d’informations, de fake news et de manipulations médiatiques, le défi n’est plus seulement de dire la vérité, mais de faire en sorte qu’elle soit entendue, comprise, acceptée. La vérité reste un idéal, mais sa force dépend aussi de notre capacité à la défendre et à la transmettre.
Explication de texte :
Le texte proposé est extrait de Théorie de la justice (1971) du philosophe américain John Rawls, figure centrale de la philosophie politique contemporaine. Rawls y développe une conception contractualiste de la justice, fondée sur l'idée d'une société équitable dans laquelle les droits fondamentaux et les libertés sont garantis à tous.
Dans ce passage, il s’interroge sur les conditions nécessaires à la participation politique équitable des citoyens, et sur les menaces que fait peser la concentration des richesses sur l’idéal démocratique.
Problématique : Comment garantir une véritable démocratie quand les inégalités économiques peuvent peser sur les décisions politiques ?
Rawls défend ici l’idée que, pour que la démocratie fonctionne équitablement, il faut protéger les libertés politiques fondamentales des inégalités sociales et économiques, en instaurant des mécanismes de régulation justes.
Nous verrons que Rawls affirme d’abord l’importance de garantir à chacun un accès égal à l’information et à la participation politique (I), puis qu’il met en garde contre le pouvoir disproportionné des riches dans l’espace public (II), avant de proposer une solution fondée sur la justice distributive (III).
I. Garantir à chaque citoyen une égale capacité à participer à la vie politique
Rawls commence par poser un principe d’égalité démocratique fondamentale : chaque citoyen doit pouvoir s’informer, comprendre, et participer activement aux affaires politiques.
Il insiste d’abord sur le droit de savoir : les citoyens doivent pouvoir comprendre comment les décisions politiques influencent leur vie, leur bien-être, leur avenir. Cela suppose l’accès à des sources d'information pluralistes et accessibles.
Ensuite, il affirme que chacun doit avoir la possibilité de contribuer au débat public, non seulement en votant, mais aussi en proposant des idées, des solutions nouvelles, c’est-à-dire en étant un véritable acteur de la démocratie.
Rawls met en évidence une exigence forte : il ne suffit pas que les droits politiques existent formellement, encore faut-il que tous aient les moyens concrets d’en faire usage. Il s’agit là d’un idéal de démocratie participative.
Cette idée rejoint les conceptions de la démocratie développées par Jürgen Habermas, qui insiste lui aussi sur l’importance de la délibération publique, où chacun peut faire entendre sa voix.
II. Dénoncer les effets pervers de la domination économique dans l’espace politique
Mais cette égalité théorique se heurte, selon Rawls, à une réalité : les inégalités économiques peuvent fausser le débat démocratique.
Il oppose ici le poids des moyens privés (lobbying, médias privés, influence financière) à l’idéal d’une liberté politique égale pour tous. Si les plus riches peuvent imposer leurs intérêts, leur influence devient disproportionnée.
L’auteur redoute une capture du pouvoir politique par les élites économiques : la loi serait alors influencée par ceux qui disposent des ressources pour faire entendre leur voix plus fort que les autres.
Cette dérive remet en cause le principe même de la justice démocratique, car les citoyens ne sont plus égaux en capacité d’agir, et certains intérêts sont favorisés au détriment du bien commun.
On retrouve ici la critique de la ploutocratie : un régime où le pouvoir est entre les mains des plus riches. Cette critique rappelle aussi celle de Platon dans La République, qui craignait que la démocratie dégénère en un système où l’argent décide de tout.
III. Proposer des mécanismes pour préserver la justice et l’égalité des droits
Face à ce risque, Rawls appelle à des mesures de compensation pour rétablir une démocratie réellement juste.
Il s’appuie sur ses deux célèbres principes de justice : garantir les libertés fondamentales (dont la liberté politique) et corriger les inégalités sociales et économiques dans la mesure où elles profitent aux plus défavorisés (principe de différence).
Ainsi, il suggère que les moyens de production, de richesse, de communication (médias, industries, etc.) ne soient pas concentrés entre les mains de quelques-uns. Sinon, l’avenir de la démocratie est compromis.
Il appelle donc à une répartition équitable des richesses, à travers la fiscalité, les aides publiques, la régulation des industries, afin que chacun puisse bénéficier des conditions réelles de la liberté politique.
Cette conception rejoint les idées de l’État-providence, ou de la justice sociale défendue par des penseurs comme Amartya Sen, qui affirme que la liberté réelle dépend des « capabilités » concrètes que chacun possède pour agir.
Dans ce texte dense et rigoureux, John Rawls montre que la démocratie ne peut être réelle que si elle repose sur une justice sociale et économique effective. Pour lui, la liberté politique n’est pas seulement un droit abstrait, mais une capacité concrète, qui suppose une égalité des moyens et une régulation des inégalités.
Ce texte nous invite donc à repenser le lien entre démocratie, justice et économie, et à ne pas séparer les droits politiques des conditions matérielles qui les rendent possibles.
Ouverture : À l’heure où les grandes entreprises, les plateformes numériques et les intérêts privés influencent fortement les décisions politiques, la réflexion de Rawls est plus que jamais d’actualité. Peut-on encore garantir une démocratie juste sans repenser en profondeur la répartition des richesses et des moyens d’expression ?
Vous pouvez consulter les corrigés bac 2024
Consultez les sujets en ligne
Consultez les corrigés en ligne
- Dissertations
- Sujet 1
- la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ?
- Sujet 2
- L’État nous doit-il quelque chose ?
- L'explication de texte en filière générale
- Sujet 3
- Expliquer le texte suivant :
- Simon Weil, La Condition Ouvrière (1943)
Epreuve : BAC G
Matière : Philosophie
Classe : Terminale
Centre : Métropole
Date : mardi 10 septembre 2024
Durée : 4h
Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants.
- Sujet 1
- Avons-nous le devoir d’être libres ?
- Sujet 2
- Peut-on s’arrêter de travailler ?
- Sujet 3
- Expliquer le texte suivant :
- RUSSELL, Problèmes de philosophie (1912)
- Télécharger les sujets
- Sujets du bac
- Tous les corrigés sont en ligne
- Consulter les corrections du site
Les annales de philosophie, bac 2025
-
Corrigés bac philo 2025 – Métropole (bac général) : découvrez les corrigés dès la sortie de l’épreuve
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série générale, Métropole. Sujets du 16 juin corrigés dès la sortie de l’épreuve -
Retrouvez dès la sortie des épreuves, le corrigé de philosophie bac technologique métropole 2025
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série technologique, Métropole. Sujets du 16 juin avec dissertations et commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2025 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés
Sujets corrigés philosophie bac général Amérique du Nord 2025 – découvrez les corrections, dissertations , commentaire du 20 mai. Entraînez-vous avec les corrigés -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2025
Retrouvez les sujets corrigés du bac technologique de philosophie 2025, centres étrangers groupe 1, dissertation et commentaire. -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2025
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2025 - Consultez les corrections du site -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Antilles Guyane, bacs général et technologique.
Consultez les sujets corrigés du bac de philosophie Antilles Guyane 2025, ils sont en ligne : commentaire et dissertation. Bacs général et technologique. -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique
Sujets de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations 2024 -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Polynésie française, bacs général et technologique.
Retrouvez tous les sujets corrigés de l'épreuve de philosophie 2025 de Polynésie française, ils sont en ligne sur sujetscorrigesbac.fr
Les annales de philosophie, bac 2024
-
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve Consultez les corrections proposées des dissertations et du commentaire dès la sortie de la salle d'examen -
Bac technologique philosophie 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac technologique philosophie sessions juin et septembre 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve. Consultez les corrigés, évaluez votre copie dissertation, commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés proposés
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés proposés du bac 2023 -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés du bac
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous-Centres de baccalauréat ouverts à l’étranger -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés bac du site pour le jour J. -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Polynésie française, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Polynésie française, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site et entrainez vous -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Antilles Guyane, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Antilles Guyane, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique.
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations corrigés 2023 et 2022 pour réussir votre examen
Date de dernière mise à jour : 16/06/2025