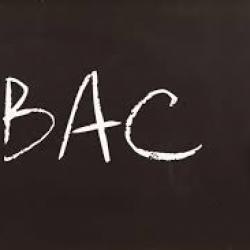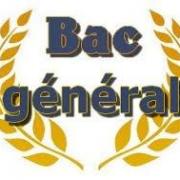Retrouvez dès la sortie des épreuves, le corrigé de philosophie bac technologique métropole 2025

Le lundi 16 juin 2025, les élèves des séries technologiques ouvrent le bal des épreuves écrites du baccalauréat en métropole avec la philosophie. Sujet de réflexion redouté par beaucoup, il marque aussi une étape importante dans le parcours des lycéens, les invitant à mobiliser leur culture, leur esprit critique et leur capacité d’argumentation.
Sur cette page, tu retrouveras les sujets officiels de l’épreuve de philosophie 2025 pour les séries technologiques (Métropole), accompagnés de corrigés détaillés rédigés dans l’esprit de ce que l’on attend au bac. Dissertation ou explication de texte : chaque proposition est pensée pour t’aider à mieux comprendre les enjeux du sujet et vérifier ta propre copie.
Consultez les corrections proposées des dissertations et du commentaire dès la sortie de la salle d'examen
Epreuve : BAC technologique
Matière : Philosophie
Classe : Terminale
Centre : Métropole
Date : 16 juin 2025
Heure : 08h00
Durée : 4h
coefficient 4
Le baccalauréat technologique
vous aurez le choix entre trois sujets
- un sujet de commentaire et analyse de texte
- deux sujets de dissertation
Consultez les sujets en ligne
 Bac philo 2025 technologique (671.58 Ko)
Bac philo 2025 technologique (671.58 Ko)
Dissertation - Sujet 1
- Sommes-nous libres en toutes circonstances ?
Dissertation - Sujet 2
- Avons-nous besoin d’art ?
Explication de texte
Expliquer le texte suivant d’Adam Smith, Théorie des sentiments moraux, 1759
La société peut se maintenir entre différents hommes comme entre différents marchands, à partir du sens de son utilité, sans aucun lien réciproque d’amour ou d’affection. Et quoique l’homme qui en est membre ne soit lié par aucune obligation, ni par aucune forme de gratitude vis-à-vis d’autrui, la société peut toujours être soutenue par l’échange mercenaire (1) de bons services selon des valeurs convenues.
La société, toutefois, ne peut subsister entre ceux qui sont toujours prêts à se nuire et à se causer du tort. Dès que surviennent les préjudices (2), dès que s’installent le ressentiment réciproque et l’animosité (3), tous les liens de la société sont déchirés, et les différents membres en quoi elle consistait sont, en quelque sorte, disséminés et dispersés à l’entour par la violence et l’opposition de leurs sentiments discordants. S’il y a une société entre des brigands et des assassins, ils doivent au moins, selon l’observation commune, s’abstenir de se voler ou de s’assassiner les uns les autres. La bienfaisance est donc moins essentielle à l’existence de la société que la justice. La société peut se maintenir sans bienfaisance, quoique dans un état qui ne soit pas le plus confortable ; mais la prédominance de l’injustice la détruira absolument.
(1) mercenaire : qui se fait payer.
(2) préjudices : perte, dommage ou atteinte causée par l’action de quelqu’un.
(3) animosité : sentiment hostile.
Dissertation n°1 :
La liberté est une valeur fondamentale, tant en philosophie qu’en politique. Être libre, c’est pouvoir choisir, décider par soi-même, agir sans contrainte. On aime penser que nous sommes des êtres libres, responsables de nos choix et de notre destin.
Mais la liberté est-elle toujours possible, quelles que soient les circonstances ? Ne dépend-elle pas de notre situation, de notre corps, de notre condition sociale ou historique ?
Problématique : Peut-on être libre en toutes circonstances, ou bien existe-t-il des limites, des contraintes, des déterminismes qui remettent en cause notre liberté ?
Nous verrons d’abord que la liberté est un idéal fondamental de la condition humaine (I), puis qu’en réalité, de nombreuses circonstances viennent l’entraver (II), avant d’envisager une forme de liberté intérieure ou morale qui reste possible même dans des conditions extrêmes (III).
I. La liberté semble être une caractéristique essentielle de l’homme
A. Être libre, c’est agir selon sa volonté, sans contrainte extérieure
La liberté se définit d’abord comme l’autonomie de la volonté : je suis libre si je peux choisir sans être contraint.
Cette conception est défendue par Descartes : « La liberté de notre volonté se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. »
En ce sens, la liberté est naturelle à l’homme.
B. Être libre, c’est aussi être responsable de ses choix
La liberté suppose la capacité morale de distinguer le bien du mal, et donc d’assumer les conséquences de ses actes.
Sartre affirme que nous sommes « condamnés à être libres » : même refuser de choisir est un choix.
Il n’y a pas d’action humaine sans liberté : sinon, l’homme ne serait qu’un automate.
C. Les sociétés humaines reposent sur le présupposé de la liberté
Le droit, la morale, la politique supposent que les individus sont responsables, donc libres.
Toute vie sociale repose sur l’idée que chacun peut, en principe, agir librement et choisir ce qui est bon.
➤ En théorie, la liberté est essentielle et universelle. Mais cela signifie-t-il que nous sommes libres en toutes circonstances ?
II. Les circonstances limitent ou entravent souvent notre liberté
A. Il existe des contraintes extérieures (naturelles, sociales, politiques)
On ne choisit ni sa naissance, ni son corps, ni sa culture : ces déterminismes pèsent sur nos choix.
La pauvreté, la maladie, l’oppression politique réduisent concrètement notre marge de manœuvre.
Ex. : Un prisonnier politique, une personne en esclavage ou sous une dictature est-elle encore libre ?
B. Il existe aussi des déterminismes intérieurs (psychiques, inconscients)
Freud : nos actes sont souvent influencés par l’inconscient, les pulsions, les désirs refoulés.
Nous ne sommes pas toujours maîtres de nous-mêmes.
Cela remet en cause l’illusion d’une liberté totale et transparente.
C. La liberté absolue est une illusion : nos choix sont souvent conditionnés
Même nos décisions rationnelles peuvent être influencées par l’éducation, les normes sociales, la publicité…
Spinoza : « L’homme se croit libre parce qu’il ignore les causes qui le déterminent. »
La liberté serait donc relative, partielle, voire illusoire.
III. Pourtant, une certaine forme de liberté demeure toujours possible
A. La liberté morale : choisir sa réponse face aux événements
Même dans les pires circonstances, l’homme peut garder une liberté intérieure : la manière dont il réagit, ce qu’il pense, ce qu’il décide de faire de lui-même.
Viktor Frankl, survivant des camps nazis, affirme que l’on peut toujours « choisir son attitude face à la souffrance ».
➤ Il y aurait une liberté de sens que rien ne peut supprimer.
B. La liberté n’est pas l’absence de contraintes, mais la capacité de se déterminer malgré elles
Selon Kant, la liberté est l’autonomie morale : obéir à la loi qu’on s’est donnée à soi-même.
Cela signifie qu’on peut être libre même sous contrainte, si l’on reste fidèle à ses principes.
Ex. : Antigone dans la tragédie de Sophocle, qui choisit d’obéir à sa conscience plutôt qu’à la loi de l’État.
C. Les obstacles peuvent devenir les conditions mêmes de la liberté
C’est parce que les circonstances sont difficiles que la liberté prend tout son sens : choisir malgré l’adversité.
La résistance, le courage, l’acte de dire non dans un contexte hostile sont des expressions puissantes de la liberté.
➤ La liberté n’est donc pas toujours visible, mais elle se manifeste justement dans la capacité de l’homme à ne pas être réduit à ses conditions.
Nous ne sommes pas libres en toutes circonstances si l’on entend par là la possibilité de faire tout ce que l’on veut. Les contraintes naturelles, sociales ou psychologiques limitent nos choix.
Mais une liberté intérieure, morale, existentielle demeure possible : celle de choisir sa manière d’être, de réagir, de penser, même dans les conditions les plus extrêmes.
Ouverture : Dans un monde où de nombreux individus subissent l’oppression, la misère ou l’injustice, cette idée d’une liberté intérieure irréductible est peut-être ce qui fonde notre dignité humaine la plus profonde.
Dissertation n°2 :
Avons-nous besoin d’art ?
Depuis les fresques préhistoriques de Lascaux jusqu’aux œuvres contemporaines les plus conceptuelles, l’art accompagne l’humanité depuis ses origines. Peinture, musique, poésie, danse, cinéma… toutes les civilisations ont produit des formes d’art. Pourtant, l’art n’est pas indispensable à la survie biologique : on peut manger, se loger, travailler sans jamais contempler une œuvre. Cela nous pousse à nous interroger : l’art est-il une simple distraction, ou bien une nécessité pour l’être humain ? En d’autres termes, avons-nous besoin d’art, et si oui, en quel sens : vital, moral, existentiel ?
Nous verrons d’abord que l’art n’est pas une nécessité matérielle, mais peut apparaître comme un luxe ou un ornement. Nous montrerons ensuite que, malgré son inutilité pratique, l’art répond à des besoins profonds de l’âme humaine. Enfin, nous défendrons l’idée que l’art est une nécessité existentielle et spirituelle, au fondement même de notre humanité.
I. L’art n’est pas un besoin vital ou utilitaire
1. L’art n’est pas indispensable à la survie
Contrairement à la nourriture, l’eau ou la sécurité, l’art n’est pas une condition directe de la vie physique. Une société peut exister sans musées ni poésie. Platon, dans La République, se méfiait même de l’art : il le jugeait trompeur, éloignant les citoyens de la vérité, en les distrayant du réel.
2. L’art peut apparaître comme un luxe superflu
Dans une logique économique ou politique, l’art est souvent perçu comme une dépense secondaire, réservée aux élites. En période de crise, on ferme les théâtres avant les banques. L’art est considéré comme non essentiel, car il ne produit ni richesse tangible ni bien matériel.
3. La technique prime sur l’art dans nos sociétés modernes
La modernité valorise l’utilité, l’efficacité, la rentabilité. La technique répond à nos besoins pratiques, tandis que l’art semble appartenir au domaine du rêve. Certains pensent qu’il est réservé aux loisirs, à la sphère privée, sans rôle social majeur.
Pourtant, cette vision réductrice oublie que l’art répond à des besoins profonds de sens, d’émotion, de reconnaissance et d’expression, qui dépassent les besoins strictement matériels.
II. L’art répond à des besoins humains essentiels : expression, émotion, compréhension
1. L’art est un moyen d’expression irremplaçable
L’art permet d’exprimer ce qui ne peut pas toujours être dit avec des mots. Pour Nietzsche, « nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité » : l’art sublime la douleur, transforme le chaos en beauté. Il est un besoin d’expression intérieure, pour l’artiste comme pour le spectateur.
2. L’art nous émeut, il touche ce qu’il y a de plus humain en nous
L’émotion esthétique n’est pas futile : elle nous relie à notre sensibilité, à notre faculté de ressentir. Kandinsky disait que « l’art touche directement l’âme ». La musique, par exemple, peut consoler, élever, apaiser : elle répond à un besoin affectif profond.
3. L’art nous aide à comprendre le monde autrement
L’art est une forme de connaissance sensible et intuitive. Il éclaire les réalités humaines, sociales ou historiques, parfois mieux que la science. Victor Hugo, dans Les Misérables, fait comprendre l’injustice sociale par la puissance de la narration. L’art nous fait voir autrement, il élargit notre horizon.
Loin d’être inutile, l’art remplit donc une fonction existentielle. Peut-on alors affirmer qu’il est un besoin fondamental de l’homme ?
III. L’art est un besoin spirituel et une condition de l’humanité
1. L’art révèle l’humanité en l’homme
Même les sociétés les plus primitives ont produit des formes d’art : la création artistique semble universelle. Elle témoigne de notre besoin de transcender la nature, d’exprimer une vision du monde. Pour Malraux, l’art est « ce qui résiste à la mort » : il inscrit l’homme dans l’histoire et la culture.
2. L’art fonde notre liberté intérieure
L’art nous libère de la routine, de la servitude de l’utile. Il ouvre un espace de création, d’imagination, de critique. Pour Marcuse, dans L’homme unidimensionnel, l’art est un lieu de résistance à la société technicienne, un besoin de liberté. Il ne nous distrait pas : il nous élève.
3. L’art est un besoin collectif, un lien social et politique
L’art n’est pas seulement personnel : il crée du commun, il forge des identités, des mémoires collectives. Il dénonce, témoigne, interpelle. Les chansons engagées, les œuvres critiques, les fresques urbaines expriment un besoin de justice, de mémoire, de dialogue.
L’art n’est pas un besoin biologique, ni un outil de survie matérielle. Mais réduire les besoins humains à l’utilité physique serait méconnaître notre nature spirituelle et sensible. L’art est ce par quoi nous exprimons nos émotions, comprenons le monde, nous relions aux autres, et devenons pleinement humains.
C’est pourquoi nous avons besoin d’art : non pour vivre biologiquement, mais pour vivre humainement.
À une époque où les algorithmes produisent des images et où l’intelligence artificielle génère des textes, la question du besoin d’art rejoint celle du besoin d’humanité. Peut-on créer sans ressentir ? Peut-on aimer une œuvre créée sans émotion ? Peut-être que le besoin d’art est d’abord le besoin d’une présence humaine dans ce que nous contemplons.
Explication de texte :
Option 2
Qu’est-ce qui rend possible la vie en société ? On pense souvent que c’est l’amour, l’amitié, la solidarité ou la bienveillance qui unissent les hommes. Mais peut-on vraiment fonder une société sur des sentiments aussi instables ou subjectifs ?
Dans cet extrait, Adam Smith, philosophe écossais du XVIIIe siècle, interroge la véritable condition de possibilité de la société humaine. Il soutient une thèse originale : la société peut exister sans amour ni bienfaisance, mais pas sans justice.
Problématique : Peut-on maintenir une société sans lien affectif entre ses membres ? Quels sont les fondements nécessaires à toute société humaine : la bienfaisance ou la justice ?
Pour le montrer, Smith distingue entre deux types de comportements : d’une part, l’absence de bienfaisance (I), qui n'empêche pas la société de fonctionner tant que règne un minimum de coopération intéressée ; d’autre part, la présence d’injustice et de violences mutuelles (II), qui rend toute vie sociale impossible. Cela permet de dégager une hiérarchie entre les vertus sociales : la justice est plus fondamentale que la bienfaisance (III).
I. La société peut fonctionner sans affection ni amour, grâce à l’intérêt mutuel
A. Une société fondée sur l’intérêt mutuel peut fonctionner sans affection personnelle
Adam Smith commence par dissiper une illusion commune : la société humaine ne repose pas nécessairement sur l’amour ou la sympathie entre les hommes. Il affirme que « la société peut se maintenir […] à partir du sens de son utilité, sans aucun lien réciproque d’amour ou d’affection ».
En d’autres termes, les relations sociales peuvent être purement fonctionnelles, motivées par l’intérêt bien compris des individus, sans qu’il y ait entre eux un lien affectif.
B. La comparaison avec les marchands : un modèle d’échange sans amour
Smith illustre cette idée par une analogie économique : les individus peuvent vivre ensemble comme des marchands, c’est-à-dire en s’échangeant des services contre une valeur déterminée. Le lien qui les unit n’est pas l’amitié, mais le commerce et la réciprocité des intérêts.
Cette vision rappelle ce que Smith développera plus tard dans La richesse des nations : l’homme n’agit pas par bonté, mais parce qu’il espère tirer avantage de la relation.
C. La société fonctionne donc, même sans bienfaisance, grâce à la coopération intéressée
Même si les hommes ne se soucient pas sincèrement les uns des autres, ils peuvent cohabiter et coopérer dès lors qu’ils respectent les règles de l’échange équitable. Smith parle d’un « échange mercenaire de bons services », soulignant le caractère contractuel et calculé des relations sociales.
Ainsi, la bienfaisance est un supplément de confort, mais elle n’est pas indispensable à la survie de la société.
II. En revanche, la société ne peut subsister dans un climat de violence et d’injustice
A. L’injustice détruit les bases de la vie commune
Smith affirme ensuite une idée centrale : l’injustice, au contraire de l’absence de bienfaisance, est incompatible avec la société. Dès lors que les individus se nuisent, se trahissent ou se blessent, les liens sociaux sont brisés : c’est l’explosion du conflit, de la haine, de la vengeance.
La société repose donc d’abord sur l’absence de nuisance mutuelle : on peut vivre sans s’aimer, mais pas sans se respecter.
B. Une société de criminels ne tient que par un minimum de justice entre eux
Pour illustrer sa thèse, Smith évoque l’exemple provocateur d’une société de brigands ou d’assassins. Même entre eux, une règle minimale s’impose : ne pas se nuire à l’intérieur du groupe, faute de quoi ils ne pourraient même pas coopérer dans leurs actions.
Cela montre que la justice – définie ici comme le respect de certaines limites – est plus essentielle que la vertu.
C. Quand l’injustice domine, c’est la dissolution totale du lien social
La justice permet le maintien de la cohésion : sans elle, l’ensemble des individus se dispersent, agissent en ennemis, se détruisent. Smith utilise ici des expressions fortes : « tous les liens de la société sont déchirés », « les membres sont disséminés et dispersés » – c’est l’effondrement du corps social.
III. La hiérarchie entre bienfaisance et justice : la justice est la condition minimale de la société
A. La bienfaisance améliore la société mais ne la fonde pas
Smith reconnaît que la bienfaisance, c’est-à-dire la générosité, la charité, la compassion, rend la société plus agréable, plus humaine. Mais ce n’est pas elle qui la rend possible. On peut vivre ensemble sans s’aimer, à condition de ne pas se faire de tort.
Il fait donc une distinction nette entre ce qui est nécessaire (la justice) et ce qui est souhaitable (la bienfaisance).
B. La justice est une condition négative mais indispensable
La justice, chez Smith, consiste à s’abstenir de nuire : elle est une vertu « négative », mais fondamentale. Ce n’est pas l’amour du bien qui fonde la société, mais l’interdiction du mal.
C’est ce que dira aussi Rousseau dans le Contrat social : la société repose sur un pacte où chacun renonce à faire du tort à autrui.
C. Cette hiérarchie des vertus a une portée politique et morale
La thèse de Smith a une conséquence majeure : l’ordre social repose d’abord sur des règles de justice et de droit, non sur la moralité ou la vertu individuelle.
Cela justifie l’importance de l’État et des lois, qui garantissent la paix civile même dans une société individualiste.
Adam Smith défend dans ce texte une thèse lucide et originale : la société humaine peut se maintenir sans amour ni bienfaisance, mais jamais sans justice. Ce n’est pas la vertu qui fonde la société, mais le respect mutuel d’un cadre minimal de règles.
Cette analyse a une portée politique et morale essentielle : elle nous invite à reconnaître que la justice est le ciment le plus fondamental du lien social, bien plus que les sentiments, toujours incertains.
Ouverture : En ce sens, Smith annonce une vision moderne et libérale de la société, fondée sur le contrat, le droit et l’intérêt mutuel – une vision qui est encore au cœur des débats politiques contemporains.
Option 1
A. Éléments d’analyse
1. En quoi les rapports entre les hommes en société peuvent-ils être comparés à des rapports « entre différents marchands » ?
Smith souligne qu’une société peut fonctionner sans amour ni gratitude, par simple échange mutuellement avantageux : « l’échange mercenaire de bons services selon des valeurs convenues ». Comme des marchands, les individus traitent les uns avec les autres par intérêt réciproque : chacun rend un service parce qu’il y trouve son utilité, pas parce qu’il aime ou veut remercier l’autre
2. En prenant appui sur l’exemple d’une association de brigands et d’assassins, expliquer quelle est la condition pour que la société puisse « subsister ».
Même des « brigands et assassins » doivent s’abstenir de se nuire à l’intérieur du groupe : « ils doivent au moins… s’abstenir de se voler ou de s’assassiner les uns les autres ». Autrement dit, la non‑agression réciproque (une forme minimale de justice) est la condition sine qua non de la survie du collectif.
3. Quelle différence peut-on faire entre la bienfaisance et la justice ?
Quelle est leur importance respective en société ?
- Bienfaisance : vertus positives (générosité, solidarité). Smith dit qu’elle rend la société « plus confortable » mais n’est pas indispensable à son existence.
- Justice : devoir négatif (ne pas nuire). Elle est essentielle : « La prédominance de l’injustice la détruira absolument. »
La justice est le socle de la société ; la bienfaisance en est l’« amélioration » facultative.
B. Éléments de synthèse
1. Quelle est la question à laquelle l’auteur tente de répondre dans ce texte ?
Quelle(s) condition(s) minimale(s) permet(tent) l’existence ou la continuité d’une société humaine ?
2. Dégager les différents moments de l’argumentation.
1. Constat : une société peut fonctionner par pur intérêt, sans amour (comparaison aux marchands).
2. Limite : elle ne peut subsister si règnent les préjudices et le ressentiment (exemple des brigands).
3. Conclusion normative : la justice est plus indispensable que la bienfaisance ; sans elle, toute société se dissout.
3. En prenant appui sur les éléments précédents, dégager l’idée principale du texte.
La justice – entendue comme obligation de ne pas nuire – est la condition minimale et non substituable du lien social, alors que la bienfaisance n’en est qu’un agrément facultatif.
C. Commentaire
1. Si les hommes sont égoïstes, une société juste est-elle impossible ?
À première vue, l’égoïsme semble incompatible avec la justice. Être juste, c’est respecter les droits d’autrui, refuser de nuire, faire preuve d’impartialité : autant de comportements qui paraissent contraires aux tendances égoïstes de l’homme à rechercher son seul intérêt. Dès lors, on peut se demander si une société juste peut réellement exister si les individus ne sont mus que par leur intérêt personnel.
Le texte d’Adam Smith propose une réponse nuancée et profonde : oui, les hommes peuvent vivre dans une société juste même s’ils sont égoïstes, à condition qu’ils respectent des règles communes. Smith montre que la justice ne suppose pas l’amour d’autrui, ni même l’altruisme ou la générosité. Il écrit ainsi que « la société peut se maintenir […] à partir du sens de son utilité, sans aucun lien réciproque d’amour ou d’affection ». Cette idée repose sur un principe-clé : l’égoïsme peut être encadré et régulé par l’intérêt commun, dès lors qu’il existe un cadre normatif partagé.
Il faut donc distinguer l’égoïsme naturel (la recherche du bien propre) et l’injustice (la transgression des droits d’autrui). Pour Smith, ces deux réalités ne coïncident pas nécessairement. Même des individus mus par leur seul intérêt peuvent respecter la justice, non pas par vertu, mais parce qu’ils comprennent que ce respect est dans leur intérêt à long terme. C’est l’idée du « sens de l’utilité » : chacun y trouve son compte à ne pas nuire aux autres, car cela garantit la stabilité, la paix et la possibilité de coopérer.
Cela rejoint d'autres conceptions philosophiques. Hobbes, par exemple, dans Le Léviathan, estime que les hommes sont naturellement égoïstes et animés par un « désir insatiable de pouvoir », ce qui conduit à l’état de guerre. Mais pour éviter cette destruction mutuelle, ils acceptent par raison un pacte social qui limite leur liberté de nuire. La justice naît ainsi non de la morale, mais du calcul rationnel.
Montesquieu, quant à lui, défend l’idée que le commerce civilise les hommes : dans L’Esprit des lois, il affirme que « le doux commerce » rend les hommes plus justes, car il repose sur la réciprocité de l’intérêt. Cela rejoint Smith : même si les marchands ne s’aiment pas, ils ont tout intérêt à se traiter honnêtement pour poursuivre leurs échanges.
Cependant, cette vision utilitariste de la justice a ses limites. Si la justice repose uniquement sur le calcul intéressé, ne risque-t-elle pas de s’effondrer dès que l’intérêt individuel entre en conflit avec l’intérêt général ? Autrement dit, l’égoïsme toléré ne suffit peut-être pas à fonder une justice durable. Kant, dans Fondements de la métaphysique des mœurs, affirme que seule la morale – le devoir inconditionnel – fonde une véritable justice. Agir justement, ce n’est pas simplement éviter de nuire pour préserver ses intérêts, c’est reconnaître la dignité de l’autre comme une fin en soi. Selon cette perspective, la justice véritable exige un dépassement de l’égoïsme, et pas seulement un bon calcul.
Enfin, on pourrait aussi mentionner les théories contemporaines de la justice, comme celle de John Rawls, qui imagine une société juste comme le produit d’un accord rationnel entre individus égoïstes placés « derrière un voile d’ignorance ». Même ici, la justice peut naître de l’égoïsme éclairé, si l'on conçoit que chacun aurait intérêt à défendre des principes équitables sans savoir à quelle position sociale il appartiendra.
Le texte d’Adam Smith montre qu’une société juste n’exige pas que les hommes soient vertueux, mais seulement qu’ils respectent un minimum de règles communes motivées par leur intérêt. L’égoïsme n’est donc pas incompatible avec la justice : il peut même, à certaines conditions, en être l’un des moteurs. Cependant, on peut se demander si cette conception purement utilitariste suffit à garantir une justice authentique, ou si elle ne nécessite pas, en dernière instance, un certain degré de moralité.
2. L’injustice détruit-elle nécessairement la société ?
À lire Adam Smith, il semblerait que oui : il affirme que « la prédominance de l’injustice […] détruira absolument » la société. L’argument est clair : si les hommes ne se retiennent plus de se nuire, les « liens de la société sont déchirés ». Mais cette affirmation demande à être nuancée. Toute forme d’injustice est-elle réellement incompatible avec la vie sociale ? Ou bien faut-il distinguer l’injustice ponctuelle, supportable par le corps social, de l’injustice systémique, qui le menace profondément ?
I. Smith montre que l’injustice rend la société impossible
Dans le texte, Adam Smith établit une distinction décisive entre bienfaisance et justice. Si la société peut fonctionner sans amour ni générosité, elle ne peut survivre sans justice. En effet, l’essence même du lien social repose, selon lui, sur le refus de nuire : tant que chacun s’abstient de causer du tort, la société peut tenir, même dans un climat d’indifférence mutuelle. Il prend pour exemple une bande de brigands, dont l’existence commune suppose au moins une règle : ne pas se voler ou s’entre-tuer. Ce minimum de justice permet l’organisation.
Mais dès que l’injustice devient dominante – qu’il s’agisse de préjudices, de ressentiment ou d’animosité – la société entre dans une dynamique de désagrégation. Les relations deviennent destructrices, les individus se méfient, se vengent, se heurtent. Les liens sont « déchirés », les hommes deviennent étrangers, voire ennemis. Smith affirme ainsi que l’injustice radicale est une force de dissolution sociale.
II. L’histoire montre pourtant que la société peut survivre à une certaine dose d’injustice
Cependant, si l’on observe les sociétés réelles, on constate que l’injustice ne les détruit pas automatiquement. Beaucoup de régimes politiques et d’organisations sociales se sont maintenus malgré des inégalités criantes, des discriminations ou des violences institutionnelles. L’esclavage, les castes, le patriarcat ou l’exploitation des travailleurs ont coexisté avec des structures sociales stables. Pourquoi ? Parce que ces injustices étaient institutionnalisées et acceptées comme légitimes par une majorité. L’injustice n’a pas toujours l’effet explosif décrit par Smith : elle peut, à court ou moyen terme, être intégrée et supportée, tant qu’elle n’est pas perçue comme insupportable ou arbitraire.
Cela rejoint les analyses de Machiavel ou de Nietzsche, pour qui la stabilité politique ne dépend pas d’une justice universelle, mais d’un ordre clair, imposé ou accepté, fût-il injuste. Une société peut être cruelle ou inégalitaire tout en étant durable, tant que ses membres s’y adaptent ou s’y résignent.
III. C’est l’expérience de l’injustice comme illégitime qui rend la société instable
Il faut donc nuancer la thèse de Smith : l’injustice ne détruit pas nécessairement la société, mais elle la rend fragile, surtout lorsque les citoyens prennent conscience de son caractère arbitraire ou excessif. Une injustice ressentie comme insupportable provoque la colère, la révolte, la défiance. Ce n’est pas l’injustice en soi qui ruine la société, mais l’expérience collective qu’elle est devenue intolérable.
C’est ce qu’analyse Rousseau dans Le Contrat social : une société où les lois ne servent plus l’intérêt général mais seulement les puissants devient injuste, et perd sa légitimité. Il en va de même chez John Rawls, qui affirme que les principes de justice doivent être acceptables pour tous. Sinon, c’est la cohésion sociale qui est menacée.
Ainsi, l’injustice détruit la société lorsqu’elle brise le sentiment de loyauté, d’égalité, ou de confiance mutuelle. Elle alimente les conflits, la haine, les ruptures, et finit par rendre le vivre-ensemble invivable.
L’injustice ne détruit pas nécessairement la société dans l’instant : elle peut s’y installer durablement si elle est tolérée ou dissimulée. Mais dès qu’elle devient massive, flagrante, et ressentie comme illégitime, elle provoque une désintégration des liens sociaux. C’est ce que souligne Adam Smith : la justice est la condition minimale sans laquelle le corps social ne peut pas tenir. La société n’exige pas la vertu, mais elle exige au moins que chacun respecte l’autre assez pour ne pas le trahir ou l’agresser. L’injustice radicale, en violant ce pacte fondamental, menace toujours la survie du lien social.
Vous pouvez consulter les corrigés bac 2024
- Consultez les sujets en ligne
- Sujets PDF
- Consultez le corrigé officiel
- Correction PDF
Dissertations
- Sujet 1
- La nature est-elle hostile à l’homme ?
- Sujet 2
- L’artiste est-il maître de son travail ?
Commentaire
Sujet 3
Platon, “Les Lois”
« Il est nécessaire aux hommes de se donner des lois et de vivre conformément à ces lois, sous peine de ne différer en rien des bêtes les plus sauvages. Voici quelle en est la raison : aucun homme ne naît avec une aptitude naturelle à savoir ce qui est profitable pour la vie humaine en société, et même s’il le savait, à pouvoir toujours faire et souhaiter le meilleur. Car en premier lieu, il est difficile de comprendre que l’art politique véritable doit prendre soin, non du bien particulier, mais du bien général – car le bien général rassemble, tandis que le bien particulier déchire les sociétés ; et le bien commun tout autant que le bien particulier gagnent même tous les deux à ce que le premier plutôt que le second soit assuré de façon convenable. En second lieu, même si l’on était assez habile pour se rendre compte que telle est la nature des choses, et qu’on ait à gouverner un État avec un pouvoir absolu et sans rendre aucun compte, on ne pourrait pas rester fidèle à ce principe et faire passer pendant toute sa vie le bien commun de la société au premier rang et le bien particulier au deuxième. En fait la nature morelle de l’homme le portera toujours à vouloir plus que les autres et à s’occuper de son bien particulier, parce qu’elle fuit la douleur et poursuit le plaisir sans tenir compte de la raison, qu’elle les fera passer l’une et l’autre avant le plus juste et le meilleur, et, s’aveuglant elle-même, elle finira par se remplir, elle et toute la société, de toutes sortes de maux. »
— Platon, Les Lois (IVe siècle av. J.-C.)
Consulter les sujets et les corrigés du bac 2023
Consultez les sujets en ligne
- Sujets PDF
 Sujets bac technologique philosophie 2023 (606.5 Ko)
Sujets bac technologique philosophie 2023 (606.5 Ko)- Consultez les corrigés en ligne
- Correction des sujets de philosophie 2023
Vous pouvez aussi consulter les sujets et les corrigés du bac technologique 2022
- Dissertations
- Sujet 1
- La liberté consiste-t-elle à n’obéir à personne ?
- Sujet 2
- Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?
- Commentaire
- DIDEROT, Encyclopédie (1751-1772)
Vous pouvez aussi consulter les sujets et les corrigés du bac technologique 2021
![]() philosophie 2021 bac technologique métropole sujet officiel (655.56 Ko)
philosophie 2021 bac technologique métropole sujet officiel (655.56 Ko)
- Le candidat traite, au choix, un des quatre sujets proposés.
- Sujet 1: Est-il toujours injuste de désobéir aux lois?
- Sujet 2: Savoir, est-ce ne rien croire?
- Sujet 3: La technique nous libère-t-elle de la nature?
- Sujet 4: Explication de texte autour d'un extrait de l'ouvrage Le poète et l'activité de la fantaisie, de Sigmund Freud
- Tous les corrigés de philosophie du bac 2021
- Polynésie française
- Voie technologique
- Antilles Guyane
- Voie technologique
Les annales de philosophie, bac 2025
-
Corrigés bac philo 2025 – Métropole (bac général) : découvrez les corrigés dès la sortie de l’épreuve
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série générale, Métropole. Sujets du 16 juin corrigés dès la sortie de l’épreuve -
Retrouvez dès la sortie des épreuves, le corrigé de philosophie bac technologique métropole 2025
Découvrez les corrigés du bac de philosophie 2025, série technologique, Métropole. Sujets du 16 juin avec dissertations et commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2025 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés
Sujets corrigés philosophie bac général Amérique du Nord 2025 – découvrez les corrections, dissertations , commentaire du 20 mai. Entraînez-vous avec les corrigés -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2025
Retrouvez les sujets corrigés du bac technologique de philosophie 2025, centres étrangers groupe 1, dissertation et commentaire. -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2025
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2025 - Consultez les corrections du site -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Antilles Guyane, bacs général et technologique.
Consultez les sujets corrigés du bac de philosophie Antilles Guyane 2025, ils sont en ligne : commentaire et dissertation. Bacs général et technologique. -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique
Sujets de l'épreuve de philosophie 2025, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations 2024 -
Corrigé de l'épreuve de philosophie 2025, Polynésie française, bacs général et technologique.
Retrouvez tous les sujets corrigés de l'épreuve de philosophie 2025 de Polynésie française, ils sont en ligne sur sujetscorrigesbac.fr
Les annales de philosophie, bac 2024
-
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac Général 2024 philosophie métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve Consultez les corrections proposées des dissertations et du commentaire dès la sortie de la salle d'examen -
Bac technologique philosophie 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve
Bac technologique philosophie sessions juin et septembre 2024 métropole, sujets corrigés en ligne dès la sortie de l'épreuve. Consultez les corrigés, évaluez votre copie dissertation, commentaire -
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous avec les corrigés proposés
Sujets corrigés philosophie bac général , Amérique du nord 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés proposés du bac 2023 -
Sujets corrigés philosophie bac général, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés du bac
Sujets corrigés philosophie bac général , centres étrangers, groupe 1 session juin 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous-Centres de baccalauréat ouverts à l’étranger -
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entraînez-vous
Sujets corrigés philosophie bac technologique, centres étrangers, groupe 1 2024 - Consultez les corrections du site et entrainez-vous avec les corrigés bac du site pour le jour J. -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Polynésie française, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Polynésie française, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site et entrainez vous -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Antilles Guyane, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site
Sujets corrigés philosophie Antilles Guyane, examen 2024, sujets en ligne, bacs général et technologique. Consultez les corrigés du site -
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique.
Sujets de l'épreuve de philosophie 2024, Asie pacifique, bacs général et technologique. Entrainez vous avec les sujets, commentaires et dissertations corrigés 2023 et 2022 pour réussir votre examen
Date de dernière mise à jour : 16/06/2025